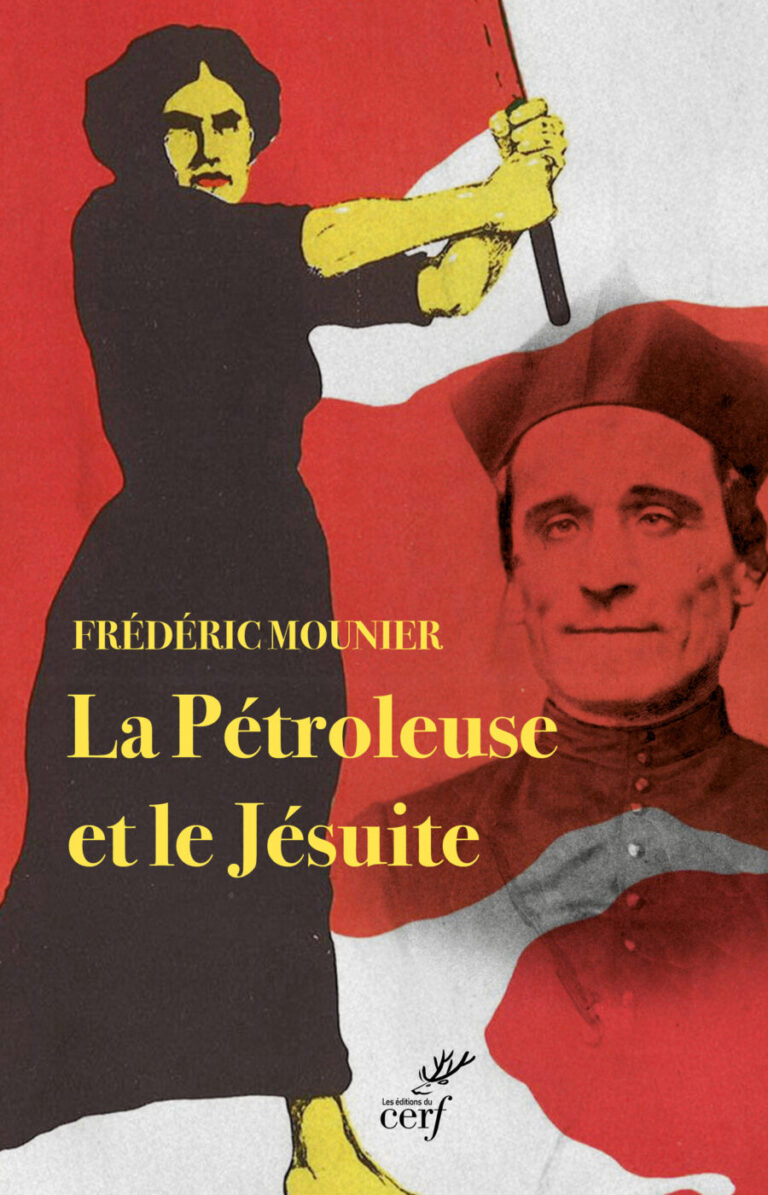David Teboul, Les Filles de Birkenau, Les Arènes, 23/01/2025, 263 pages, 24 €.
Après avoir chroniqué l’œuvre saisissante de Chochana Boukhobza, Les femmes d’Auschwitz-Birkenau, un cri qu’il fallait entendre et transmettre avant que les derniers témoins ne s’éteignent, nous voici de nouveau convoqués par l’écho déchirant de ces lieux. Cette fois, c’est David Teboul, documentariste et écrivain, qui orchestre, dans Les Filles de Birkenau, une polyphonie mémorielle d’une urgence poignante. Il ne s’agit pas d’une reconstitution historique au sens académique, mais d’une immersion, presque intime, dans la survivance de la parole. Quatre femmes – Isabelle Choko, Judith Elkán-Hervé, Ginette Kolinka, Esther Sénot – ultimes dépositaires d’une histoire qui menace de s’effacer avec elles, se livrent. Elles ne racontent pas seulement, elles dialoguent, se contredisent, s’interrogent, autour d’une table dressée par l’auteur, chargée des saveurs d’un monde englouti et des spectres de leurs enfances. Un festin de la mémoire où chaque plat, chaque mot, est une épitaphe et une promesse, un kaddish murmuré face à l’abîme de l’oubli.
Fragments d’enfances, éclats de l’Histoire
La narration s’ouvre sur une mosaïque d’existences, d’avant l’abîme, esquissant avec une sensibilité retenue les contours d’un monde européen bientôt englouti. Les enfances se déploient, diverses et pourtant unies par le fil ténu d’une judéité qui, pour certaines, est culturelle et familiale, pour d’autres, une assignation extérieure qui deviendra fatale. D’un côté, l’univers industrieux et intellectuellement stimulant d’Isabelle à Lodz, en Pologne, fille de pharmaciens, évoquant cette période comme « la plus heureuse de ma vie ». Elle se remémore une « école d’avant-garde », les joies du patin à glace, une « grande soif d’apprendre » inextinguible, déjà tournée vers la France pour ses études futures. De l’autre, l’enfance parisienne de Ginette, plus ancrée dans une quotidienneté populaire et laborieuse, rue Vieille-du-Temple, au sein d’une famille nombreuse où le père, tailleur d’origine ukrainienne, « confectionnait des imperméables » et où la mère, illettrée mais admirée, incarnait la figure de la « femme au foyer » d’une époque où « neuf à table » était la norme. Puis, il y a Esther, plongée dès ses deux ans, après l’arrivée de sa famille de Pologne, dans le Belleville cosmopolite des Juifs d’Europe de l’Est, une enfance passée « dans deux très petits appartements, avec l’eau et les toilettes sur le palier », rapidement confrontée à la nécessité de contribuer à « l’économie familiale ». Judith, enfin, conserve le souvenir d’une « enfance absolument heureuse » en Transylvanie, alors roumaine, au sein d’une bourgeoisie juive où son père était exploitant forestier ; une enfance imprégnée de l’amour familial, d’une fascination naissante pour la mode et les soirées élégantes, avant que les lois antijuives ne viennent brutalement assombrir ce tableau idyllique et transformer Oradea en antichambre de la déportation.
Ces réminiscences, chargées d’une lumière rétrospectivement crépusculaire constituent les premières strates de cette « Haggadah profane » que David Teboul convoque en introduction, une narration laïque de la sortie d’Égypte, ici la sortie de l’insouciance vers la conscience de l’Histoire. Car la grande Histoire s’infiltre insidieusement dans l’intime, d’abord par des signes avant-coureurs – l’angoisse d’Isabelle lors de l’entrée des Allemands à Lodz, où sa mère lucide murmure « il faudrait partir maintenant » – puis par la brutalité des faits : le « statut des Juifs », les étoiles infamantes, la peur qui s’installe comme une seconde peau. Esther relate avec précision la « rafle du billet vert », ce piège administratif où chaque convocation individuelle, sous couvert d’« affaires de famille », menait directement aux camps d’internement français, préludes à la déportation. Ces premières pages, par leur accumulation de destins individuels face à la machine broyeuse, posent d’emblée la complexité du souvenir : il ne s’agit pas d’un récit monolithique et cohérent, mais d’une archéologie des sensations, des angoisses diffuses, des choix impossibles – fuir ou rester, croire à la « correction » des Allemands ou douter. Les mots « chance » et « hasard », qui reviennent comme un leitmotiv sous la plume de Ginette et d’Isabelle, ne font que souligner l’arbitraire terrifiant qui présidait alors aux destinées, une roulette russe dont l’enjeu était la survie même.
La chair des mots face à l’indicible
Au cœur de ce recueil polyphonique, ce n’est pas tant la chronique exhaustive et chronologique de l’horreur concentrationnaire qui s’impose – bien qu’elle en constitue la toile de fond inéluctable et diffractée à travers les souvenirs parfois concordants, parfois divergents – que la mise en scène, quasi théâtrale et pourtant d’une authenticité viscérale, d’une parole ressuscitée, attablée. Autour des saveurs d’une cuisine yiddish – « carpe farcie, foie haché, harengs gras et vodka » – la table devient elle-même archive vivante, mémorial improvisé et acte de résistance mémorielle. David Teboul, en réunissant ces « filles », transcende le rôle du collecteur de témoignages ; il se fait le catalyseur subtil, parfois interpellé, d’un dialogue où la mémoire individuelle, avec ses failles, ses fulgurances et ses silences, se confronte à celle de l’autre, créant un tissu narratif d’une richesse stupéfiante et d’une humanité à vif.
Les moments les plus sombres de l’Histoire du XXe siècle sont évoqués non pas avec la distance feutrée de l’historien, mais avec la crudité charnelle de celles qui les ont vécus dans leur propre chair. La rafle du Vel d’Hiv’, relatée par Esther, n’est pas qu’un fait historique, mais le souvenir cuisant d’une angoisse insoutenable et de la « chance » – encore elle – qui l’a épargnée ce jour-là, alors que ses parents étaient emportés vers Drancy. L’arrivée à Birkenau, moment matriciel de la déshumanisation, est une cacophonie de hurlements, de coups, d’aboiements, une descente aux enfers où le premier « miracle » d’Isabelle est ce murmure salvateur d’un inconnu, en polonais : « À gauche, c’est la vie. À droite, c’est la mort. Va à gauche, n’oublie pas ! » Ginette, elle, se cramponne au souvenir de l’air frais à l’ouverture du wagon, « agréable un quart de seconde », avant que la brutalité implacable de la sélection ne la frappe de plein fouet, envoyant son père et son frère vers cette fumée dont elle ne comprendra que trop vite l’effroyable signification.
Le langage lui-même, dans cet univers concentrationnaire et dans le récit qu’elles en font aujourd’hui, devient un territoire ambivalent, un outil de survie autant qu’un lieu de souffrance et de malentendus. L’humour, qu’il soit noir, désespéré ou simplement teinté d’une ironie tragique, traverse les récits comme une lueur intermittente dans la nuit. Judith, avec ses anecdotes sur les blagues juives contées pour tenir ou le commentaire pince-sans-rire de la vieille dame aristocrate comparant son grabat du ghetto au Ritz – « Ma chérrrie, ici on est servi comme au Rrritz » –, illustre cette capacité sidérante de l’esprit humain à trouver des étincelles d’humanité, ou du moins de lucidité, au cœur même de l’abjection. L’oralité, brute, est la matière première de ce livre. Les femmes « se coupent la parole », leurs récits « se contredisent parfois et s’enrichissent souvent », la mémoire est une matière vivante, en perpétuelle reconstruction, loin de toute tentative de figer le souvenir dans une version unique et définitive. Cette non-linéarité, cette chair vive du verbe, échappe à la sclérose du témoignage institutionnalisé. La langue, bien sûr, se heurte parfois à l’indicible : Ginette confesse ne plus revoir les visages de ses compagnes de coya, « certaines ont dit oui, d’autres étaient comme moi, elles en avaient perdu tout souvenir » ; Esther, face à l’ampleur du trauma, évoque les limites de la parole. Mais elle est aussi ce qui reste, ce qui lie, ce qui peut encore, peut-être, tisser un fil entre les générations. Les questions obsédantes, triviales et pourtant fondamentales, sur les toilettes, sur cette « merde sans odeur » d’Auschwitz – comme si l’horreur avait même aboli les lois de la nature – ou l’évocation crue du « korona » – cet « amant » nazi proposé comme monnaie d’échange contre quelques cigarettes – sont autant de trouées brutales dans le réel concentrationnaire, d’instants où le corps et ses abjections, ses humiliations, ses besoins élémentaires, disent plus que de longs discours théoriques. Ces femmes, en refusant obstinément toute posture héroïque, en revendiquant leur simple et irréductible humanité de femmes, confèrent à leur parole fragmentée une puissance et une vérité décuplées. La controverse entre Judith et Ginette sur ce qu’il advint des mères et de leurs enfants dans les chambres à gaz illustre douloureusement la tension entre le besoin de savoir, de se représenter l’insoutenable, et la reconnaissance des limites de la connaissance face à l’horreur absolue.
Une table ouverte sur le présent
Les Filles de Birkenau transcende le statut d’un recueil de témoignages sur la Shoah, pour s’affirmer comme une œuvre essentielle qui, par la singularité de son dispositif – ces déjeuners où la parole, parfois apaisée, souvent abrasive, toujours vibrante, circule comme un antidote à l’oubli – et par la puissance d’évocation de ses quatre protagonistes, vient interroger de manière cruciale notre rapport contemporain à la mémoire, à la violence, et à la délicate, voire impossible, transmission de l’indicible. L’insistance de David Teboul sur l’oralité, sur la nécessité de préserver ces « voix qui, parce que leur disparition avait été planifiée, ne devraient jamais disparaître », fait puissamment écho aux travaux d’un Georges Didi-Huberman sur la survivance des images, des gestes, des paroles infimes, face aux entreprises d’anéantissement. Le livre devient alors un miroir tendu à notre époque, non par des parallèles simplistes ou des analogies hâtives, mais en mettant à nu, avec une acuité glaçante, les mécanismes insidieux de la déshumanisation, de la peur collective, et des logiques d’exclusion qui, hélas, persistent sous des formes renouvelées. Lorsque Esther Sénot évoque la création des camps d’internement en France pour les Juifs étrangers dès avant la guerre, ou les dénonciations qui ont conduit tant de familles à la mort, comment ne pas songer aux échos contemporains de la xénophobie et de la faillite des solidarités ? La fragilité persistante des démocraties, la facilité déconcertante avec laquelle l’Autre peut être transformé en bouc émissaire, sont des thèmes qui sourdent de ces pages avec une urgence qui nous saisit.
Le dialogue, parfois explicitement tendu, souvent douloureusement conflictuel, entre ces femmes elles-mêmes – sur la manière la plus juste de témoigner, sur ce qu’il faut dire ou impérativement taire, sur la place respective de l’histoire académique face à la parole incarnée du survivant (Judith affirmant : « C’est pour ça qu’il faut des livres d’histoire », Esther rétorquant que l’essentiel est de « laisser des messages » aux jeunes générations) – met en lumière la vertigineuse complexité de l’héritage mémoriel et les responsabilités qu’il nous assigne. La portée universelle de l’ouvrage réside précisément dans cette humanité brute, dans ce refus de toute forme d’édulcoration ou de simplification. Ces femmes ne sont pas des icônes désincarnées du martyre ; elles sont traversées, jusqu’à aujourd’hui, de doutes, de colères retenues, de contradictions fécondes. Leur rapport au judaïsme, par exemple, est vécu de manière profondément individuelle, oscillant entre la tradition familiale respectée par les parents d’Isabelle et l’athéisme clairement revendiqué de Ginette Kolinka. Ce qui les unit indéfectiblement, au-delà de leurs différences de caractère ou de parcours d’après-guerre, c’est cette expérience fondatrice et dévastatrice de Birkenau, ce stigmate indélébile qui continue de façonner, consciemment ou non, leur regard sur le monde et sur les autres. Et c’est peut-être dans cet humour tragique, cette capacité sidérante à faire surgir le rire même au seuil de l’anéantissement – comme lorsque Isabelle et sa mère éclatent d’un rire nerveux et libérateur en se découvrant la tête rasée, grotesques et tragiques marionnettes – que se niche la forme la plus pure et la plus désespérée de résistance à la déshumanisation programmée. Les récits de la vie après, des retours impossibles (Esther découvrant un Paris indifférent et tentant de se suicider), des silences nécessaires puis des paroles libérées (Ginette se murant dans le mutisme pendant des décennies avant de devenir une infatigable témoin), de la reconstruction difficile mais obstinée d’une existence (Isabelle trouvant une nouvelle vie à travers les échecs, Judith affrontant le deuil et questionnant la justice), enrichissent cette polyphonie d’une dimension qui ancre le trauma dans la longue durée d’une vie.
David Teboul referme son introduction par une question, d’une simplicité biblique et pourtant vertigineuse : « Qu’en savons-nous ? » Cette interrogation, si éloignée de toute certitude dogmatique, est une poignante invitation à l’humilité, à l’écoute active, et à la poursuite infinie du dialogue avec ces voix qui portent en elles les cendres et les braises du XXe siècle. Les Filles de Birkenau n’est pas un livre qui referme un dossier ou clôt un sujet ; c’est une œuvre vivante qui ouvre des brèches dans nos consciences, qui nous force à penser, à ressentir, et surtout, à ne jamais cesser d’écouter. C’est, en cela, un acte littéraire et mémoriel d’une importance capitale, une table dressée pour que la parole, même au bord de sa propre extinction biologique, continue de vibrer, de nous interroger, et de nous mettre en demeure. Car, comme le murmure la chanson de Daniel Darc que Teboul choisit pour clore son propre cheminement auprès de ces femmes, à la manière d’une litanie profane et tendre : « Si seulement tu savais / La taille de mon âme ». La taille de leur âme, à ces filles revenues de l’enfer de Birkenau, est, nous le savons désormais un peu mieux grâce à ce livre, simplement incommensurable. C’est cette démesure humaine, faite de fragilité et de résilience, que cet ouvrage, avec une grâce terrible et une infinie pudeur, nous donne à entrevoir.