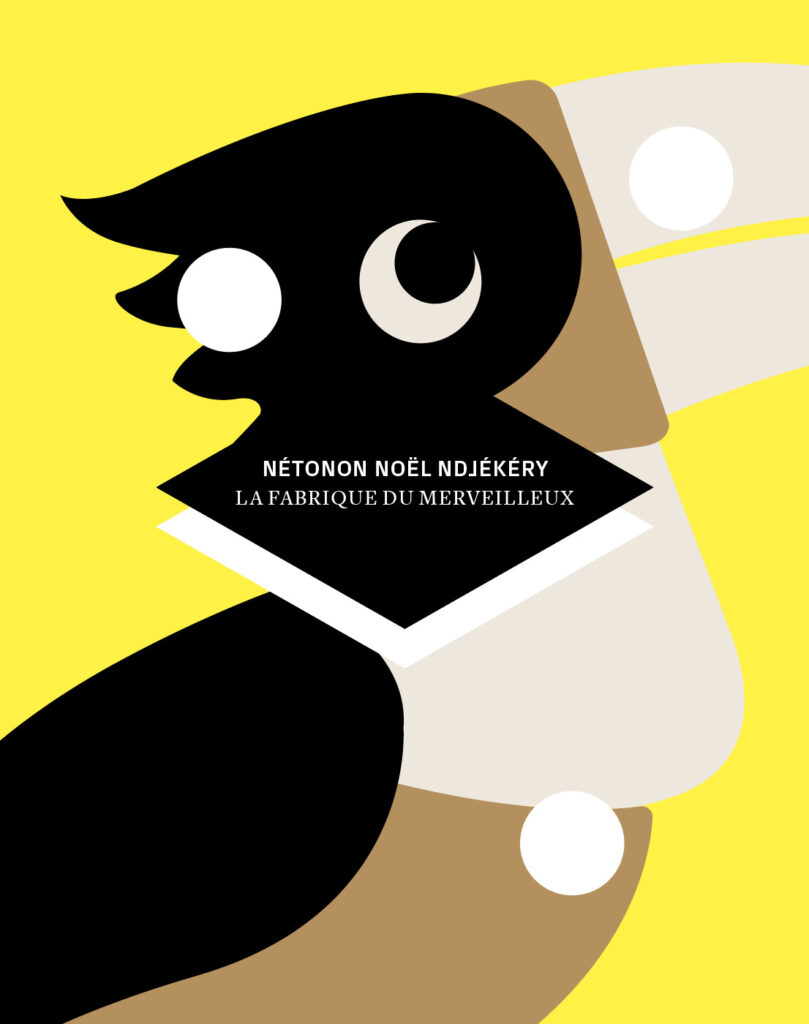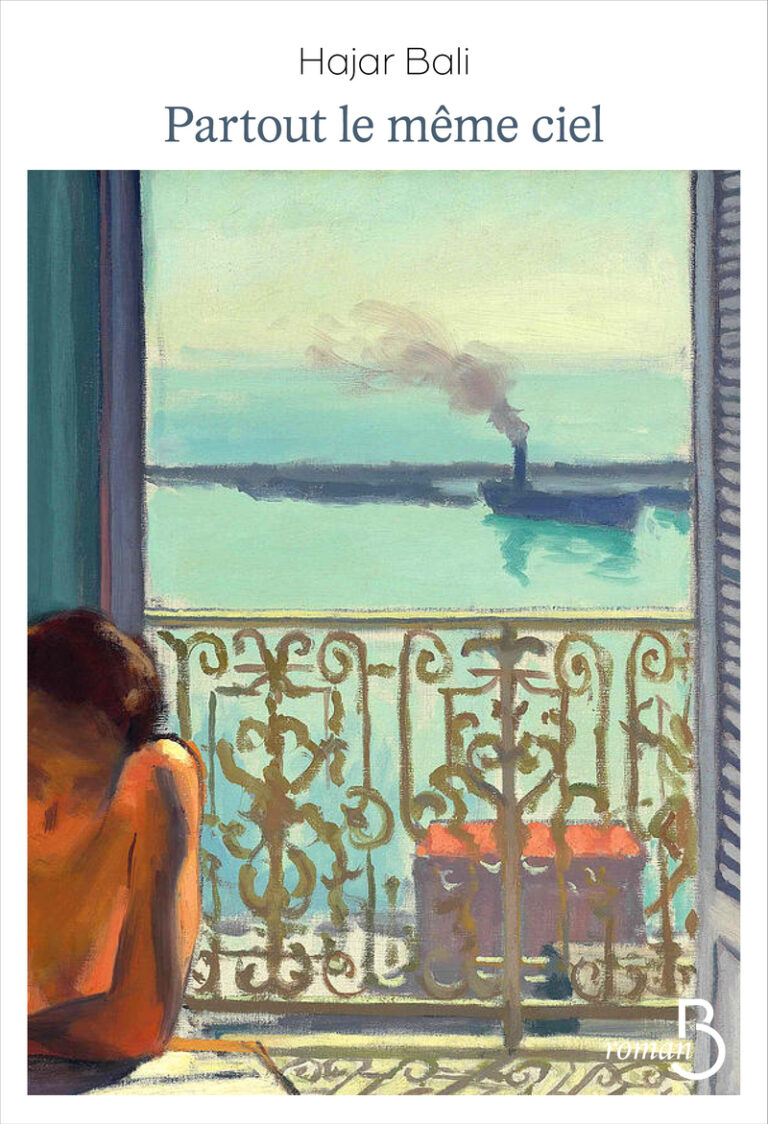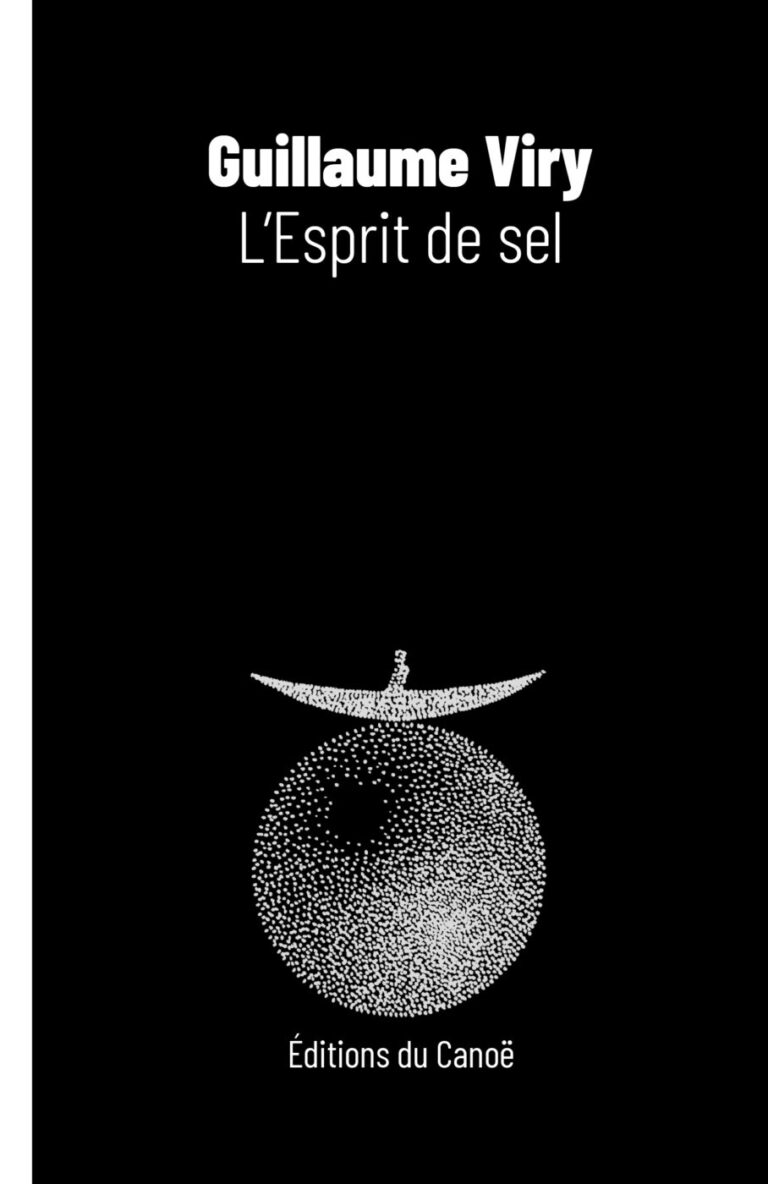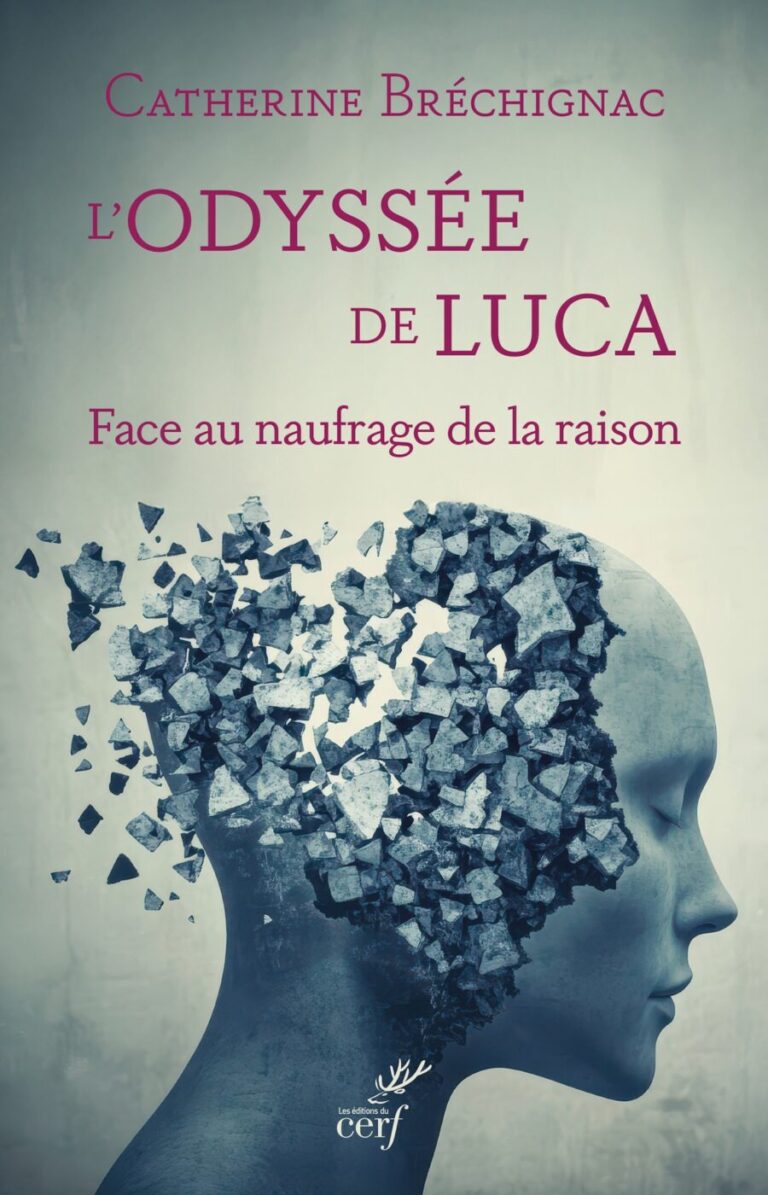Marcel Nadjary, Sonderkommando – Birkenau 1944 -Thessalonique 1947, Traduit du grec par Loïc Marcou, Éditions Signes et Balises, 27/01/2025, 466 pages, 14,90€
Édition bibliophilique aux Éditions Artulis, 200 exemplaires numérotés ; prix : 180 € : https://editionsartulis.fr/artulis/p-nadjary.htm
Il est des livres qui ne sont pas de simples objets de papier et d’encre. Ce sont des éclats d’obus logés dans la chair du temps, des fragments d’existence arrachés à l’oubli, des bouteilles jetées à la mer houleuse de l’Histoire, portant en elles le murmure rauque, parfois inaudible, de ceux qui ont traversé l’abîme. Sonderkommando – Birkenau 1944 – Thessalonique 1947 de Marcel Nadjary est de ceux-là. Mais avant même de plonger dans la terrible matière de ces écrits venus du cœur de l’enfer, il faut saluer, avec une gratitude mêlée d’effroi respectueux, le travail éditorial exceptionnel qui permet aujourd’hui à ces voix de nous parvenir. Car, publier Nadjary aujourd’hui, ce n’est pas simplement éditer un texte ; c’est accomplir un acte de restitution quasi archéologique, exhumer une parole littéralement enterrée, redonner souffle à un témoignage que l’histoire et l’horreur combinées avaient presque condamné au silence éternel. À l’instar du travail patient et nécessaire mené pour redonner sa place à une Louna Pélosoff, oubliée des grands récits, l’entreprise menée par les éditions Signes et Balises, sous l’égide minutieuse et passionnée d’Anne-Laure Brisac et Pierrette Turlais, relève de cette archéologie essentielle de la mémoire juive européenne, plus spécifiquement ici, grecque et sépharade. Ce n’est pas une mince affaire que de rassembler ces fragments – l’un déchiffré grâce aux technologies les plus pointues après des décennies sous terre, l’autre préservé par la piété familiale –, de les contextualiser avec une rigueur historique sans faille grâce aux contributions des meilleurs spécialistes (Tal Bruttmann, Andreas Kilian, Loïc Marcou et tant d’autres), d’en éclairer les non-dits, d’en traduire les silences, d’en respecter la polyphonie linguistique. C’est un travail d’orfèvre, une gageure éditoriale qui tient à la fois de la philologie, de l’histoire et de l’éthique. C’est cet écrin remarquable, pensé avec intelligence et sensibilité, qui te permet, lecteur, d’approcher aujourd’hui l’indicible parole de Marcel Nadjary. Approche-nous et écoutons. Écoute. Le murmure est devenu cri
L’odyssée des ténèbres : d’Athènes au cœur du crématoire
Avant d’être le matricule 182669 tatoué sur la peau, avant d’être ce “Grec” perdu dans la Babylone concentrationnaire, Marcel Nadjary fut un homme de Salonique, cette “Jérusalem des Balkans” vibrante de culture sépharade, puis un combattant sur le front albanais contre l’Italie fasciste, enfin un résistant dans les montagnes grecques. Ce n’est pas une victime passive qui nous parle, mais un homme qui a lutté, qui a choisi son camp, celui de la dignité contre la barbarie. Son récit de 1947, écrit dans le tumulte de la guerre civile grecque, remonte le fil de cette existence brisée : la mobilisation, la fuite d’une Thessalonique menacée vers Athènes, l’engagement dans le maquis de l’ELAS, les blessures, la trahison peut-être, et l’arrestation fin 1943. L’horreur commence avant l’horreur terminale : les geôles de la Gestapo rue Merlin, la torture ignoble pour lui arracher son identité juive – cet aveu qui scelle son destin –, la prison d’Avéroff, antichambre de l’enfer, puis le camp de Haïdari. Déjà, le mécanisme de déshumanisation est en marche.
Une bouteille à la mer de cendres
Mais l’essence de ce volume, sa pulsation la plus secrète et la plus terrible, réside dans ce premier manuscrit, daté du 3 novembre 1944. Birkenau, l’usine de mort tourne à plein régime, même si l’ombre de la défaite plane sur le Reich. Près du Crématoire III, dans la boue et la puanteur, un homme de vingt-sept ans, membre du Sonderkommando – cette unité maudite chargée de la besogne la plus infâme –, sent sa propre fin approcher. La grande révolte du 7 octobre a été écrasée dans le sang, la liquidation des derniers “porteurs de secret” n’est qu’une question de temps. Que faire ? Comment crier quand on est condamné au silence ? Marcel Nadjary écrit. Sur douze feuillets arrachés à un cahier d’écolier, avec une encre bleue aujourd’hui presque effacée, il rédige une lettre d’adieu, un testament, un message ultime. Il décrit, avec une économie de mots dictée par l’urgence et le manque de papier, la mécanique monstrueuse : l’accueil des convois, la salle de déshabillage, la chambre à gaz – “où quand / à peu près 3 000 personnes sont entassées / elle est fermée et ils les Gazent et puis après 6-7 minutes de martyre elles rendent l’âme”–, le travail macabre des fours, la dispersion des cendres. Il risque sa vie en écrivant, il la risque encore en confiant ces feuilles fragiles à une bouteille thermos, elle-même glissée dans une sacoche de cuir, enfouie à trente centimètres sous cette terre saturée de mort. Trente-six ans. Trente-six ans, ce message attendra, presque illisible, rongé par l’humidité, que des mains le sortent de l’oubli, que la technologie – l’imagerie multispectrale – vienne suppléer les lacunes du temps et de la décomposition, pour nous rendre, quasi intacte, cette parole venue du cœur des ténèbres. Ce n’est pas un simple texte, comprenons-le bien, c’est un survivant matériel, un miracle fragile arraché à la double destruction : celle des corps par le feu, celle de la mémoire par le silence nazi.
Vengeance, survie, identité
Dès ces premières pages hantées, les thèmes qui traverseront toute l’œuvre de Nadjary sont posés, avec une intensité poignante. La perte, bien sûr : celle des parents, Abraham et Louna, celle de la sœur chérie, Nelly, assassinés dès leur arrivée. “J’ai voulu et je veux / vivre pour venger la / mort de Papa, de Maman / et de ma sœur chérie / Nelly“, écrit-il. Ce désir de vengeance est un moteur puissant, le fil ténu qui le retient de sombrer avec les victimes qu’il conduit à la mort, ce geste sacrificiel qu’il avoue avoir envisagé. La survie n’est pas un but en soi, mais un moyen pour cette fin : témoigner, venger. Et puis, il y a cette affirmation, répétée, martelée, de son identité grecque. Dans cet enfer cosmopolite où les langues se mêlent et où l’identité est réduite à un numéro, Nadjary se revendique “vrai Grec”, déterminé à mourir en “bon citoyen“, et conclut sa lettre par un vibrant “Vive la Grèce“. Cette fierté nationale, cette appartenance revendiquée au cœur de l’anéantissement, est un acte de résistance symbolique puissant, une manière de dire : vous ne m’enlèverez pas tout. C’est l’homme debout face à la machine à broyer.
La topographie de l’indicible
Si le premier manuscrit est un cri dans la nuit, le second, écrit en 1947, est une tentative de cartographier l’enfer traversé. Avec la distance, fragile, du survivant, Nadjary reprend son périple, depuis le maquis jusqu’à la libération de Mauthausen, en passant par les neuf mois passés dans les entrailles de Birkenau. Sa description du centre de mise à mort est d’une valeur inestimable. Grâce à lui, nous pénétrons dans l’antichambre de la mort : la Judenrampe initiale, puis la Bahnrampe construite pour accélérer le flux vers les crématoires durant l’extermination des Juifs hongrois. Nous suivons le cheminement des victimes vers le Zentralsauna, ce lieu de désinfection et d’enregistrement où l’humanité est dépouillée de ses derniers oripeaux. Puis c’est l’organisation concentrationnaire vue de l’intérieur : les différents Blocks, le camp de Quarantaine (BIIa), le camp des hommes (BIId), le sinistre Block 13, quartier général du Sonderkommando, mais aussi les structures administratives ou répressives comme la Politische Abteilung (Gestapo) ou le rôle terrifiant des Kapos et Blockältester. Nadjary n’est pas seulement un témoin des chambres à gaz ; il est aussi, par la force des choses, un observateur lucide de la micro-société concentrationnaire, de ses hiérarchies, de ses violences internes, de ses langues – ce Lagersprache où se mêlent l’allemand dégradé, le polonais, le yiddish, et pour lui, le grec, le judéo-espagnol (djudezmo), le français. Les treize dessins qui parsèment ce second manuscrit, esquisses maladroites mais poignantes des crématoires, des chambres à gaz, de l’entrée d’Auschwitz I, renforcent cette volonté de documenter, de rendre visible l’inimaginable, comme si la plume narrative ne suffisait plus face à l’ampleur du crime.
L’encre grise du Sonderkommando
Le cœur battant, et terrifiant, des deux manuscrits est bien sûr la description du “travail” au Sonderkommando. Nadjary ne nous épargne rien, ou presque. La réception des convois, l’ordre crié en allemand de se déshabiller (“Aoutsien !”), la séparation brutale des familles, la litanie des mensonges pour maintenir le calme jusqu’au seuil de la chambre à gaz. Puis l’ouverture des portes sur l’amas des corps (“un tas de cadavres juste à l’entrée“), l’extraction à l’aide de crochets ou de ceintures, le transport vers les monte-charges, le “nettoyage” préalable (coupe des cheveux, extraction des dents en or par le Zahnarzt), et enfin, l’enfournement des corps, trois par trois, dans la gueule incandescente des fours crématoires. Il décrit les fosses de crémation à ciel ouvert près du Bunker 2, où les corps sont jetés pêle-mêle, où la chaleur est insoutenable, où la graisse humaine alimente les flammes. Il rapporte les chiffres, les cadences infernales – 2 500 corps réduits en cendres en 24 heures. Mais Nadjary va au-delà de la description de l’horreur mécanique. Il pénètre, avec une lucidité douloureuse, dans ce que Primo Levi nommera la “zone grise”. Cette zone trouble où la distinction entre victime et bourreau se brouille, où des prisonniers sont contraints de participer à l’extermination de leurs propres coreligionnaires. “Mes amis vous direz en lisant quel travail j’ai fait, comment moi / Manolis ou qui que ce soit d’autre effectuant ce / travail j’ai pu brûler mes coreligionnaires“, écrit-il en 1944, conscient du jugement moral que son récit pourrait susciter. Il n’élude pas la question terrible de la collaboration involontaire, du rôle joué dans la duperie des victimes. Il n’y a pas de justification facile, juste le constat glacial d’une situation où la survie immédiate passait par l’exécution de tâches monstrueuses. Son témoignage est crucial, car il montre, de l’intérieur, la perversité d’un système qui visait non seulement à tuer les corps, mais aussi à corrompre les âmes.
Une écriture à nu
Face à cette expérience limite, comment écrire ? Quel style adopter ? Nadjary, on l’a vu, n’est pas un “écrivain” au sens littéraire du terme. Ses textes sont bruts, souvent heurtés. La syntaxe du premier manuscrit est syncopée, haletante. Le second, plus posé, n’en conserve pas moins une forme d’oralité, une rapidité qui évoque un flux de conscience transcrit à la hâte. Point de fioritures, point de recherche esthétique. L’urgence est de dire, de documenter, d’attester. Les rares figures de style sont celles qui s’imposent d’elles-mêmes, comme l’accumulation pour dire la masse, ou l’enargeia – cette capacité à rendre visible par les mots – lorsqu’il décrit l’amoncellement des cadavres ou le travail aux fours. Son mélange de langues (grec, allemand des camps, français, judéo-espagnol, polonais, hongrois) n’est pas un artifice, mais le reflet de la réalité polyglotte et chaotique de Birkenau, et de sa propre identité de Juif sépharade de Salonique. Il utilise des mots allemands translittérés (“Ausclaïder Room”), des abréviations (“Cr.” pour crématoire), des transcriptions phonétiques approximatives pour les noms des SS (Mousffeld pour Muhsfeldt, Molle pour Moll), signe qu’il écrit ce qu’il a entendu, non ce qu’il a lu. Cette “imperfection” même de l’écriture est une forme d’authenticité, la trace d’une parole qui peine à se frayer un chemin hors de l’abîme. Écrire, pour Nadjary, c’est avant tout résister à l’effacement programmé par les nazis, graver dans la matière fragile du papier la preuve irréfutable du crime, et sauver, peut-être, une parcelle de sa propre humanité dans le processus.
Le cri qui traverse les murailles
Pourquoi lire Marcel Nadjary aujourd’hui, près de quatre-vingts ans après l’écriture du premier manuscrit, plus de cinquante ans après sa mort ? Parce que son témoignage, dans sa nudité même, résonne avec une force singulière dans notre présent saturé d’images, de récits médiatisés, et parfois menacé par la dilution ou la négation de la mémoire historique. À l’heure où les derniers survivants disparaissent, ces textes exhumés nous parviennent comme des messages essentiels. Ils nous rappellent la nécessité vitale d’écouter les voix directes, celles qui ont vu, qui ont vécu l’horreur de l’intérieur. Lire Nadjary, comme nous y invite Georges Didi-Huberman, c’est peut-être “recevoir dans les mains” non seulement un texte, mais la vibration d’une souffrance, l’urgence d’un cri. C’est accepter de se laisser toucher, bousculer, interroger par une parole qui vient d’ailleurs, d’un lieu et d’un temps qui défient notre entendement. Ce n’est pas une lecture confortable. C’est une lecture qui engage, qui responsabilise. Car le vœu de Nadjary – “que vos mains reçoivent ce que je vous écris” – s’adresse désormais à nous tous.
Par-delà les cendres, l’universel
Si l’œuvre de Nadjary est ancrée dans l’histoire spécifique de la Shoah, de la destruction des Juifs de Grèce, et de l’enfer concentrationnaire d’Auschwitz-Birkenau, sa portée dépasse largement ce cadre. Elle nous confronte à des questions universelles sur la condition humaine face à la violence extrême, sur les limites de la résistance, sur la possibilité de conserver sa dignité dans la déshumanisation la plus totale, sur le devoir de mémoire et de transmission. Nadjary, par son parcours – résistant, déporté, Sonderkommando, survivant –, incarne de manière poignante la complexité des expériences et des choix moraux en temps de génocide. Il n’est ni un saint ni un héros sans failles, mais un homme qui, jeté dans des circonstances inimaginables, a lutté pour survivre sans perdre entièrement son âme, et a ressenti l’impératif catégorique de témoigner. Sa double identité, juive et grecque, fièrement assumée, apporte une nuance supplémentaire, rappelant que l’appartenance nationale peut aussi être un refuge identitaire et une source de force morale face à la négation de l’humanité. Son humour même, cette lueur paradoxale dans les ténèbres, soulignée par ses camarades, interroge sur les ressorts insoupçonnés de l’esprit humain pour ne pas céder totalement au désespoir.
La transmission comme victoire fragile
Le destin des manuscrits de Nadjary est en soi une histoire remarquable, une parabole sur la fragilité et la persistance de la mémoire. Le premier, enterré, voué à l’oubli, sauvé par miracle et déchiffré par la science. Le second, conservé par la famille, publié tardivement. Leur réunion aujourd’hui dans cette édition française, enrichie des éclairages de Serge Klarsfeld, Georges Didi-Huberman, Tal Bruttmann, Fragiski Ampatzopoulou, Andreas Kilian, Loïc Marcou, et des propres enfants de Nadjary, Nelly et Alberto, constitue un événement éditorial et mémoriel majeur. Elle réalise, d’une certaine manière, le vœu implicite du témoin : que sa parole traverse le temps, qu’elle soit lue, entendue, comprise. Elle nous rappelle que chaque témoignage sauvé est une victoire, aussi infime soit-elle, contre le projet nazi d’anéantissement total. Il n’y a pas de “point final” à cette histoire. Le travail de mémoire, comme l’écriture de Nadjary, est une tâche toujours recommencée. Recevoir ces textes, aujourd’hui, c’est accepter notre part de cette chaîne de transmission, c’est devenir, à notre tour, les gardiens vigilants d’une mémoire qui ne doit jamais s’éteindre. Car dans le silence apparent des cendres, la voix de Marcel Nadjary, enfin lisible, continue de nous interpeller.