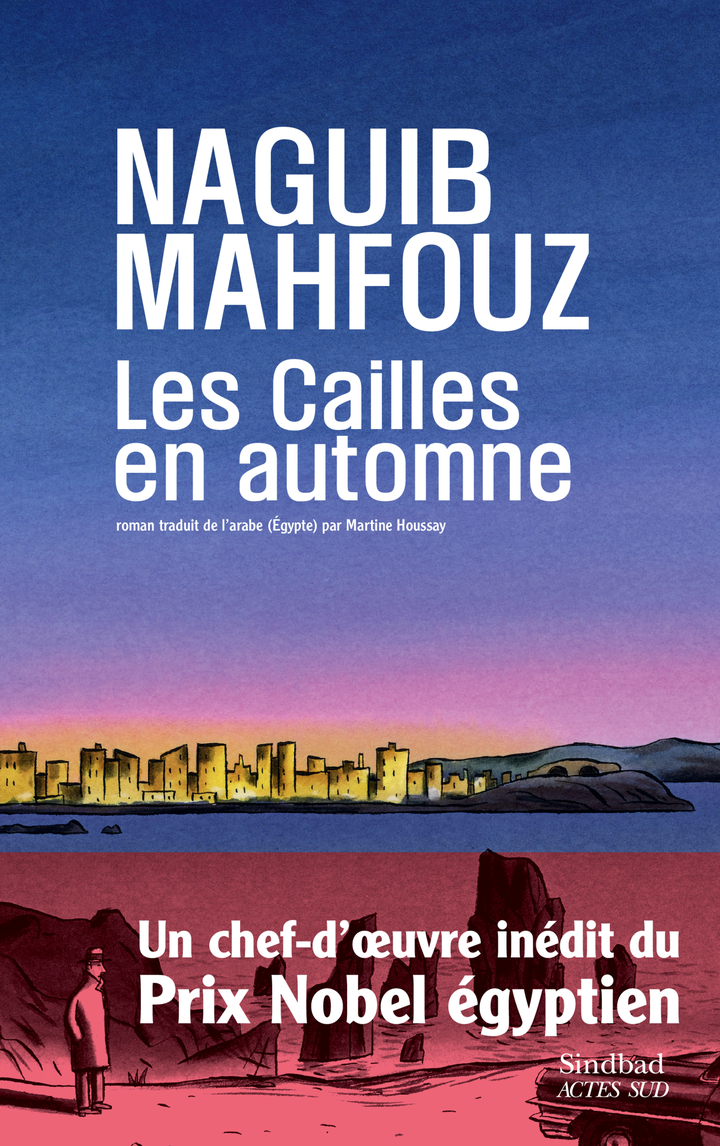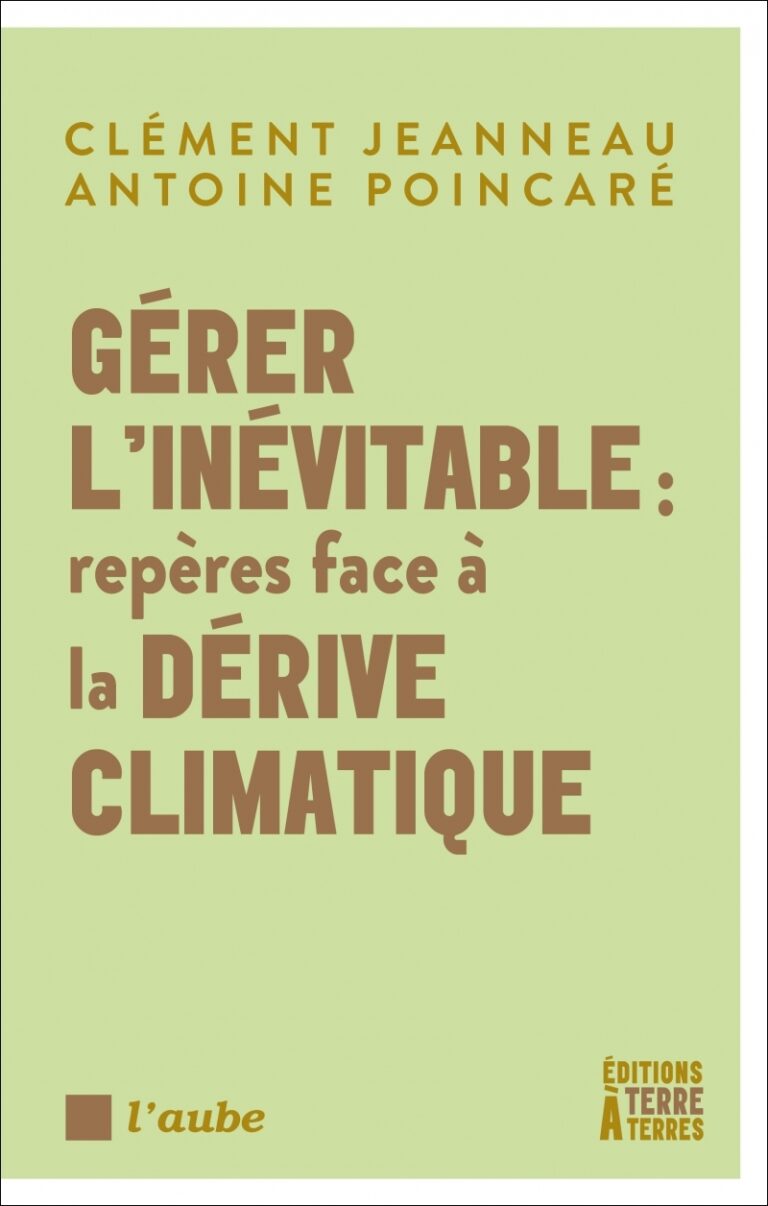Dominique Fabre, La jeunesse est un cœur qui bat, Arléa, 08/01/2026, 262 pages, 20 €
Dominique Fabre, écrivain français et professeur d’anglais (né à Paris en 1960), raconte ici la dernière année avant la retraite. Le narrateur enseigne dans un lycée du XIIᵉ arrondissement, habite Bagnolet, prend le bus à l’aube avec les Sikhs qui rentrent de Roissy et les femmes de ménage. De ce seuil, le narrateur se retourne. Ce qui revient n’est ni un bilan ni une élégie : c’est un flot de visages, de répliques brutes, de scènes où la violence et la grâce se cognent dans le même couloir. Un livre écrit à hauteur de salle des profs, de cour de récré, de boulevard, et qui creuse bien plus loin qu’une fin de carrière.
Le bahut, la rue, les langues mêlées
Le récit avance par fragments séparés d’astérisques, comme un journal de bord sans dates. On entre dans la salle 211, on fait cours sur le Good Riddance Day : les élèves écrivent ce dont ils veulent se débarrasser. Toufik déteste sa paresse, les gamines veulent retourner à Rosny-sous-Bois, Pasindu dessine un vieil homme dont il ne retrouve pas les traits. Le narrateur attrape ces instants avec une précision sèche, sans les commenter. Quand il note, porte de Montreuil, que “la misère aussi se lève trop tôt”, la phrase tient en sept mots et dit ce qu’un rapport social mettrait vingt pages à formuler.
Mais ce livre n’a rien d’un récit attendri. La langue y est souvent crue : insultes en classe, remarques racistes entre élèves, homophobie ordinaire (“pédé… pédé… pédé…” scandé dans la rue par un élève), et cette principale hors d’elle, quand le narrateur se présente, en hurlant qu’elle ne veut pas de “pédés en tongs” dans son établissement. Le récit enregistre ces violences sans les dramatiser, sans les résoudre non plus. Elles restent là, nues, comme des faits de langue autant que des faits de vie. La collègue argentine qui pleurait sans bruit à chaque récréation, la gamine de quatorze ans déjà prisonnière de la nuit parisienne, Sekou qui traite son prof de fils de pute et dont le sort va occuper les dernières semaines avant les vacances : le professeur pose ces scènes côte à côte, sans hiérarchie apparente, et c’est ce refus du tri qui donne au livre sa vérité particulière.
La machine et la fatigue
Le vers de Guy Tirolien, placé en épigraphe (“Seigneur je suis très fatigué / Je suis né fatigué”), revient tout au long du livre comme un refrain. Mais cette fatigue, Dominique Fabre la déploie sur plusieurs strates. Il y a l’épuisement quotidien, les formations grotesques (le coup de la main levée enseigné par un inspecteur, les escape games sur Genially), les ordis qui marchent mal, le papier toilette qui manque. Et puis il y a la mécanique institutionnelle que le texte fait sentir sans jamais la théoriser : la DHG qu’on réduit, les heures qui sautent, les postes non remplacés, l’évaluation permanente, le numérique imposé comme un catéchisme (“sans Genially ni Kahoot, sans blog personnel ni flashcards, sans escape games ni QR codes ni rien du tout, on n’est pas considérés”), les principaux qui passent du bureau protecteur à la surveillance managériale. L’inspectrice qui vient expliquer aux enseignants qu’ils doivent, eux aussi, “participer au redressement des comptes de la nation”. Personne ne relève. Le narrateur non plus, sur le moment. Mais l’accumulation des scènes, leur juxtaposition froide, compose une critique d’autant plus efficace qu’elle ne se présente jamais comme telle.
Plus profond encore, le chapitre XI remonte à l’internat de l’enfance : les douches collectives sous le regard du Breton, les coups, les humiliations, monsieur Rassin qui frappe Fabrice à la chevalière jusqu’au sang. Ce retour aux origines reconfigure toute la fatigue du livre. Elle ne commence pas avec le métier ; elle vient de l’école elle-même, de ce qu’elle peut infliger à ceux qu’elle prétend former. Dominique Fabre inscrit sa propre histoire dans une continuité de violence éducative qui éclaire d’un jour plus sombre sa patience de prof vieillissant.
Les visages qui restent
Pourtant le livre tient debout par ses rencontres, celles du boulevard Diderot et de la place de la Nation. Aymen, trente-trois ans, devenu ingénieur en métallurgie, qui s’inquiète pour sa mère. Saïd, en uniforme, qui se sent “comme un étranger” dans le quartier où sa mère vient de mourir. Le garçon du grand S de Bondy, concierge d’hôtel, les mains dans les poches, qui porte encore la peur des cages d’escalier. Sandy, qui garde les larmes au bord des cils tout un trimestre parce que sa mère a “un petit cancer”. L’inversion est fréquente : c’est l’ancien élève qui dit au prof “Faites attention à vous, m’sieur”. Le narrateur accueille ce renversement sans en faire une leçon.
Le poème final, adressé à un collègue disparu, ramasse en vers libres ce que la prose a dispersé au fil des pages, et s’achève sur le désir de “refaire tous mes pas / jusqu’au dernier enfant qui sort / de la dernière salle de classe”. Dominique Fabre a écrit une trentaine de livres. Celui-ci, écrit depuis la zone exacte où l’on cesse d’être utile sans avoir cessé de regarder, fait entendre quelque chose que la littérature française contemporaine peine à produire : la voix d’un homme qui n’a rien surplombé de ce qu’il raconte, et qui s’en va les mains vides, sachant que c’est précisément là que tout tient.