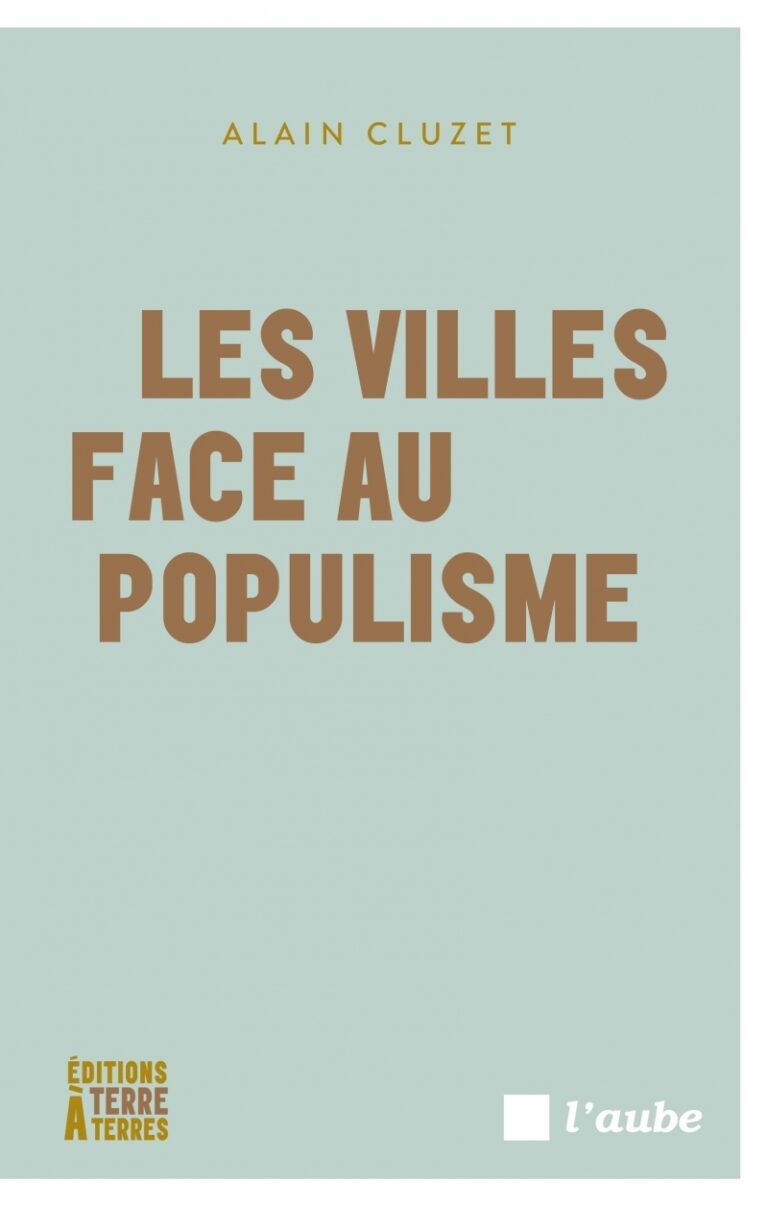Mohammad Ali Amir-Moezzi & John Tolan, Le Mahomet des historiens (2 Volumes), Éditions du Cerf, 16/10/2025, 2186 pages, 59 €
Il y a cinq ans, Les Éditions du Cerf prenaient un pari d’éditeur presque insensé : confier à près de trente chercheurs la rédaction d’une somme historico‑critique sur le texte fondateur de l’islam. Paru en 2019, Le Coran des historiens (3 volumes et 3 000 pages), dirigé par Mohammad Ali Amir‑Moezzi et Guillaume Dye, a été salué comme une œuvre monumentale et pionnière, fruit de cinq années de travaux, qui a marqué 2020 par l’ampleur de son retentissement académique et public. L’entreprise a été comparée à la révolution opérée jadis par l’exégèse biblique : replacer le texte au cœur de son histoire, croiser philologie, épigraphie et histoire des idées, et donner au lecteur une cartographie savante des connaissances. Bref, un geste éditorial rare, aussi intellectuel que civique. Cette aventure a désormais une suite à sa mesure. En octobre 2025, le Cerf publie Le Mahomet des historiens, un coffret en deux volumes d’environ deux mille pages, codirigé par Mohammad Ali Amir‑Moezzi (EPHE‑PSL) et John Tolan (Université de Nantes). Cinquante spécialistes internationaux y synthétisent, pour un large public, les acquis les plus récents sur la figure du Prophète, dans un ouvrage voulu comme un pont entre la science et la cité — démarche soutenue par le Roshan Cultural Heritage Institute. C’est à la fois un prolongement naturel de la « somme coranique » et un nouveau jalon pour la connaissance partagée. Dans une époque saturée d’opinions rapides, cette double entreprise éditoriale fait figure de cadence longue : elle assemble des savoirs exigeants, les ordonne, les rend lisibles et utiles. Après avoir remis le Coran au carrefour des civilisations qui l’ont vu naître, le Cerf offre aujourd’hui la grande biographie savante de la figure historique de Muhammad, polyphonique et méthodiquement sourcée. Une aventure éditoriale exemplaire : prudente dans ses méthodes, audacieuse dans son ambition, résolument tournée vers le grand public. Nous avons choisi de consacrer deux chroniques distinctes au Mahomet des historiens, car les deux volumes forment un diptyque unique : le premier interroge la naissance du récit prophétique et la fabrique de son histoire, tandis que le second déploie la trajectoire planétaire de cette figure, du monde ottoman à nos débats contemporains.
Mahomet, l’homme aux mille visages : archéologie d’un vertige
Il y a des figures qui habitent l’histoire comme des spectres nécessaires, des silhouettes dont la puissance tient moins à ce qu’elles furent qu’à ce que l’on n’a cessé de dire, de croire, de craindre ou d’espérer d’elles. Mahomet est de celles-là. On pense connaître le Prophète de l’islam – fondateur d’une religion, architecte d’un empire, législateur d’une communauté – et pourtant, au contact du monumental Mahomet des historiens, l’évidence se fissure. Loin de proposer une énième biographie, entreprise qu’ils jugent d’emblée vaine et impossible, les directeurs de l’ouvrage, Mohammad Ali Amir-Moezzi et John Tolan, orchestrent une magistrale archéologie des savoirs et des imaginaires. Ils ne demandent pas « qui était Mahomet ? » mais « qui sont les Mahomet que les historiens, les théologiens, les poètes et les polémistes ont façonnés au gré des siècles ? ». Ce premier volume est une plongée dans les strates textuelles et mémorielles qui ont bâti, en couches successives et souvent contradictoires, une figure devenue le miroir des mondes qui l’ont regardée. C’est un manifeste méthodologique : pour saisir un prophète, il faut renoncer à le biographier.
La toile d’araignée des origines : autopsie d’un récit impossible
Le voyage commence par un constat radical qui fonde tout l’édifice : les sources scripturaires, loin d’offrir un socle stable, sont elles-mêmes le premier objet du soupçon. Adam Flowers, analysant le corpus coranique, révèle ce paradoxe saisissant : le Prophète y est le pivot omniprésent de la Révélation, mais sa personnalité historique y demeure fantomatique, son nom n’apparaissant que cinq fois. Le Coran n’est pas une vie de Mahomet ; c’est un recueil de discours où la figure prophétique se construit en creux, passant du statut d’avertisseur mecquois solitaire à celui de chef de la communauté médinoise. Le texte sacré, ne livre pas un homme, mais il reflète les tensions et les aspirations d’une foi en train de naître, le champ de bataille où s’affrontent déjà les lectures traditionalistes, avides de chronologie, et les approches révisionnistes, sceptiques quant à l’historicité même de cette trame.
Quand l’Histoire devient récit : l’invention littéraire de Mahomet
Le récit biographique a donc dû être tissé ailleurs. Adrien de Jarmy cartographie avec précision cette vaste entreprise de construction narrative qui s’épanouit au VIIIe siècle, sous l’impulsion des pouvoirs politiques omeyyade puis abbasside. À défaut d’être une compilation, l’œuvre d’un Ibn Isḥāq est un acte créateur. Elle structure le temps (l’Hégire), définit les genres (la Sīra, biographie ; les maghāzī, récits militaires), et confère à Mahomet une épaisseur psychologique et théologique qui fera date. Mais cette grande fresque, comme le démontre Hela Ouardi dans une analyse aussi érudite que décapante, est une construction fragile, une « toile d’araignée » textuelle qui cache plus qu’elle ne révèle. Son chapitre sur les contradictions internes de la Sīra est une leçon de lecture critique. Les incohérences y abondent : la chronologie est chancelante, les motivations des personnages sont opaques, les événements clés comme la fuite de La Mecque ou la mort du Prophète se déclinent en versions irréconciliables. Car la Sīra n’est pas le reflet d’une vie, mais la superposition de plusieurs modèles littéraires hétérogènes : l’hagiographie chrétienne, avec son cortège de miracles, y côtoie l’épopée tribale préislamique et le roman dynastique. Deux figures incompatibles – le prophète mystique et le roi conquérant – y sont suturées l’une à l’autre. La Sīra n’est pas une source à valider ou invalider, mais une fiction politique rétrospective, un monument littéraire dont les fissures trahissent l’architecture idéologique.
Le prophète et ses doubles : de l’hérétique au héros des Lumières
Comment cette figure, déjà si complexe, a-t-elle été diffractée par le regard des autres ? Le Mahomet des historiens déploie un vaste panorama des perceptions, montrant que le Prophète fut, pour ses voisins comme pour ses adversaires, un miroir où se projetèrent obsessions et stratégies. Dans les textes de l’Antiquité tardive, chez les chrétiens d’Orient étudiés par Jean-Pierre Mahé ou Vincent Déroche, « l’islam » comme concept n’existe pas encore. Mahomet y est vu comme un hérésiarque parmi d’autres, ou un fléau divin punissant un Empire byzantin pécheur. Des personnages fascinants, telle la chimère théologique du moine Baḥīrā, naissent de ces contacts. Figure composite, il incarne la tentative des apologètes chrétiens d’annexer la prophétie islamique à leur propre tradition, tout en la disqualifiant comme une connaissance de seconde main. Théophane ou Jean Damascène fixeront pour des siècles les cadres de cette polémique savante.
L’Occident médiéval, ainsi que l’explore brillamment John Tolan, radicalise le portrait jusqu’à la caricature. Le « Mahumet » des chansons de geste devient une idole grotesque, un démon servi par une humanité bestiale. Mais cette diabolisation n’est pas qu’ignorance. C’est un instrument politique. Au sein même de la chrétienté, la figure de l’Antéchrist musulman devient une arme rhétorique redoutable lors des guerres de Religion : catholiques et protestants se renvoient l’accusation d’être les véritables disciples du faux prophète, transformant l’ennemi extérieur en un miroir infamant de leurs propres schismes. Il faudra attendre le Siècle des lumières, avec des penseurs comme John Toland, Henry Stubbe ou Voltaire, pour que Mahomet change de statut : le tyran devient un réformateur éclairé, le contempteur du cléricalisme, un champion du déisme. Parallèlement, l’approche philologique de savants comme Adriaan Reland ouvre la voie à une étude critique qui tente de comprendre l’islam depuis ses propres textes, entreprenant une déconstruction patiente des préjugés séculaires.
Entre mythe et critique : le tournant historiographique du Prophète
L’ouvrage ne s’arrête pas à cette histoire des représentations. Il est, en lui-même, un puissant manifeste historiographique. Le Mahomet qui y est dessiné n’est pas un homme, mais un objet de savoir, un carrefour de discours où se croisent la philologie, l’anthropologie, l’histoire des religions et l’analyse politique. L’enjeu est de taille : il s’agit de penser ce que l’histoire peut faire d’une figure fondatrice dont les récits de vie relèvent d’emblée du mythe, de la théologie et de l’enjeu politique. Cette problématique n’est pas propre à l’islam. Le parallèle avec la construction de la figure de Jésus ou du Bouddha est éclairant : dans les deux cas, nous sommes confrontés à un silence des sources contemporaines, suivi par l’éclosion de récits tardifs, pluriels, et souvent discordants, façonnés par les besoins de communautés en quête de légitimité. Le livre invite à comparer ces “vies” impossibles, non pour en relativiser la portée, mais pour mieux saisir les mécanismes universels de la fabrique des héros religieux.
Des hadiths à Charlie Hebdo : l’histoire au cœur du conflit
Surtout, ce projet historiographique affronte sans détour les aspects les plus sensibles. Il ne contourne pas le débat explosif sur la valeur historique des hadiths, ces milliers de dits et gestes attribués au Prophète qui forment la colonne vertébrale de la tradition sunnite. Le livre expose la méfiance des courants révisionnistes (issus de l’école de John Wansbrough, Patricia Crone, Michael Cook) qui, devant la nature tardive et souvent contradictoire de ce corpus, remettent en cause sa fiabilité, allant pour certains jusqu’à douter de l’historicité même du personnage. Sans trancher, l’ouvrage donne à voir la vivacité de ces controverses, montrant que « faire l’histoire de Mahomet » est un champ de bataille intellectuel où s’affrontent foi et raison critique. Cette tension traverse le monde contemporain : des caricatures danoises à l’affaire Charlie Hebdo, la figure de Mahomet est devenue l’épicentre de conflits sur la laïcité, la liberté d’expression et le sacré. En reconstituant la généalogie longue de ces tensions, Le Mahomet des historiens offre une profondeur de champ indispensable pour penser notre présent sans céder à la facilité de l’anachronisme ou à la violence de l’ignorance.
Le Mahomet des historiens, ou la fin des certitudes
Ce premier volume n’offre au lecteur aucune certitude rassurante sur ce que fut Mahomet. Au contraire, il le plonge dans un vertige salutaire. Il déconstruit les biographies pour en révéler les mécanismes de production ; il compare les récits pour en souligner les divergences ; il traque les silences pour en signifier la portée. Mais ce vertige n’est pas nihiliste. C’est un exercice de libération. En renonçant au fantasme d’une biographie définitive, on rend enfin à Mahomet sa véritable complexité, son irréductible opacité, la richesse des mondes qu’il a habités et qu’il continue d’habiter. Il n’est plus un personnage figé, mais un flux de représentations, une constellation de significations.
Ce livre est une aventure intellectuelle, une traversée des miroirs qui nous force à questionner nos propres certitudes sur l’histoire, la mémoire et la vérité. En cela, Le Mahomet des historiens n’est pas qu’un énième ouvrage sur l’islam ; c’est une leçon magistrale sur ce que signifie, aujourd’hui, faire de l’histoire. Non pas exhumer un passé mort, mais comprendre comment le présent ne cesse de le réinventer. Dans la chronique suivante, avec le second volume, nous verrons comment cette exploration élargit encore le champ de vision vers d’autres horizons, d’autres visages encore de ce prophète décidément insaisissable. Il y aura un avant et un après Le Mahomet des historiens : cette œuvre-phare ne clôt pas le débat sur le Prophète, elle le refonde entièrement, devenant ainsi la référence absolue pour quiconque veut saisir la genèse et la postérité d’une figure aussi essentielle qu’insaisissable.