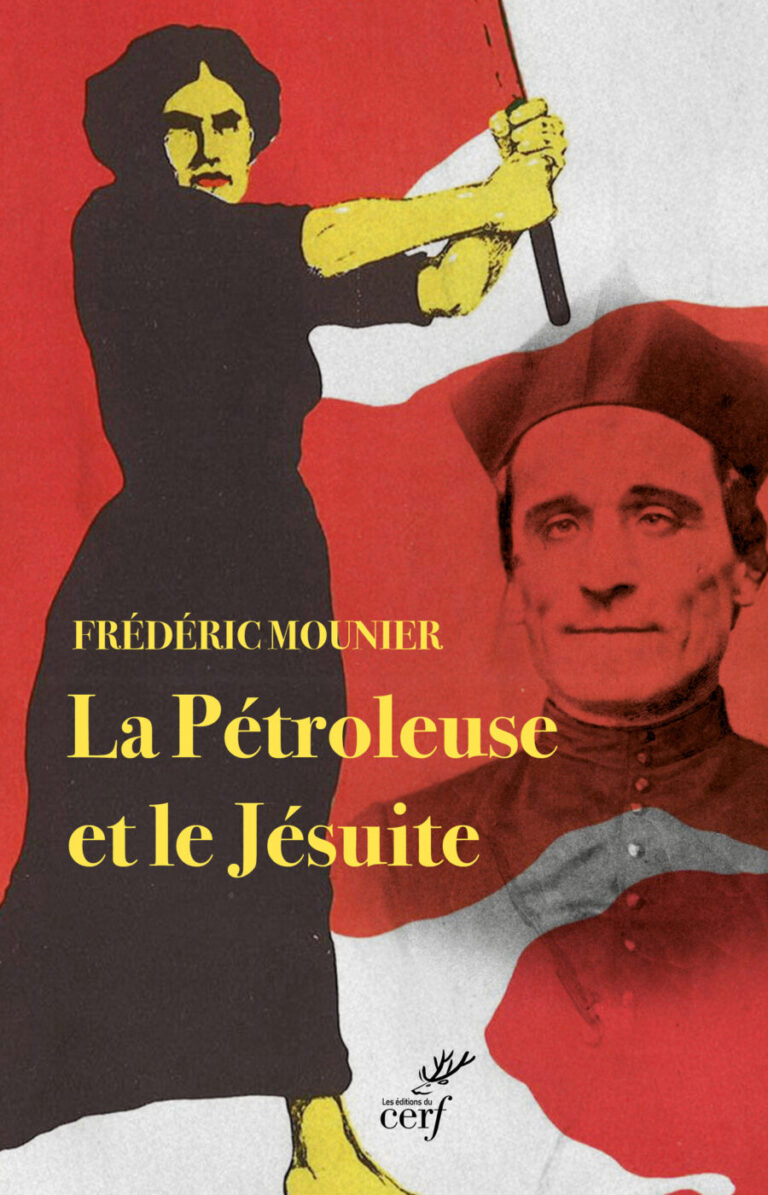Marie-Lucile Kubacki, Jésus en Mongolie, Éditions du Seuil, 07/02/2025, 212 pages, 21,00 €
Et si l’avenir du christianisme se dessinait, non pas dans les cathédrales séculaires d’Europe, mais sous les yourtes de Mongolie ? Dans Jésus en Mongolie, Marie-Lucile Kubacki nous emmène aux confins d’un monde où la foi se réinvente, vibrante et fragile, au contact du bouddhisme et du chamanisme. Loin des crises occidentales, une Église naissante, portée par des femmes résilientes et un cardinal inattendu, esquisse les contours d’une spiritualité nouvelle. Préparez-vous à un voyage saisissant, une plongée au cœur d’une réalité méconnue qui interroge nos certitudes – et notre propre quête de sens.
La nomination d’un cardinal et l’éveil d’une curiosité nuancée
L’élévation de Giorgio Marengo au cardinalat en 2022 a indéniablement suscité une onde de choc dans un paysage ecclésial occidental souvent préoccupé par ses propres enjeux. Cette nomination, emblématique d’un pontificat François soucieux des périphéries, invitait à s’interroger sur la réalité du catholicisme mongol, loin des centres de décision romains. Marie-Lucile Kubacki, journaliste et observatrice attentive des dynamiques religieuses, s’est lancée dans cette exploration avec une curiosité éclairée, consciente des simplifications possibles. Car la Mongolie, si elle évoque spontanément les horizons infinis et les figures épiques de l’histoire, est aussi une terre complexe, où les spiritualités ancestrales – bouddhisme et chamanisme – coexistent avec un christianisme encore jeune et fragile. L’auteure pressentait, à juste titre, que cette Église des marges pouvait offrir un éclairage pertinent, non pas nécessairement idyllique, mais assurément instructif, sur les défis contemporains du catholicisme. Le choix de ce sujet témoigne d’une volonté de saisir les nuances, les tensions, les aspérités d’une réalité ecclésiale souvent réduite à des images d’Épinal.
Un premier contact et la découverte d’une Église enracinée dans la précarité
Le récit de Marie-Lucile Kubacki nous plonge dans l’atmosphère contrastée d’Oulan-Bator, ville en pleine mutation où les symboles de la modernité côtoient les vestiges d’un passé nomade. C’est dans ce contexte urbain et rural composite que l’auteure rencontre les chrétiens de Mongolie, une minorité certes discrète, mais dont la présence – loin d’être anecdotique – interroge. Elle décrit des lieux de culte modestes, des visages marqués par les aléas de l’existence, des témoignages empreints d’une simplicité parfois déconcertante. On découvre une Église qui ne saurait rivaliser avec la puissance institutionnelle occidentale – ici, point de fastes, mais des communautés souvent dépendantes de soutiens extérieurs, des prêtres majoritairement étrangers, des fidèles laïcs dont l’engagement compense la faiblesse des moyens. L’ouvrage se construit alors comme un récit d’enquête, où les impressions personnelles de l’auteure se mêlent aux paroles recueillies, aux analyses contextuelles, esquissant un portrait réaliste, sans angélisme. “La pauvreté matérielle est une réalité quotidienne pour beaucoup de ces chrétiens” observe Marie-Lucile Kubacki, “et elle façonne inévitablement leur manière de vivre la foi.” Cette première constatation, loin de tout enchantement, constitue le point de départ d’une investigation plus approfondie, d’une tentative de comprendre comment la foi se déploie dans un tel contexte de dénuement.
Fragilité structurelle et dynamisme communautaire : un équilibre instable
Au fil des pages, le lecteur prend conscience de la fragilité structurelle de cette Église mongole – fragilité numérique, certes, mais aussi fragilité économique, fragilité logistique dans un pays immense et faiblement peuplé, fragilité culturelle face à des traditions spirituelles solidement ancrées. Pourtant, cette dernière ne signifie pas absence de dynamisme. L’auteure souligne avec justesse le rôle crucial des femmes, véritables actrices de la vie ecclésiale locale, investies dans l’animation des communautés, l’éducation religieuse, les initiatives caritatives. “Leur rôle est essentiel, non seulement en nombre, mais aussi en termes d’initiative et de persévérance,” souligne un missionnaire. Cette observation, loin de toute idéalisation, met en lumière une réalité souvent négligée – la force vive que représentent les femmes dans de nombreuses communautés chrétiennes, particulièrement dans les contextes minoritaires. Ainsi, dès cette première partie, se dessinent les contours d’une analyse plus complexe, qui dépasse la simple description pour interroger les dynamiques internes et externes qui façonnent cette Église mongole, sans céder à une vision unilatéralement positive.
Pauvreté et ferveur : une relation complexe et nuancée
L’œuvre de Marie-Lucile Kubacki évite toute simplification excessive et explore avec finesse la relation complexe entre pauvreté matérielle et ferveur religieuse au sein du catholicisme mongol. Si la pauvreté est une réalité prégnante, elle n’engendre pas mécaniquement une foi plus intense ou plus authentique. L’auteure nuance cette idée reçue en montrant que la précarité peut aussi être source de découragement, de tensions internes, de difficultés à maintenir un engagement constant. “Il y a une forme d’héroïsme quotidien dans la foi de ces chrétiens” tempère-t-elle, “mais il serait faux de croire que tout est simple et idyllique.” Cette lucidité, cette capacité à saisir les ambivalences, éloigne le récit de toute vision romantique et le rapproche d’une analyse sociologique et spirituelle plus pertinente. Marie-Lucile Kubacki met en lumière les stratégies de survie, les réseaux de solidarité, mais aussi les moments de doute, les interrogations face à l’adversité. Dans un monde occidental souvent fasciné par les images d’une foi dépouillée et “authentique” dans les pays pauvres, l’ouvrage offre une perspective plus réaliste, moins prompte à l’idéalisation, invitant à une solidarité concrète et éclairée, loin de toute condescendance.
Dialogue interreligieux et tensions culturelles : un équilibre fragile
La Mongolie, carrefour de spiritualités, est souvent présentée comme un modèle de dialogue interreligieux. L’ouvrage de Marie-Lucile Kubacki nuance cette vision en explorant les tensions, parfois latentes, parfois manifestes, entre christianisme et bouddhisme, mais aussi avec le chamanisme. Si le dialogue est une réalité, il ne va pas sans difficultés, sans malentendus, sans résistances. On découvre les défis de l’inculturation, les incompréhensions qui peuvent surgir face à des conceptions du monde et des pratiques religieuses très différentes. Cette tension entre ouverture et fidélité, entre dialogue et identité, est au cœur de l’expérience chrétienne en Mongolie. L’ouvrage met en lumière les efforts déployés pour construire des ponts, mais aussi les obstacles qui persistent, les limites du dialogue, la nécessité d’une patience et d’une humilité constantes. Dans un monde où le dialogue interreligieux est souvent érigé en dogme, mais rarement analysé dans sa complexité, le récit de Marie-Lucile Kubacki offre une perspective réaliste et stimulante, invitant à dépasser les simplifications et les illusions. Il est crucial de rappeler ici, comme le souligne l’ouvrage, que le contexte post-communiste mongol a vu une reconstruction identitaire forte autour de figures comme Gengis Khan et du bouddhisme, ce qui peut complexifier l’intégration du christianisme, perçu parfois comme une religion étrangère.
Résilience et adaptation : la mission à l’épreuve du terrain
Le récit de Marie-Lucile Kubacki met en lumière la résilience des chrétiens mongols, mais aussi, et c’est un point important, les difficultés d’adaptation rencontrées par les missionnaires. L’ouvrage décrit les tâtonnements, les erreurs, les moments de découragement, les impasses. “La mission en Mongolie est une école d’humilité,” confie un prêtre étranger. Cette humilité, cette conscience des limites, transparaissent dans le récit de Marie-Lucile Kubacki. Elle évoque les défis linguistiques, culturels, climatiques, logistiques, mais aussi les difficultés relationnelles, les incompréhensions avec les populations locales, les tensions au sein des communautés missionnaires. Il ne s’agit pas de masquer ces difficultés ; l’auteure les met en lumière, montrant que la mission n’est pas un long fleuve tranquille, mais une aventure humaine complexe, faite de joies et de peines, de réussites et d’échecs. Cette honnêteté, cette absence de complaisance, donnent une profondeur et une crédibilité au récit, éloignant toute tentation d’idéalisation. La persévérance des missionnaires, leur capacité à s’adapter malgré les obstacles, apparaissent d’autant plus admirables qu’elles sont présentées sans fard, dans leur réalité humaine et fragile.
Un révélateur des défis du catholicisme contemporain, plus qu’un modèle
L’ouvrage de Marie-Lucile Kubacki, en explorant la réalité de l’Église de Mongolie, ne prétend pas offrir un modèle à suivre pour le catholicisme mondial. Il s’agit plutôt d’un révélateur, un miroir grossissant des défis et des tensions qui traversent l’ensemble de l’Église. Face à la crise occidentale, il serait illusoire de transposer mécaniquement des solutions venues d’un contexte aussi différent. L’exemple mongol, avec sa simplicité, son dynamisme communautaire, peut certes inspirer, mais il ne saurait constituer une recette miracle. “Il faut éviter de céder à la tentation de l’exotisme ou de la projection” met en garde l’auteure, “l’Église de Mongolie a ses propres spécificités, ses propres fragilités.” Cette prudence, cette distance critique, éloignent le récit de toute récupération idéologique et le rapprochent d’une analyse lucide et pertinente. L’internationalisation du Collège cardinalice, dont témoigne la nomination de Giorgio Marengo, est un signe encourageant, mais elle ne saurait suffire à résoudre les problèmes profonds du catholicisme occidental. L’enjeu est plutôt de s’inspirer de l’esprit d’adaptation, de la créativité, de la persévérance dont font preuve les chrétiens de Mongolie, tout en restant attentif aux spécificités de chaque contexte local.
En quête de sens dans un monde pluriel et désenchanté
Au-delà du cas mongol, l’ouvrage de Marie-Lucile Kubacki interroge la quête de sens dans un monde globalisé, pluriel et souvent désenchanté. Dans nos sociétés occidentales, marquées par la sécularisation, l’individualisme, la crise des institutions, la soif de spiritualité demeure, mais elle s’exprime de manière diversifiée, parfois paradoxale. Le témoignage des chrétiens de Mongolie, avec leur foi ancrée dans le quotidien, leur capacité à vivre en minorité, leur ouverture au dialogue interreligieux, peut résonner avec ces interrogations contemporaines, offrir des pistes de réflexion, susciter un questionnement personnel.
En refermant Jésus en Mongolie, le lecteur est invité à dépasser une vision simpliste et idéalisée du catholicisme périphérique. L’ouvrage de Marie-Lucile Kubacki, par sa qualité d’écriture, sa rigueur d’enquête, sa finesse d’analyse, laisse une empreinte, un appel à un regard plus complexe et plus nuancé sur les réalités ecclésiales du monde. L’auteure évite les jugements hâtifs, les généralisations abusives, privilégiant la description précise, l’analyse contextuelle, la prise en compte des contradictions et des ambivalences. Elle ne cherche pas à ériger l’Église de Mongolie en modèle, mais à en faire un objet d’étude pertinent, un révélateur des enjeux contemporains du catholicisme, un stimulant pour la réflexion et le dialogue. En cela, Jésus en Mongolie est une lecture précieuse, particulièrement dans un contexte où les simplifications et les oppositions manichéennes tendent à dominer le débat public. C’est un livre qui éclaire, qui interroge, qui invite à un discernement plus fin, plus respectueux des complexités du réel.