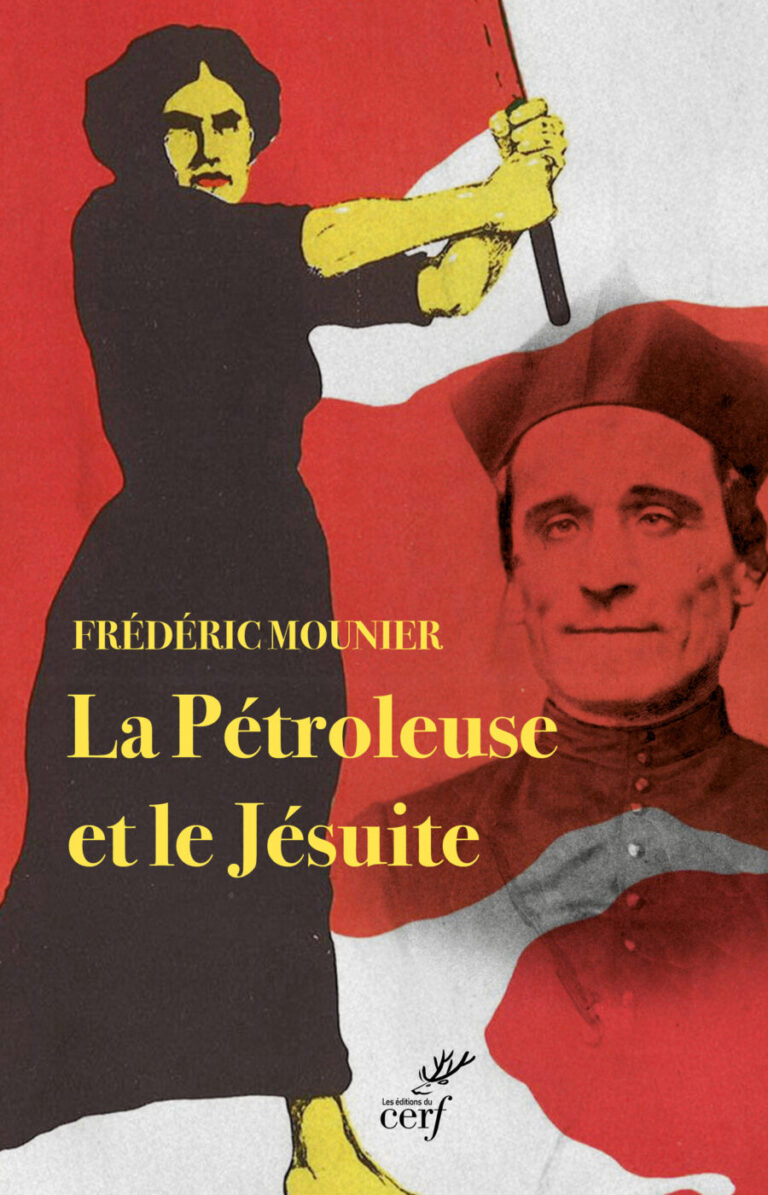Ahmed Fouad Bouras, Les béliers, Éditions Emmanuelle Collas, 07/03/2025, 315 pages, 21,90€
Imaginez un théâtre où se joueraient simultanément un drame shakespearien, une farce de Feydeau et un documentaire anthropologique sur l’Algérie contemporaine. Tel nous apparaît Les béliers, premier roman d’Ahmed Fouad Bouras qui, sous les allures d’une fresque familiale éclatée, dissèque avec une acuité redoutable les contradictions d’une société prise entre ses traditions et ses modernités, ses rituels et ses trafics, ses silences et ses explosions.
L’architecture symphonique d’un chaos organisé
L’auteur Bouras construit son récit comme une partition musicale complexe où cinq voix s’entremêlent, se répondent et parfois se heurtent. Chaque partie porte le nom d’un personnage – Mourinho vs Ghorbatchev, Ouahab, Abderrahmane, Rahma, puis tous réunis “Vers le levant” – créant une polyphonie narrative, une structure n’est jamais artificielle : elle mime les combats de béliers eux-mêmes, où chaque protagoniste a son tour de piste, sa charge, son moment de gloire ou de chute. Tantôt nous suivons Ouahab dans sa découverte déconcertante de l’Algérie paternelle, tantôt nous plongeons dans les combines d’Abderrahmane, pour ensuite épouser le regard déterminé de Rahma. Cette technique permet au romancier d’explorer chaque facette de son microcosme social sans jamais imposer sa vision. Le lecteur devient lui-même spectateur d’un combat, penché au-dessus de l’arène familiale.
Les langues qui se battent, les silences qui prient
Dans cet ouvrage singulier, l’argot de banlieue côtoie l’arabe dialectal, le français administratif se mélange aux grossièretés en darija. Cette polyphonie linguistique n’est pas gratuite : elle dessine les contours d’identités fracturées, d’appartenances multiples et contradictoires. Quand Ouahab, lors d’un épisode de Tourette dans une mosquée, mélange insultes en arabe et excuses en français, c’est toute la schizophrénie post-coloniale qui s’exprime. L’auteur révèle ici une connaissance intime des mécanismes du syndrome de Gilles de la Tourette, qu’il transforme en allégorie puissante. Mais au-delà de la métaphore sociale, il explore la dimension spirituelle de ce handicap. La trajectoire religieuse d’Ouahab – ses tentatives répétées pour se rapprocher de la foi, ses prières solitaires apaisantes, puis sa brutale expulsion de la mosquée – constitue l’un des fils les plus poignants du roman. Cette exclusion de l’espace sacré à cause de ses tics involontaires révèle la violence symbolique d’une communauté qui prêche l’inclusion mais pratique le rejet. Ahmed Fouad Bouras ne tombe jamais dans le sentimentalisme : il montre comment la religion peut être à la fois refuge et source d’exclusion, comment elle promet la paix à ceux qu’elle rejette ensuite au nom de sa propre tranquillité.
Rahma, ou la rébellion silencieuse dans un monde de mâles
Si les hommes du roman se battent – littéralement, avec leurs moutons ; symboliquement, avec leur héritage –, Rahma incarne une forme de résistance plus subtile. Divorcée d’un schizophrène, revenue au foyer familial, elle prend progressivement les rênes de l’entreprise familiale. L’auteur évite soigneusement le piège du féminisme démonstratif : Rahma ne revendique rien, elle agit. Elle apprend la comptabilité, conduit, négocie avec les abattoirs, rêve même de légaliser les combats de béliers. Son personnage cristallise toutes les contradictions du Maghreb contemporain : entre émancipation et soumission, modernité et tradition, pragmatisme et idéalisme. Sa relation avec les rituels – notamment sa tentative adolescente d’accomplir le sacrifice de l’Aïd, brutalement interrompue par son père – révèle sa volonté de réappropriation des codes masculins. Quand elle finira par accomplir le geste ultime – celui que son père lui avait interdit –, ce sera dans une scène d’une intensité dramatique saisissante.
Une écriture de tous les registres, une voix singulière
Ahmed Fouad Bouras possède cette rare qualité d’être à l’aise dans tous les registres : du burlesque (les péripéties de Zoheir tentant d’émigrer clandestinement vers l’Italie… pour finir à Arzew) au tragique (l’agonie de Mourinho), du lyrique (les descriptions de la steppe algérienne) au trivial (les combines d’Abderrahmane). Son style épouse les humeurs de ses personnages, alternant entre la violence des tics d’Ouahab et la précision calculatrice des manigances de Rahma. Cette versatilité sert un projet ambitieux : donner à voir l’Algérie dans toute sa complexité, entre tradition et corruption, dévotion et trafics. Bouras écrit depuis l’intérieur, avec la connaissance intime de celui qui maîtrise les codes des deux rives de la Méditerranée.
La violence comme langage, le sacrifice comme révélation
Violence physique des combats, violence symbolique des traditions, violence sociale de l’exclusion : le roman en explore toutes les déclinaisons. Mais Ahmed Fouad Bouras évite l’écueil du misérabilisme en montrant comment ses personnages restent acteurs, même dans l’adversité. La religion elle-même devient territoire de lutte : entre ceux qui l’instrumentalisent (le marabout charlatan) et ceux qui la cherchent sincèrement (Ouahab), entre les rituels vidés de leur sens (les combats mercantiles) et ceux qui retrouvent leur dimension sacrée (le sacrifice final de Rahma). La scène finale du combat entre Mourinho et Ghorbatchev concentre toutes ces violences en un crescendo où l’issue sportive importe moins que ce qu’elle révèle des rapports humains. Le sang qui coule porte en lui toute l’histoire familiale, toutes les exclusions, toutes les tentatives de rédemption avortées.
Ahmed Fouad Bouras signe un premier roman d’une maturité impressionnante. Sa polyphonie narrative, sa sensibilité aux questions spirituelles, sa connaissance des codes sociaux font de Les béliers bien plus qu’une chronique familiale : un portrait saisissant de l’Algérie contemporaine, où se négocient en permanence les frontières entre le sacré et le profane, l’héritage et la trahison, l’appartenance et l’exclusion.