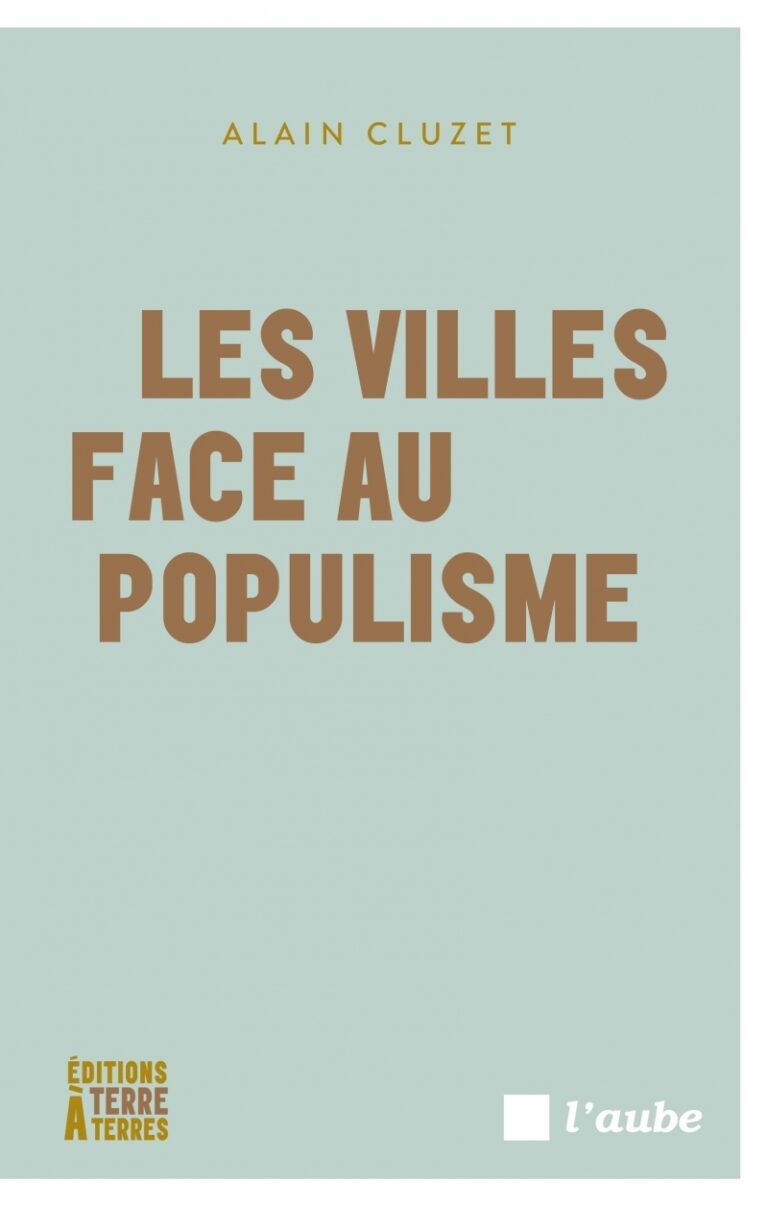Gérard Mordillat, Les Vivants et les Morts, vingt ans plus tard, Calmann-Levy, 02/01/2025, 520 pages, 22,90€
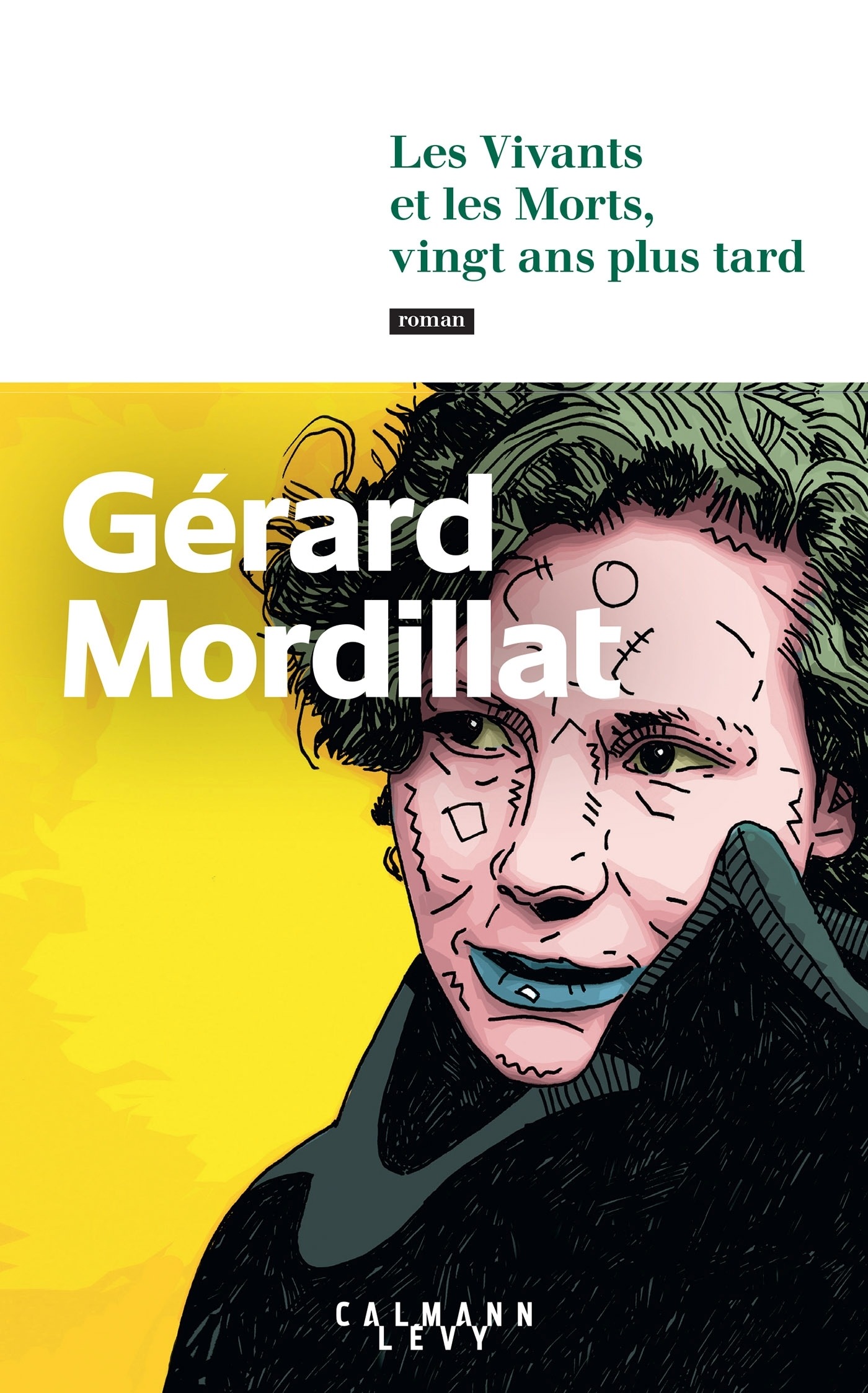
Dans Les Vivants et les Morts vingt ans plus tard, Gérard Mordillat nous entraîne à Raussel, une ville figée dans la neige et le désespoir. À travers le parcours de Dallas, il explore les cicatrices invisibles laissées par l’effondrement social et les luttes ouvrières passées. Ce roman, à la fois intime et universel, interroge notre capacité à survivre aux pertes, aux absences et à la mémoire effacée.
Gérard Mordillat : une œuvre fidèle à la classe ouvrière et aux humiliés
Il y a des écrivains dont l’œuvre entière semble animée par une fidélité indéfectible à une cause, à une humanité. Gérard Mordillat appartient à cette lignée. Son regard, depuis ses premiers écrits, se tourne vers ceux que l’histoire met de côté, les vies modestes que les mécanismes économiques ignorent ou écrasent. Vingt ans après Les Vivants et les Morts, ce roman-fleuve qui avait saisi avec force la chronique d’une lutte ouvrière désespérée à l’usine Kos, il nous ramène à Raussel, cette petite ville devenue emblématique d’une France désindustrialisée. Les Vivants et les Morts, vingt ans plus tard n’est pas une continuation ; c’est une exploration archéologique des souvenirs et des blessures, une méditation sur ce qui reste quand le feu de la lutte s’est éteint et que les cendres recouvrent le paysage social et intime. L’engagement de Gérard Mordillat, toujours palpable, interroge ici la fragilité de la mémoire collective et la difficulté de transmettre l’héritage des combats dans un présent qui semble avoir anesthésié ses propres racines ouvrières.
La lente mort de Raussel : cadre d’un monde ouvrier broyé
Raussel, deux décennies après le cataclysme de la fermeture de la Kos, est une ville à l’agonie. La neige omniprésente qui l’ensevelit dès l’ouverture du roman agit comme un linceul symbolique, métaphore de l’oubli et de la paralysie qui ont saisi la communauté. Dallas, revenue au chevet d’un père à l’article de la mort, arpente un paysage méconnaissable, un « long tunnel blanc » où les repères d’autrefois ont disparu. Les commerces ont baissé le rideau, les maisons affichent des panneaux “À vendre”, le cinéma Kursaal est une coquille vide. Le départ du docteur Kops, figure tutélaire, et l’arrivée d’une municipalité RN achèvent de peindre le tableau d’une désertification qui ronge le cœur de la ville. Raussel incarne ces territoires sacrifiés sur l’autel de la mondialisation, où la fin de l’usine a signifié non seulement la perte des emplois, mais aussi la désintégration d’une identité collective. Le décor n’est donc pas accessoire ; il est le reflet tangible de la décomposition sociale et de la perte de sens qui affectent ses habitants.
Raussel, deux décennies après le cataclysme de la fermeture de la Kos, est une ville à l’agonie. La neige omniprésente qui l’ensevelit dès l’ouverture du roman agit comme un linceul symbolique, métaphore de l’oubli et de la paralysie qui ont saisi la communauté. Dallas, revenue au chevet d’un père à l’article de la mort, arpente un paysage méconnaissable, un « long tunnel blanc » où les repères d’autrefois ont disparu. Les commerces ont baissé le rideau, les maisons affichent des panneaux “À vendre”, le cinéma Kursaal est une coquille vide. Le départ du docteur Kops, figure tutélaire, et l’arrivée d’une municipalité RN achèvent de peindre le tableau d’une désertification qui ronge le cœur de la ville. Raussel incarne ces territoires sacrifiés sur l’autel de la mondialisation, où la fin de l’usine a signifié non seulement la perte des emplois, mais aussi la désintégration d’une identité collective. Le décor n’est donc pas accessoire ; il est le reflet tangible de la décomposition sociale et de la perte de sens qui affectent ses habitants.
La mémoire des luttes
L’agonie de Raussel est la conséquence directe de l’effacement de son passé militant. La fermeture de la Kos a pulvérisé le cœur économique et social de la ville. Vingt ans plus tard, les anciens de l’usine sont des spectres dispersés : morts, partis, ou survivant dans la précarité. Le café L’Espérance, tenu par la veuve Raymonde, est le dernier îlot d’une sociabilité ouvrière en voie de disparition, dans une ville où « Tout a l’air mort ». La mémoire vibrante de la grève, des piquets, des espoirs et des colères semble s’être dissoute. L’implantation de Property, cathédrale glacée de l’e-commerce, et l’élection d’un maire RN actent la victoire d’un nouveau monde où la logique du flux et de la performance individuelle a remplacé la solidarité de classe. Raussel est un mémorial involontaire, un lieu hanté par un passé industriel et combatif qui peine à dialoguer avec un présent désenchanté.
Le roman pose une question cruciale : comment transmettre l’histoire des luttes quand le présent semble organiser l’amnésie ? Henri Thaler, le père de Dallas, ancien syndicaliste, choisit, à l’heure de sa mort, de léguer à sa fille, non pas le flambeau de ses engagements, mais le fardeau d’un secret intime, celui d’un amour clandestin. Ce geste, déroutant pour Dallas, souligne la difficulté de maintenir la continuité politique lorsque les structures collectives s’effondrent et que les drames personnels prennent le dessus. Dallas, lors de l’enterrement, tente pourtant de renouer les fils : « Garder la mémoire de ses combats, c’est garder la mémoire de sa vie… » Mais sa voix semble isolée. La figure de Maxime Lorquin, fils de l’emblématique Blek le Roc, devenu directeur de Property, incarne douloureusement cette rupture générationnelle et idéologique. La chaîne de la transmission politique et familiale apparaît fragilisée, menacée par l’oubli et le cynisme ambiant.
La disparition de l’individu
Au centre névralgique du récit palpite l’absence d’Ève, la fille de Dallas et de Rudi, disparue deux ans auparavant. Fugue d’adolescente ? Rapt crapuleux ? Enrôlement dans une cause radicale ? Le mystère demeure, obsédant, creusant un vide abyssal dans la vie de ses parents. Dallas vit avec ce fantôme, scrutant les visages, imaginant les pires scénarios : « Est-elle vivante ? A-t-elle été assassinée ? » Gérard Mordillat explore avec une justesse remarquable l’angoisse parentale, ce trou noir de l’attente et de l’incertitude qui paralyse le désir et la capacité à vivre. L’absence d’Ève la transforme en une figure presque allégorique, catalyseur des peurs contemporaines, symbole d’une jeunesse dont le destin semble incertain, voire sacrifié. L’auteur refuse toute résolution facile, laissant le lecteur face à l’énigme, reflet de l’opacité du réel.
La disparition individuelle d’Ève entre en résonance avec une disparition plus large, sociale et politique : celle des classes populaires. L’épigraphe de Venaille (« À jamais différent de ceux pourvus de tout. ») annonce cette thématique. Les anciens de la Kos, comme Dallas et Rudi, sont devenus des travailleurs précaires, exilés de leur propre histoire, jonglant avec les petits boulots et l’angoisse du lendemain. Leur parcours illustre le sort de millions d’individus rendus invisibles par un système qui les marginalise ou les exploite. L’entrepôt Property, avec son organisation taylorienne poussée à l’extrême, ses employés réduits à des matricules et ses cadences déshumanisantes, représente cette nouvelle forme d’aliénation du capitalisme de plateforme. La disparition d’Ève devient ainsi la métaphore de l’effacement des “gens de peu”, de ceux dont la voix et l’existence sont niées par les logiques dominantes.
La résilience et l’attente
Comment tenir debout quand tout s’effondre ? Le roman explore, sans illusions mais avec une tendresse certaine, les ressorts de la résilience. L’amour entre Dallas et Rudi, bien que meurtri par le drame et les secrets, demeure un point d’ancrage, une braise sous la cendre que Rudi tente de ranimer (« Faire l’amour… […] la seule façon de chasser tous les secrets. ») La solidarité, si elle s’est effritée avec la fin de la Kos, se recompose autrement, notamment à travers les liens entre femmes : Florence la journaliste fidèle, Rachel et les Glottes Rebelles, Muriel la sœur retrouvée. Le chant collectif, particulièrement les chants révolutionnaires, devient un acte de résistance symbolique, une manière de conjurer le désespoir. La reconstruction collective du café L’Espérance après l’incendie criminel incarne cette volonté farouche de ne pas céder à la ruine, de rebâtir du lien social et culturel là où certains voudraient ne voir que décombres.
Le récit est traversé par une tension constante entre la lucidité face à la défaite et une forme d’espérance obstinée. La déréliction de Raussel, l’énigme Ève, la violence sociale et la montée de l’extrême droite dessinent un horizon sombre. La figure de Raymonde, sombrant dans l’apathie après l’incendie de son café, illustre ce risque de l’effondrement total. Cependant, des forces contraires persistent. Le retour de Dallas, son engagement syndical chez Property, l’irruption de Muriel, la mobilisation pour L’Espérance sont autant de signes que la résignation n’a pas totalement gagné. Mordillat ne propose aucune issue facile, mais il suggère que la dignité se conquiert dans la lutte, l’amitié et la fidélité aux siens, même lorsque la victoire semble hors de portée.
Absence et fidélité au cœur du même tissu romanesque
La réussite de Les Vivants et les Morts, vingt ans plus tard tient à cette manière subtile dont Gérard Mordillat entrelace les fils de l’intime et du politique. La disparition d’Ève n’est pas une simple intrigue psychologique ; elle est le symptôme d’une désintégration plus vaste, celle du monde ouvrier de Raussel. La quête éperdue de Dallas pour retrouver sa fille se double de sa lutte pour la mémoire des anciens de la Kos et contre l’exploitation chez Property. Le secret tardif d’Henri révèle moins une trahison qu’une blessure intime, montrant la complexité des êtres derrière les rôles sociaux. La fidélité – à un amour passé, à une enfant absente, à des camarades de lutte, à une amitié sororale – traverse le roman comme une colonne vertébrale, donnant aux personnages la force de résister à la désintégration. La lutte, chez Gérard Mordillat, n’est jamais désincarnée ; elle prend corps dans les affects, dans la persistance des liens, dans la capacité à rester fidèle à ce qui nous fonde.
Avec une écriture économe, précise, qui évite l’écueil du sentimentalisme tout en étant chargée d’une profonde empathie, Gérard Mordillat donne voix à ses personnages. Il capte les inflexions de la langue parlée, la densité des silences, la violence sourde des rapports sociaux. La structure polyphonique, déjà à l’œuvre dans le premier volume, permet de croiser les regards, d’orchestrer les échos entre les différentes strates de l’histoire et de la mémoire. L’intime – la douleur de l’absence, les secrets de famille, les amours contrariées – et le collectif – la désindustrialisation, la précarité, la montée des extrêmes, le combat syndical – sont indissociables, s’éclairant l’un l’autre. En revenant sur les traces des vivants et des morts de Raussel, Gérard Mordillat ne fait pas œuvre de nostalgie. Il pose, avec une acuité renouvelée, la question de la possibilité de la lutte et de la solidarité dans un paysage social et politique métamorphosé, où les fantômes du passé continuent d’interpeller les vivants. Un roman nécessaire, qui refuse les consolations faciles et affirme la beauté âpre de la résistance.