Franck Gérard, Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert, Éditions du Jasmin, 10/09/2025, 226 pages, 18 €
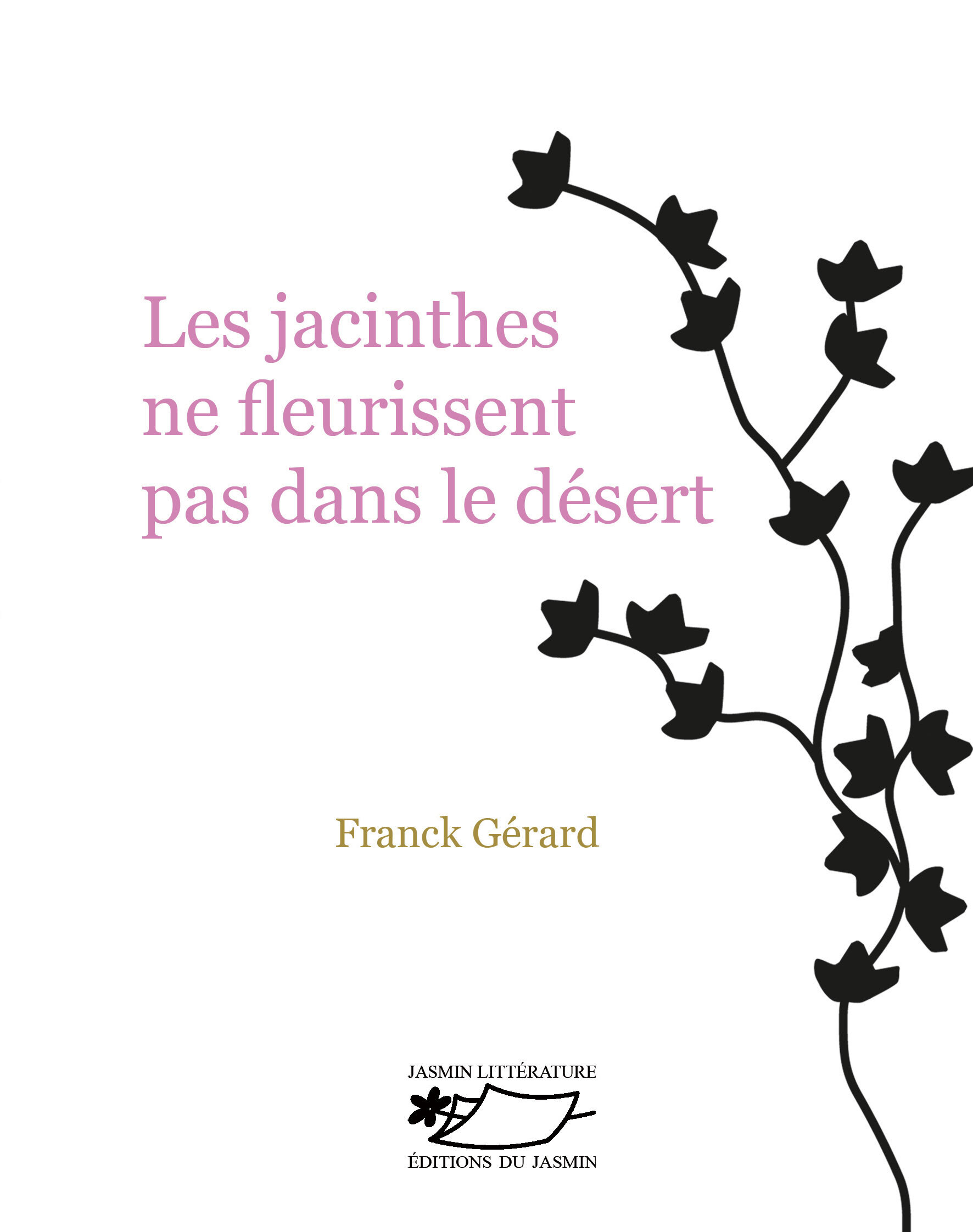
Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert, premier roman de Franck Gérard qui vient de paraître aux Éditions du Jasmin, s’ouvre sur un rituel ancestral au pied du djebel Marra, au Darfour soudanais. Nous sommes en 1998. Un mouton sera sacrifié pour honorer les manda, ces ancêtres-génies qui veillent sur le peuple zaghawa. Omanda, neuf ans, reçoit sa première jallabiya traditionnelle : « mon fils, que cette étoffe t’accompagne tout au long de ta destinée ». Ce tissu blanc, symbole de transmission et de mémoire, traversera le roman comme une peau de plus en plus sale, de plus en plus lourde, jusqu’à devenir linceul d’une enfance arrachée. Car cinq ans plus tard, les milices Janjawids investissent le village de nuit, incendient les cases, égorgent les hommes, violent les femmes, enlèvent les enfants. Omanda assiste, impuissant, à la mort de son père et à l’enlèvement de sa petite sœur Hawa. Il ne lui reste qu’une poupée de chiffons ornée de perles multicolores, dérisoire amulette qu’il serrera contre lui durant tout son exil.
Ce que raconte Franck Gérard, archéologue et grand voyageur, lauréat du concours national d’écriture organisé par le magazine Lire en 2024, c’est le destin brisé d’un enfant devenu fantôme de lui-même, contraint à une errance sans fin : du Darfour au Tchad (camp de réfugiés de Farchana), puis en Libye (Al-Koufrah, Benghazi), jusqu’aux eaux noires de la Méditerranée. Omanda et son ami Jassim fuient, mais ils poursuivent surtout, car « un Zaghawa apprend à affronter, il n’abandonne pas, jamais ! » Leur odyssée traverse les décombres de trois guerres : celle du Darfour (2003-2010), celle du Tchad oriental (tensions transfrontalières), celle de Libye (révolution de 2011). Le roman embrasse ainsi vingt années d’histoire récente, des conflits qui ont fait basculer des millions de vies dans l’anonymat des statistiques.
La langue de Franck Gérard possède une qualité rare : elle refuse la distance. Son écriture épouse la peau de ses personnages, leur respiration, leur soif, leur vertige. Les phrases se font longues, cumulatives, lorsqu’il s’agit de décrire les traversées du désert, puis se resserrent, sèches comme des coups de fouet, lorsque survient la violence. Les dialogues sont rares, souvent interrompus par le silence ou la peur, ce qui confère au récit une tension sourde, une respiration hachée. L’auteur use avec finesse de l’arabe et des dialectes locaux (manda, wadi, jallabiya, ibeid…), qui ponctuent le texte comme autant de repères identitaires, de balises culturelles que l’exil efface progressivement. Le glossaire en fin d’ouvrage témoigne de cette volonté de faire entendre une langue autre, de restituer la polyphonie des peuples en transit.
Le rythme du roman épouse celui de l’errance : tantôt accéléré (les attaques, les fuites, les traversées en camion), tantôt suspendu dans l’attente (les camps, les barrages, les files d’attente pour l’eau ou le travail). Gérard sait dilater le temps : une journée de marche dans le désert s’étire sur plusieurs pages, tandis qu’une année au camp de Farchana se condense en quelques paragraphes. Cette élasticité temporelle restitue l’expérience même du déplacement forcé, où l’urgence alterne avec l’immobilité, où chaque minute peut être la dernière ou une éternité vide. Les descriptions sensorielles – la chaleur écrasante du Sahara, l’odeur de la viande grillée lors de l’Aïd, la fraîcheur des ablutions matinales, la puanteur des cadavres – ancrent le lecteur dans une matérialité brute, loin de toute abstraction misérabiliste.
Au cœur du roman, deux objets circulent comme des reliques : la poupée de Hawa et le tapis de prière. La première incarne la mémoire familiale, l’espoir ténu de retrouver un jour la petite sœur disparue ; le second, offert par Ali, le vieux cordonnier d’El-Geneina, figure la foi comme seul rempart contre le désespoir. Omanda prie, sans cesse, parfois par automatisme, parfois avec ferveur. Les cinq prières quotidiennes (salât al-fajr, al-asr, al-maghrib…) scandent le récit, offrent une architecture spirituelle au chaos. Mais la foi ici demeure ambiguë, tiraillée entre gratitude (Alhamdou lillah) et interrogation muette : pourquoi Dieu laisse-t-il les hommes s’entre-tuer ? Pourquoi les Janjawids, qui invoquent Allah avant d’égorger, sont-ils impunis ?
Le racisme anti-Noirs, fil rouge du roman, prend des formes multiples : au Soudan, les milices arabes traitent les Zaghawas de zurga (« nègres ») et d’ibeid (« esclaves ») ; au Tchad, les tensions montent entre réfugiés et populations locales ; en Libye, les migrants subsahariens deviennent boucs émissaires, accusés d’être des « mercenaires de Kadhafi », violentés, lynchés. Franck Gérard montre avec une précision documentaire comment le corps noir devient marchandise, monnaie d’échange, cible. Omanda et Jassim survivent en se faisant invisibles, en courbant l’échine, en acceptant les pires humiliations. Leur dignité résiste pourtant, dans les gestes du quotidien : réparer une chaussure, nourrir un troupeau, partager un verre de thé.
L’amitié entre Omanda et Jassim – qui traverse tout le roman jusqu’à leur séparation finale, avant l’embarquement vers l’Europe – constitue le socle affectif du récit. Jassim, orphelin, plus audacieux, protège Omanda ; Omanda, hanté par la perte de Hawa, offre en retour une forme de fraternité mélancolique. Leur complicité silencieuse dit l’impossibilité de parler vraiment de ce qu’on a vécu, de nommer l’horreur. Les mots manquent, ou bien ils se dissolvent dans les formules rituelles : Incha’Allah, Bismillah, Allahou akbar. La langue de la survie devient langue de l’effacement.
La préface de Jérôme Tubiana, chercheur spécialiste du Soudan, ancre le roman dans une réalité politique brûlante : la complicité de l’Union européenne avec les régimes autoritaires du Sahel et de Libye, les accords de contrôle migratoire qui transforment ces pays en geôles à ciel ouvert, le « deux poids, deux mesures » entre réfugiés ukrainiens et africains. Cette dimension documentaire enrichit la lecture sans alourdir la fiction. L’auteur a fait le choix d’un récit sobre, pudique, qui refuse le spectaculaire. Les scènes de violence sont brèves, souvent elliptiques ; les corps morts apparaissent comme des silhouettes floues dans la poussière. Ce parti pris esthétique rend la douleur plus palpable, car elle est suggérée, infiltrée dans les détails : une trace de sang sur le sable, un bêlement de mouton égorgé, un corps qui s’effondre hors champ.
Le titre, Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert, porte une double signification : il dit l’impossibilité de l’enracinement (les jacinthes, fleurs délicates, périssent dans l’aridité), mais aussi l’impossibilité du retour (le village d’Hashaba renaît au Tchad, mais ce n’est qu’un simulacre, un jardin artificiel planté dans le sable). L’exil détruit la mémoire des lieux, efface les repères. Omanda finit par oublier le visage de sa mère, le goût des plats de son enfance, la forme exacte de son village. Il ne lui reste que la poupée, objet fétiche usé jusqu’à la corde, dont les perles se détachent une à une, comme les souvenirs.
Ce premier roman de Franck Gérard s’inscrit dans une lignée littéraire exigeante, celle des récits d’exil qui incarnent une attention scrupuleuse au réel. Il donne voix à ceux que l’Histoire broie, à ces milliers d’Omanda dont les noms figurent sur aucun registre. En refermant le livre, on songe à cette phrase de Marie-José Tubiana citée en exergue : « Ils ne viennent pas en Europe pour des raisons économiques, mais parce qu’ils ont fui une situation qui leur était devenue insupportable ». Le roman de Franck Gérard fait de cette vérité politique une évidence sensible, incarnée, inoubliable.
















