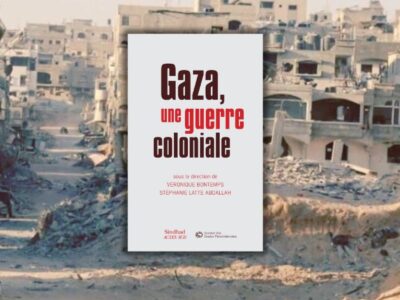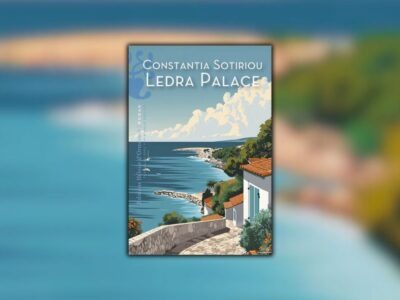Franck Pavloff, L’Hôtel du Rayon Vert, Albin Michel, 22/08/2024, 240p, 20,90 €.
Pour quiconque emprunte la côte frontalière franco-espagnole, la bâtisse surgit comme un immense éperon rocheux. Impossible de la manquer.
Vestige, restauré aujourd’hui de la Belle Epoque, l’hôtel du Rayon Vert « fiché comme un Titanic au cœur de la gare » est l’image symbole de la cité balnéaire de Cerbère. Le creuset du dernier roman de Franck Pavloff, dont l’intrigue à tiroir n’a d’égale que la limpidité du style. Lieu emblématique de cette région du Cap Béar, l’hôtel va ainsi devenir l’épicentre de toute une faune hétéroclite. A commencer par une photographe spécialiste de l’Art déco qui va trouver là matière à sublimer cette structure au charme rétro, tel que le relate l’auteur.
À demi allongée sur la rambarde, appareil en main, elle cadre l'agencement magique des alvéoles, comme si elle voulait décrocher des rayons de miel. Elle vient de trouver le détail qui définit le mieux l'hôtel insolite, le Rayon Vert était une ruche bourdonnante.
C’est le premier des personnages atypiques fascinés par la singularité du lieu à entrer en lice. Car par sa position au plein sud de l’Hexagone, ce village frontière, carrefour de langue et d’histoire, est source de biens autres attraits. Ne serait-ce que par sa gare, longtemps point de connexion névralgique entre la France et l’Espagne, qui recèle tout un lot d’exotisme et de drames.
Celles des transbordeuses d’orange tout d’abord, ces femmes qui à cause de l’écartement des essieux, s’échinèrent à transvaser des cargaisons de fruits d’un train de marchandises à l’orée du siècle dernier. Celle ensuite tout aussi crépusculaire, des événements relatifs à la guerre civile espagnole. Et à la Retirada qui s’ensuivit pour nombre de Républicains espagnols contraints de fuir leur pays lors du rude hiver de 1939.
En mémoire de Machado
C’est là, dans un wagon pullman désaffecté que l’un des plus célèbres d’entre eux, Antonio Machado a passé une de ses dernières nuits. Un souvenir que des résidents locaux et d’autres de passage, s’évertuent à pérenniser pour en préserver la mémoire.Rien de mieux que le zinc d’un bistrot pour les commémorer comme l’auteur s’y emploie par la bouche du tenancier, d’un cheminot syndiqué ou d’un insolite violoniste.
Hier, j’étais en poste, j’ai entendu ton violon chanter El cant des ocells. Le chant des républicains ! Pau Casals l’a interprété devant la tombe de Machado. Alors, quelqu’un qui joue dans la nuit aveugle de la gare la chanson des réfugiés espagnols, celui-là ne peut que partager la sensibilité et l’âme du poète.
Ou encore la répartie nerveuse du patron du bar à l’adresse d’un gendarme un peu trop zélé.
La voix des exilés tu t’en fous hein, mais entends ce qu’elle dit : Voyageur, le chemin ce sont les traces de tes pas, rien de plus. Ils ne te volent rien ces voyageurs qui fuient la misère, ils emportent seulement un peu de la poussière de Catalogne sous leurs semelles !
C’est clair et bien envoyé, comme l’expriment aujourd’hui tous ceux qui s’érigent contre les partisans du zéro migrants…
Repaire d’étonnants personnages à l’instar d’une jeune fille fraîchement libérée de prison, d’un libraire fantôme de Walter Benjamin ou d’une adolescente trapéziste venant en aide aux réfugiés, le village devient ainsi un creuset de mémoire et de rébellion. Voguant chacun en marge d’une société aussi inhumaine, que pouvaient-ils donc y chercher, sinon leur propre vérité, faite de rêves et d’espérance ?
Un hymne aux petites gens
C’est toute la trame intimiste de ce roman faite de croisement d’existences singulières dont le commun dénominateur est le désir de justice rendu aux petites gens. C’est vrai pour Pablo et Manuel et c’est encore plus patent lorsqu’à l’issue de rude montée du Mirador, Gerda et Lilly découvrent sur la vitre de cristal deux phrases de Walter Benjamin.
Il est plus ardu d’honorer la mémoire d’êtres anonymes que celles d’êtres renommés. Car la construction de l’Histoire est consacrée à la mémoire des anonymes.
Pour la petite Lilly, enfant revêche d’une société sclérosée, ces mots inscrits sur l’esplanade face à la mer font office de véritable renaissance. Par-delà l’horizon, des bras l’entourent, l’apaisent lui disent la réalité de son existence, tel que le souligne l’auteur.
Elle n’est plus seule, elle peut aller de l’avant. Inconnue et légère, porteuse d’une part infime de la mémoire universelle, elle a tout autant de poids que les grands de ce monde.
Rempli d’humanité comme de tolérance et prétexte à pléthore de rencontres aussi contingentes qu’éloquentes, ce livre de Franck Pavloff se dévore ainsi comme un brûlant hymne à la fraternité.
Et de poésie tout autant à l’image du dialogue établi entre le violoniste et libraire de Collioure à propos du livre Champs de Castille dont ce dernier avait cité de mémoire quelques vers.
“Et quand viendra le jour du dernier voyage,
quand partira la nef qui jamais ne revient.”
La suite avouera-t-il, confus, je ne m’en souviens plus. Avant que le virtuose reprenant le poème gravé sur la tombe de Machado ne le termine spontanément.
“Vous me verrez à bord, et mon maigre bagage,
quasiment nu comme les enfants de la mer… “
Un récit aussi poignant qu’étincelant !

Chroniqueur : Michel Bolasell
NOS PARTENAIRES
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.