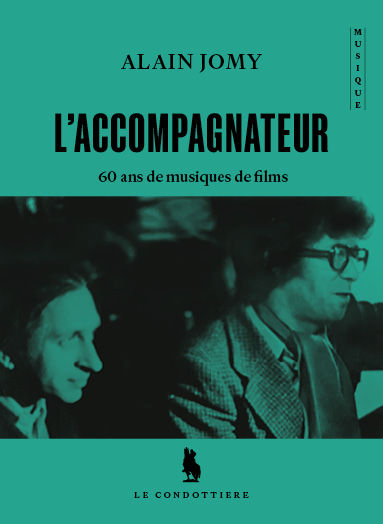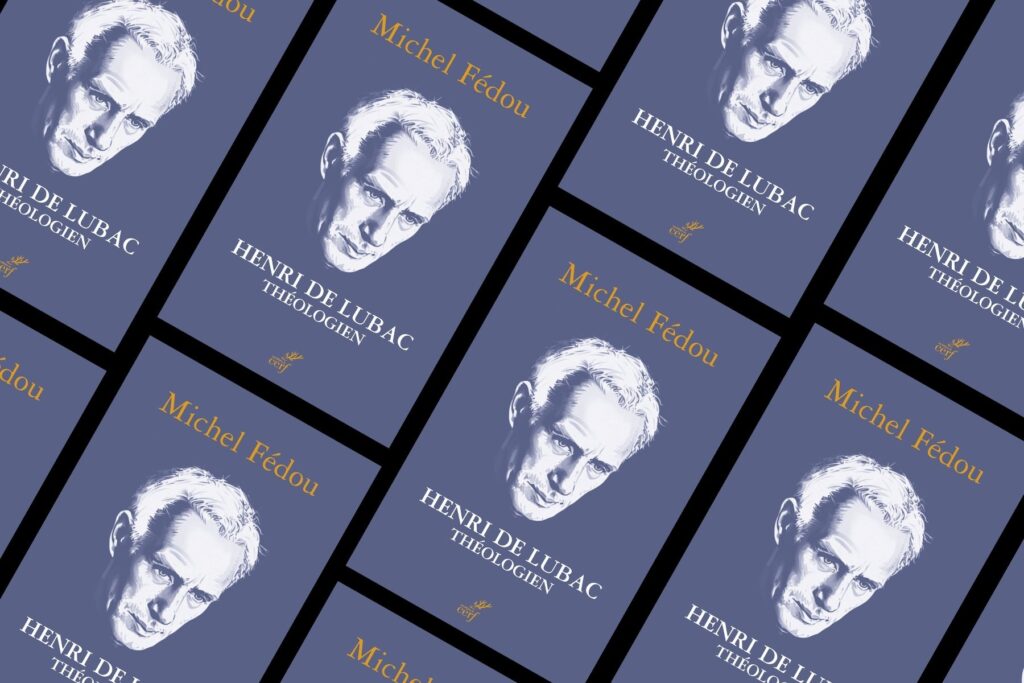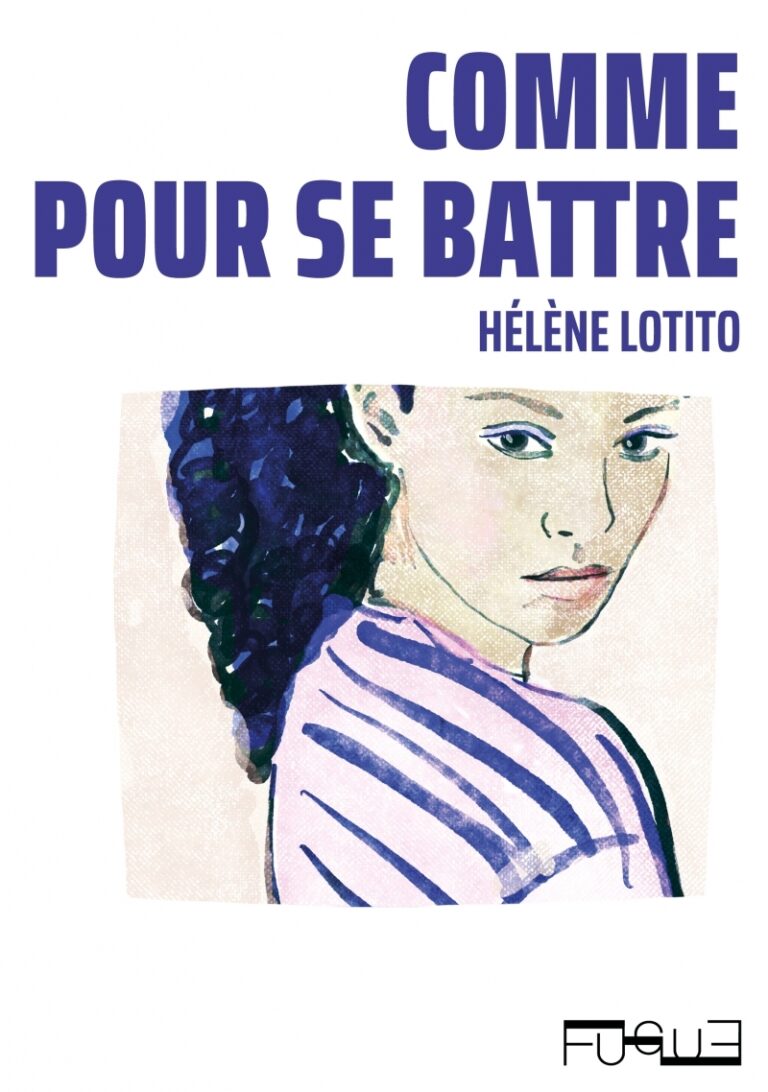Iancu-Agou Daniele, Aux Origines de Nostradamus, Éditions du Cerf, 24/04/2025, 312 pages, 29€
Dans le kaléidoscope mémoriel qui façonne notre perception des figures historiques, le nom de Nostradamus scintille d’un éclat particulier, celui du prophète impénétrable, de l’oracle dont les Centuries continuent d’alimenter fantasmes et exégèses. Pourtant, derrière l’icône, se cache un homme, un lignage, une histoire. C’est à cette quête des soubassements, à cette archéologie patiente des filiations oubliées, que nous convie Danièle Iancu-Agou dans son ouvrage magistral, Aux Origines de Nostradamus : Versant maternel. Un livre qui, délaissant les prophéties pour les parchemins, nous entraîne au cœur vibrant de la Provence du XVe siècle, là où les destins se nouaient et se dénouaient au gré des conversions, des alliances et des tumultes d’une époque en pleine mutation.
Aux sources d’une lignée oubliée
L’enquête de Danièle Iancu-Agou s’amorce, non par une affirmation péremptoire, mais par une plongée délibérée et assumée dans la matérialité des archives, ces dépositaires souvent mutiques des vies passées. L’historienne, dont l’érudition sur le judaïsme provençal n’est plus à démontrer, écarte d’emblée toute tentation sensationnaliste afin de privilégier une démarche de restitution minutieuse, de réhabilitation patiente. Son objectif est limpide : redonner chair et substance à ces figures ancestrales que l’historiographie, parfois trop prompte à embrasser les légendes ou à négliger les branches jugées secondaires, avait estompées ou, pire, défigurées. Ce “versant maternel” de la généalogie de Nostradamus, souvent considéré comme un appendice anecdotique, devient ici le fil conducteur d’une investigation qui emprunte autant à la rigueur de la microhistoire qu’à la puissance évocatrice de la saga familiale, déployant sous nos yeux la fresque d’une société provençale où les identités religieuses et culturelles étaient loin d’être monolithiques.
C’est ainsi qu’au détour d’un registre notarié, dont la poussière semble encore porter l’écho des serments prêtés, émerge une figure centrale, un protagoniste aussi inattendu que décisif : Jacques Turrelli, anciennement Cregud Bonet. Cet aïeul maternel, jusqu’alors un simple nom dans une généalogie lacunaire, acquiert sous la plume érudite et précise de l’historienne une densité, une complexité humaine saisissantes. Il est ce olim judeus, ce néophyte marseillais, témoin et acteur d’une époque charnière, dont le destin individuel va servir de révélateur aux dynamiques sociales et religieuses plus larges. À travers lui, c’est toute une exploration méthodique des stratégies matrimoniales, des réseaux de solidarité néophyte, des subtilités de la conversion – qu’elle relève d’un choix intime, d’une adaptation pragmatique ou, plus tragiquement, de ce que l’auteure nomme les “conversions de dernier recours” – qui se déploie. La trajectoire de Jacques Turrelli, Juif devenu chrétien dans une Marseille qui vivait encore sous la relative clémence du roi René, avant que les vents de l’expulsion ne se lèvent, devient ainsi emblématique de ces existences frontières, de ces identités en recomposition permanente, où le passé, s’il est renié ou transformé, ne s’efface jamais complètement, mais continue d’informer souterrainement le présent.
Dès cet instant, une tension narrative, aussi subtile que persistante, s’instaure et structure l’ouvrage. Elle oppose la mémoire légendaire, patiemment construite et embellie a posteriori par des descendants soucieux d’ennoblir leurs origines – on songe ici, bien sûr, aux écrits parfois hagiographiques du frère Jehan ou du fils César de Nostredame, qui firent de leur illustre parent le dépositaire d’une antique sagesse et d’une noblesse quasi immémoriale – à la réalité archivistique, souvent plus prosaïque, parfois moins flatteuse, mais toujours profondément humaine. C’est précisément dans cet interstice, dans ce hiatus entre le récit familial idéalisé et la trace documentaire brute, que Danièle Iancu-Agou déploie son savoir-faire d’historienne. Elle excelle à faire parler les silences des registres, à traquer les indices ténus, à confronter les discours officiels aux pratiques réelles, invitant le lecteur à une véritable archéologie des identités, où chaque contrat de mariage, chaque testament, chaque simple mention dans un acte notarié devient une pièce d’un vaste puzzle. L’assemblage de ce puzzle, prévient implicitement l’auteure, ne vise pas tant à fixer une vérité monolithique et définitive qu’à éclairer les multiples facettes d’une époque et les stratégies complexes des individus qui la traversèrent.
Conversions, mémoires et plume d’historienne
La conversion, telle qu’elle est disséquée avec une précision d’entomologiste par Danièle Iancu-Agou, apparaît bien moins comme une volte-face spirituelle que comme le symptôme d’une société en crise, le reflet des angoisses et des calculs qui traversent une communauté à la veille de son déracinement. Au cœur de cette Provence des XVe et XVIe siècles, alors que le Comté bascule sous la couronne de France, et que les nuages des édits d’expulsion s’amoncellent, la condition juive se mue en une précarité existentielle. L’historienne, s’appuyant sur une connaissance intime des sources, dévoile, sans jamais porter de jugement moral anachronique, la complexité des cheminements individuels et collectifs qui conduisent de la foi ancestrale à l’adoption, souvent contrainte, du christianisme. Ces “néophytes de dernier recours,” figures tragiques prises dans l’étau de l’Histoire, illustrent une forme de résilience où l’adaptation, si elle implique une rupture intime souvent douloureuse, n’annihile pas nécessairement la persistance de liens communautaires, de réseaux de solidarité qui se reconfigurent au sein de la nouvelle foi. L’hybridité culturelle de ces lignages fraîchement convertis, que l’auteure traque avec une acuité remarquable dans les alliances matrimoniales, les choix de parrains, ou encore les pratiques testamentaires, est l’une des révélations les plus fines et les plus troublantes de cette enquête.
C’est en historienne scrupuleuse, consciente des pièges de la mémoire et des reconstructions a posteriori, que Danièle Iancu-Agou aborde les récits familiaux des descendants de Nostradamus. La figure légendaire de Pierre de Nostredame, cet aïeul paré de toutes les vertus, médecin attitré du roi René selon la tradition familiale, est ainsi confrontée aux silences ou aux contradictions des archives. L’autobiographie, ce processus par lequel les familles en quête de légitimité sociale s’inventent des ancêtres illustres, effaçant les origines plus modestes ou les épisodes moins glorieux, n’est certes pas une spécificité des Nostredame. Mais l’auteure, en analysant avec une rigueur exemplaire ce mécanisme de mythification, ne déboulonne pas une statue : elle replace cette construction mémorielle dans son contexte socio-historique, celui d’une famille cherchant à asseoir son rang et son prestige dans une société provençale elle-même en pleine redéfinition. En cela, son travail rejoint les préoccupations d’un Pierre Nora sur la “fabrique des lieux de mémoire” et la manière dont le récit historique, fût-il familial, devient un puissant vecteur d’identité et de distinction. La confrontation entre la doxa familiale et les faits archivistiques devient alors une leçon d’historiographie critique.
Il serait injuste, cependant, de réduire l’apport de cet ouvrage à sa seule dimension analytique. La plume de Danièle Iancu-Agou est celle d’une conteuse, capable de faire surgir des êtres de chair et de sang de la gangue des parchemins. Loin de la froideur que l’on pourrait redouter d’une étude aussi densément documentée, son style se caractérise par une fluidité, une élégance, et une capacité d’évocation qui rendent la lecture passionnante. Les longs paragraphes, d’une architecture savante, ménagent des pauses, des respirations, permettant au lecteur de s’immerger pleinement dans la complexité des destins individuels et des dynamiques collectives. Sa maîtrise philologique, sa familiarité avec les coutumes, les institutions, et le latin notarial de la Provence médiévale, lui permettent d’aller bien au-delà de la simple citation de documents : elle les décrypte, les éclaire, les fait dialoguer avec une intelligence subtile, offrant ainsi une narration qui, si elle s’ancre dans une rigueur scientifique irréprochable, n’en demeure pas moins profondément humaine et accessible. On perçoit, derrière la démarche de l’historienne, une forme d’empathie discrète, une forme de respect pour ces hommes et ces femmes qu’elle ressuscite, une volonté de comprendre leurs motivations, leurs dilemmes, sans jamais céder à la facilité du jugement. C’est peut-être là que réside la véritable alchimie de son écriture : cette capacité rare à marier l’acribie de l’érudition et une sensibilité qui confine au littéraire.
Nostradamus ou l’art de naviguer entre les mondes
Michel de Nostredame lui-même, héritier de ces lignées dont l’histoire est un entrelacs de ruptures et de persistances, incarne de manière emblématique cette figure de l’homme-frontière, du passeur entre deux mondes, entre deux époques. Né officiellement dans le giron de l’Église, il porte néanmoins, par ses deux ascendances, paternelle et maternelle, le poids et la richesse d’un héritage juif qui, s’il n’est pas revendiqué explicitement, n’en constitue pas moins une part de son identité profonde. L’ouvrage de Danièle Iancu-Agou, en projetant une lumière crue et neuve sur ce “versant maternel”, vient considérablement complexifier et enrichir notre lecture du personnage de Nostradamus, trop souvent réduit à sa seule dimension d’oracle. La question, ainsi que le suggère l’auteure, n’est plus tant de chercher à quantifier ou à hiérarchiser ses appartenances – fut-il “plus” juif, néophyte ou chrétien ? – que de reconnaître en lui le prototype de cette “identité fluide”, concept si prégnant dans notre modernité tardive, une identité qui se forge au confluent d’apports multiples, parfois dissonants, et qui en fait toute la singularité et la puissance. Nostradamus est, en cela, un pur produit d’une Provence elle-même terre de brassage, carrefour des cultures et des influences.
Cette exploration minutieuse des origines, ce dévoilement patient des strates identitaires, entre en résonance directe avec les questionnements de notre propre époque. À l’heure où les débats sur la filiation, la mémoire collective, les identités plurielles traversent nos sociétés avec une acuité parfois douloureuse, ce retour aux sources, cette volonté de redonner une voix et une histoire aux “oubliés”, aux “effacés” des grands récits, revêt une signification particulière. La “part juive” dans l’histoire de France, longtemps minorée, voire occultée, trouve dans des travaux comme celui-ci une illustration concrète, nuancée, et profondément humaine. On songe alors à Walter Benjamin et à sa conception d’une histoire écrite “à rebrousse-poil”, attentive aux fragments, aux marges, là où se lit souvent le destin des “vaincus”, ou de ceux qui, comme les néophytes provençaux, durent négocier leur assimilation. Ce livre est une pierre angulaire à cette entreprise de réévaluation historiographique, une démarche salutaire qui s’écarte des simplifications binaires et des anachronismes stériles.
L’ouvrage de Danièle Iancu-Agou ne prétend nullement clore le “dossier” Nostradamus, ni même celui de ses origines. Au contraire, il le revivifie, l’ouvre à de nouvelles interrogations, à des perspectives inédites. En se focalisant sur ce “versant maternel”, en exhumant avec une patience d’archéologue des documents notariés que l’on croyait muets, elle nous offre bien plus qu’une rectification généalogique ou qu’une énième biographie. Elle nous invite à une méditation plus vaste sur les mécanismes de la construction mémorielle, sur les jeux de miroirs complexes entre la légende familiale et la réalité historique, sur les stratégies subtiles de survie et d’intégration mises en œuvre par des individus et des groupes au sein de sociétés en profonde mutation. Ce n’est pas, redisons-le, une nouvelle tentative de décrypter les Centuries, mais une contribution essentielle, et d’une grande finesse, à l’histoire sociale, culturelle et religieuse de la Provence, une incitation à lire, par-delà les figures illustres et les mythes consacrés, la trame foisonnante et parfois contradictoire des existences humaines. C’est, fondamentalement, un plaidoyer vibrant pour une histoire qui ose s’aventurer dans les “cryptes” de l’archive, non pour y chercher des certitudes rassurantes, mais pour y recueillir des éclairages, fussent-ils parfois troublants et dérangeants, sur la complexité inépuisable de ce qui nous constitue.