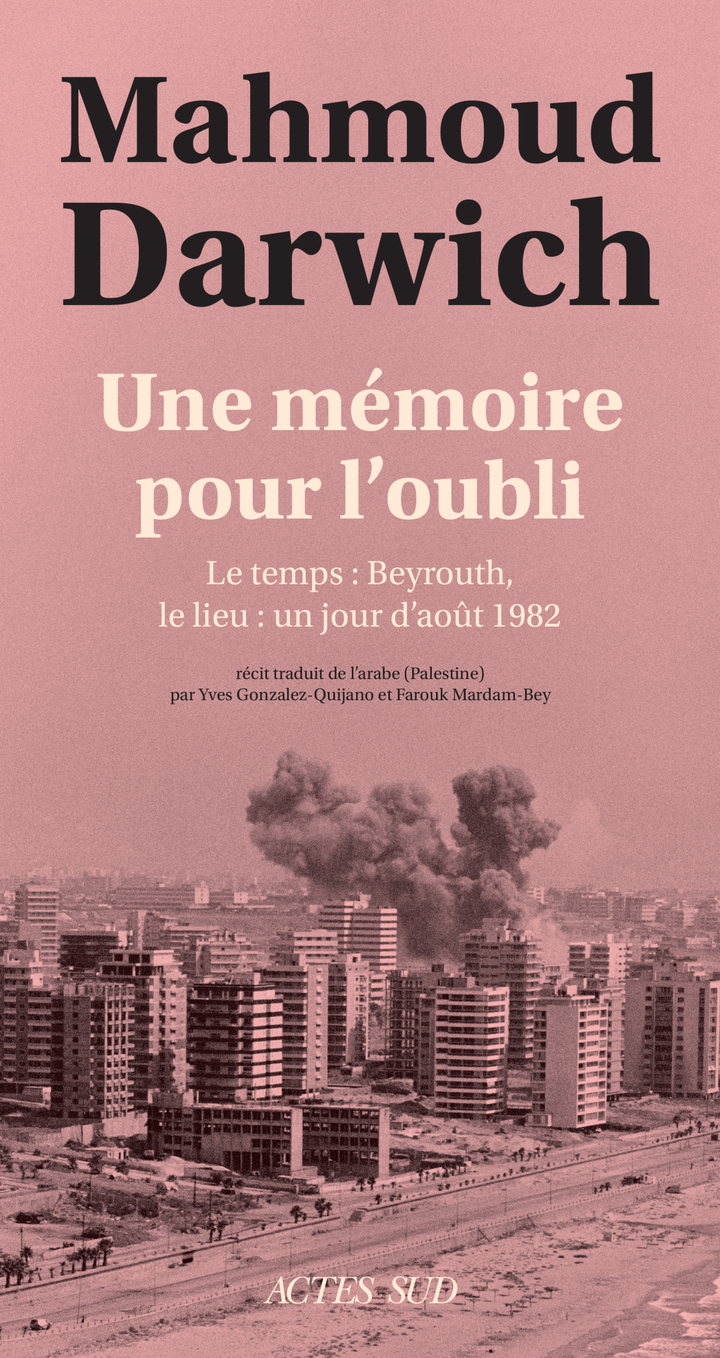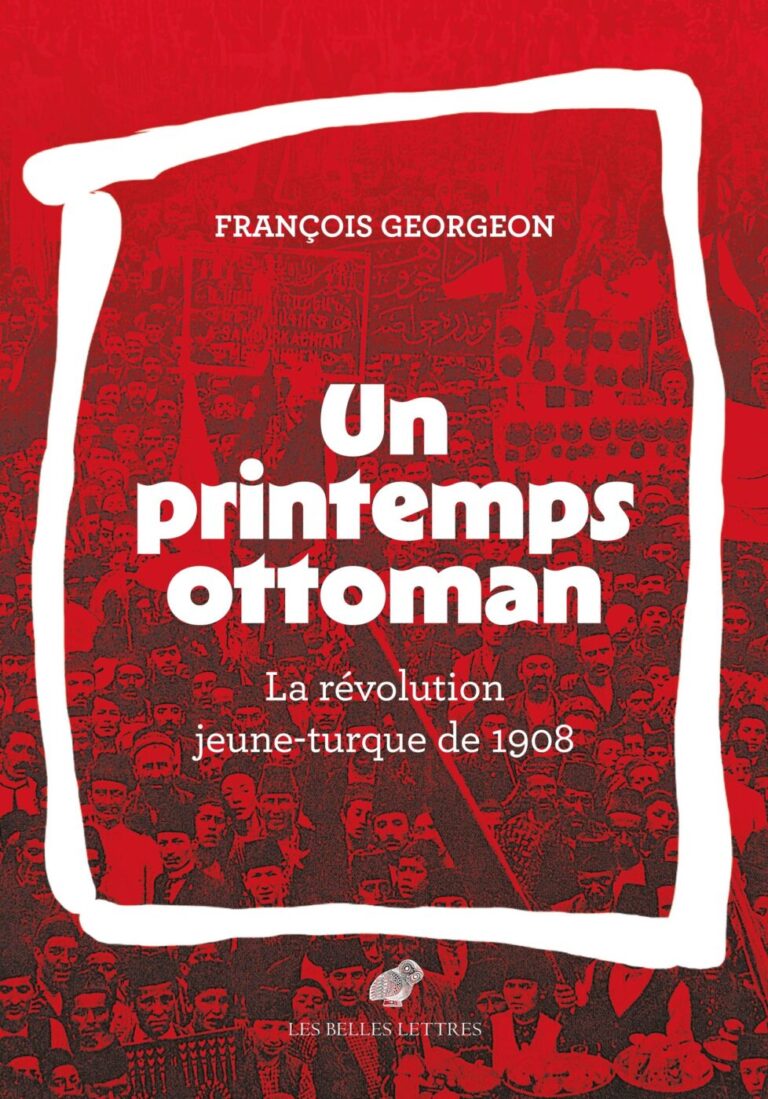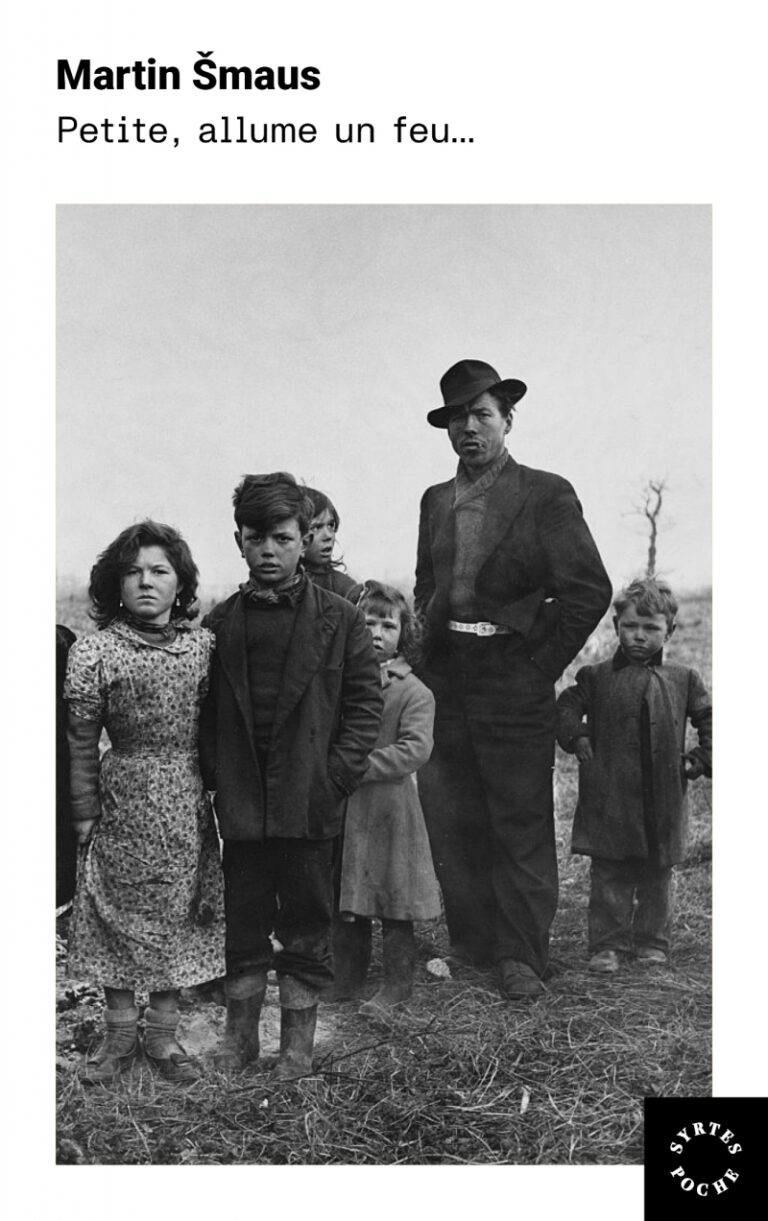Mathilde Dondeyne, Ma fille, Éditions du Rouergue, 08/01/2025, 224 pages, 20,90 €
Avec Ma fille, Mathilde Dondeyne ne signe pas seulement un premier roman, elle jette dans l’arène littéraire une œuvre d’une intensité viscérale, un diagnostic à cœur ouvert des fractures intimes et collectives qui lézardent le présent. Plongeant dans le quotidien d’Irène, professeure et mère naviguant en eaux troubles entre deuil et désillusion, l’autrice orchestre une polyphonie subtile et brutale des silences, des corps meurtris et des espoirs vacillants. Un texte radical qui refuse les faux-fuyants et nous confronte à la complexité déchirante de l’existence contemporaine.

Enseigner au bord du gouffre
Dès l’ouverture, nous pénétrons un univers où la tension est palpable, imprégnant l’air chloré de la piscine municipale comme les couloirs d’un collège REP anonyme. Irène Latellier, l’héroïne, y apparaît d’emblée comme une figure en équilibre précaire, “délestée de ce poids énorme pour elle” dans l’apesanteur aquatique, mais aussitôt rattrapée par la gravité du réel. Cette professeure de français, volontaire pour enseigner dans un contexte difficile – un choix perçu comme une forme de défi personnel, une “belle revanche” –, porte les stigmates invisibles d’un drame fondateur : la perte de sa première fille, Solène, quelques jours après sa naissance. Ce deuil originel, jamais cicatrisé, teinte d’une mélancolie sourde sa relation avec ses jumelles, Maud et Alma, nées comme une “seconde chance” mais grandissant dans l’ombre du non-dit, et mine sa vie conjugale avec Antoine, ingénieur dont le pragmatisme confine à l’évitement émotionnel (“Il évite les sujets importants“). Le collège, loin d’être un exutoire, devient le miroir grossissant de ses propres failles et de celles d’une société fragmentée. La violence symbolique de l’institution, l’indifférence ou l’hostilité larvée des élèves de sa classe de 3e B, l’isolement au sein même de l’équipe enseignante, tout concourt à éroder sa résistance. L’arrivée de Louise, adolescente magnétique et écorchée vive, elle aussi marquée par la perte précoce de sa mère, va agir comme un catalyseur dévastateur, faisant voler en éclats les minces remparts qu’Irène avait érigés entre sa vie intime et sa posture professionnelle. La piscine, ce premier lieu de rencontre ambiguë, devient l’épicentre symbolique d’une relation qui va la happer, brouillant les frontières entre aide et emprise, entre sollicitude et obsession.
Complicité interdite, douleur partagée
Mathilde Dondeyne cartographie avec une lucidité implacable la dérive d’Irène, tissant ensemble les fils thématiques qui composent la trame serrée de son existence. Le quotidien du collège REP est dépeint sans concession : la difficulté à capter l’attention d’élèves aux prises avec leurs propres troubles (dyslexie, dyspraxie, mais aussi simple désœuvrement), la confrontation permanente aux micro-agressions, au “bruit de fond” qui sape l’autorité, et le sentiment d’échec pédagogique face à des adolescents qui semblent parfois maîtriser mieux qu’elle les codes de la survie émotionnelle. La relation avec Louise occupe une place centrale, analysée dans toutes ses ambiguïtés : une correspondance secrète via Instagram, des rencontres hors cadre (cinéma, café), une fascination mutuelle qui vire à la dépendance toxique. Irène projette sur Louise son propre passé, son besoin de réparation, sa maternité empêchée, tandis que Louise trouve en elle une figure d’adulte à la fois confidente et cible de sa propre colère rentrée. L’auteure excelle à montrer comment cette “amitié” hors norme devient un lieu de “complicité” dangereuse (“C’est compliqué, étouffé, prohibé,”), comblant un vide existentiel tout en creusant d’autres abîmes. L’écriture elle-même épouse cette tension : phrases courtes, nerveuses, dialogues elliptiques où percent l’agressivité ou l’incompréhension (“Putain, mais Irène je ne suis pas toi !), alternent avec de longues introspections où Irène dissèque sa propre détresse (“Elle écrit qu’elle n’a plus rien à tirer de l’existence“) ou tente de théoriser, a posteriori, sa propre chute. L’écho de la crise migratoire), vient percuter de plein fouet l’intime d’Irène, exacerbant son sentiment d’impuissance face à la douleur du monde et révélant la porosité de son être aux tragédies collectives, contrastant cruellement avec le détachement d’Antoine.
La vie après Solène, ou comment tenir debout
Au-delà de l’histoire singulière d’Irène, Ma fille déploie une résonance collective puissante et dérangeante. Le roman se fait l’écho des difficultés et de l’épuisement qui guettent nombre d’enseignants, particulièrement les femmes, prises dans l’étau d’une institution souvent déconnectée des réalités de terrain et d’une société qui exige tout d’elles. Il explore sans fard la complexité de la maternité, surtout lorsqu’elle est marquée par le sceau du deuil périnatal, interrogeant la culpabilité, la résilience et les stratégies de survie mises en place face à l’innommable. La dynamique entre Irène et Antoine met en lumière l’usure du lien conjugal face au trauma, l’incapacité masculine (ici incarnée par Antoine) à verbaliser la douleur autrement que par le retrait ou le pragmatisme défensif, creusant un fossé d’incompréhension que même l’intimité physique ne parvient plus à combler (“Il est deux heures du matin. Avant de s’endormir, Irène repense à ce que lui a dit son amie avant de partir” – suggérant que le lien salvateur s’est déplacé). Le livre fonctionne comme un miroir, parfois cruel, de nos propres fragilités, de nos arrangements avec la vérité, de nos compromis silencieux. Il n’offre pas de réponses simples ni de rédemption facile.
Le vertige de rester en vie
La conclusion, ouverte, laisse Irène face à elle-même, porteuse d’une nouvelle vie imprévue mais peut-être aussi d’une lucidité nouvelle sur les impasses de son existence passée. La rupture avec Louise, brutale mais nécessaire, et l’affrontement final avec Antoine suggèrent une possible reconstruction, non pas dans l’oubli, mais dans l’acceptation radicale de sa propre histoire et de ses choix. Toutefois, le roman maintient une tension subtile, laissant planer une ambiguïté fascinante autour de certaines figures clés, notamment celle, complexe et insaisissable, du père de Louise, dont les motivations échappent à toute lecture univoque et enrichissent la portée de l’œuvre. C’est là aussi la force de ce premier roman : il ne console pas, il éclaire, refusant de simplifier les méandres psychologiques ou les zones grises des relations humaines. Il nous laisse avec le sentiment d’avoir traversé une expérience intense, douloureuse, mais essentielle, portée par une écriture maîtrisée qui annonce une autrice majeure.