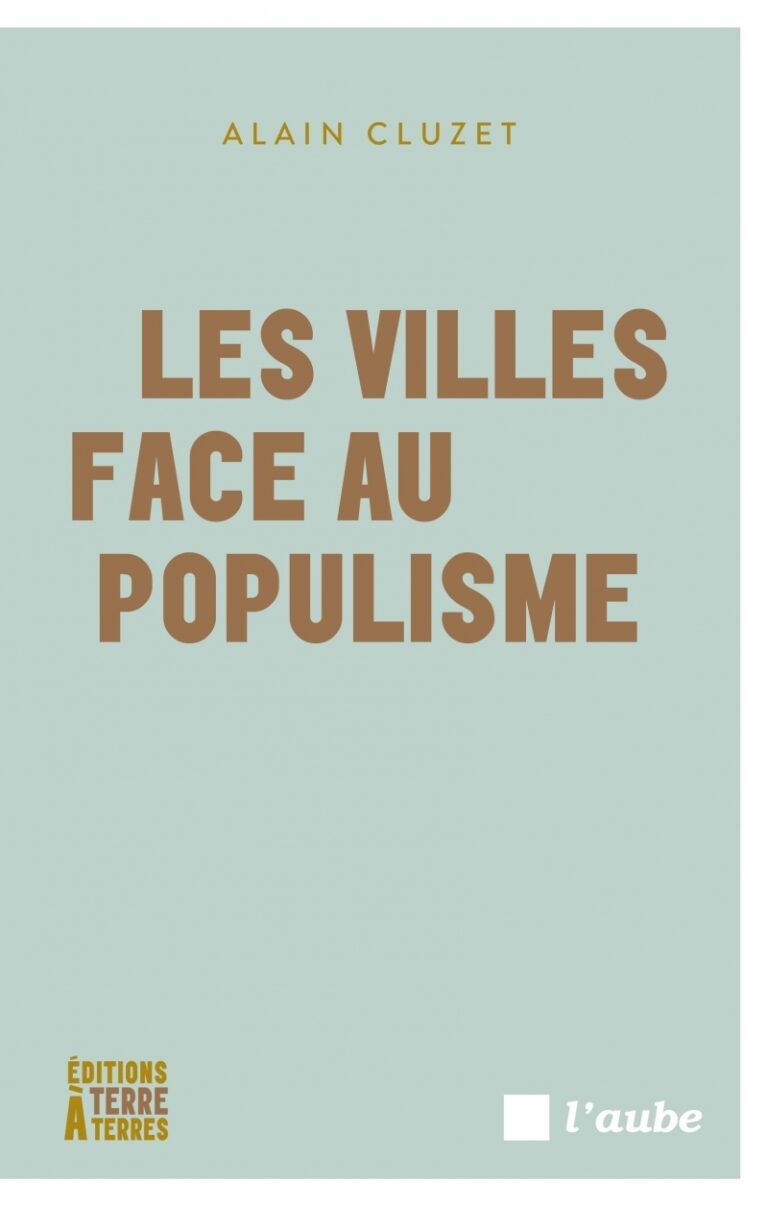Mohammad Ali Amir-Moezzi & John Tolan, Le Mahomet des historiens (2 Volumes), Éditions du Cerf, 16/10/2025, 2186 pages, 59 €
Avec un premier volume qui explorait avec une patience d’archéologue les regards extérieurs portés sur le fondateur de l’islam, Le Mahomet des historiens avait déjà redessiné les contours de son sujet. Substituant à la quête impossible d’une biographie univoque la cartographie patiente des discours et des représentations, il avait posé les jalons d’une histoire non de l’homme, mais de son infinie réverbération dans la mémoire des civilisations. Ce second volume, plongeant cette fois au cœur même des mondes musulmans, confirme l’ambition monumentale et l’acuité intellectuelle du projet dirigé par Mohammad Ali Amir-Moezzi et John Tolan.
Il ne s’agit plus de chercher le prophète à travers le prisme déformant de ses adversaires, mais de le suivre dans le labyrinthe de ses propres héritages. Le voyage est vertigineux. Il nous mène de l’extase des mystiques soufis à la raison froide des philosophes, de la ferveur des poètes panégyristes aux exégèses contestataires des chiites, des réformistes ottomans aux syncrétismes javanais, jusqu’au choc brutal, et si contemporain, du Mahomet des djihadistes. Cet ouvrage n’est pas un portrait, c’est une polyphonie. Chaque chapitre, chaque contribution explore une facette d’une figure qui, loin d’être monolithique, apparaît comme un vaste miroir où se reflètent les aspirations, les angoisses et les ambitions de l’islam lui-même. C’est une descente dans la géologie des croyances, une archéologie de l’âme musulmane.
Le Mahomet du cœur : entre dévotion et métaphysique
Le périple commence loin du fracas des batailles et des subtilités du droit, dans la sphère intime de la dévotion. C’est là que se révèle un Mahomet de lumière et d’amour, un intercesseur miséricordieux dont le souvenir même est source de bénédiction. Les contributions de Thomas Gadegaard et Pierre Lory nous font entendre la rumeur fervente qui monte des rituels populaires, des célébrations de sa naissance (Mawlid) et des panégyriques qui, depuis des siècles, chantent ses louanges. La célèbre Burda (« Le Manteau ») du poète al-Būṣīrī, analysée avec une finesse exquise par Moulay El Hossayn, est une liturgie populaire, un trésor de piété où le Prophète, parangon de l’homme parfait (insān kāmil), est paré de toutes les vertus. Ses miracles y sont décrits avec un luxe de détails qui attestent Sa Sainteté, tandis que le langage de l’amour mystique y efface la frontière entre l’adoration de Dieu et l’attachement vibrant à sa personne. Les hadiths, ces récits de ses paroles et de ses gestes, irriguent ici une spiritualité vivante, modelant un guide bienveillant, presque un confident.
Cette transfiguration atteint son acmé métaphysique dans les vertiges de la pensée soufie. Pour les grands mystiques, dont Pierre Lory et Christian Jambet sondent la pensée abyssale, Mahomet cesse d’être un personnage historique pour devenir un principe cosmique, la « Réalité muhammadienne » (ḥaqīqa Muḥammadiyya). Chez un maître comme Ibn ‘Arabî, il devient l’archétype de l’Homme Parfait, le lieu théophanique où le Créateur se révèle à la création, le médiateur ontologique entre l’Un et le multiple. Ce n’est plus un modèle biographique à imiter, mais une source d’illumination dont la contemplation est une voie initiatique. La pensée chiite, explorée ici à travers la figure de Sayyed Ḥaydar Āmolī, prolonge cette lecture spéculative en l’articulant à la doctrine de l’imamat, faisant du Prophète et des Imams les manifestations successives d’une seule et même Lumière pré-éternelle. La figure historique se dissout dans la contemplation d’un logos divin qui transcende l’histoire et le temps.
Le Mahomet des philosophes et des Imams
À cette ivresse cosmique, la tradition des philosophes (falāsifa) oppose l’austère lumière de la raison. Ali Benmakhlouf montre comment, pour Al-Fârâbî, Ibn Sīnā (Avicenne) ou Ibn Rushd (Averroès), la figure de Mahomet est avant tout celle du législateur inspiré, du fondateur de la cité vertueuse platonicienne. La prophétie est interprétée comme la traduction symbolique de vérités philosophiques universelles, rendues accessibles aux masses. La Révélation n’est plus l’irruption de l’inexplicable, mais la mise en forme politique et sociale d’une démonstration rationnelle. Cette lecture met à distance le miracle pour se concentrer sur l’architecture de la loi et de la société.
Ce Prophète législateur trouve une expression plus normative encore chez les juristes et les théologiens, qu’analyse Éric Chaumont. Pour eux, Mahomet est la source vivante de la Loi. Ses paroles et ses actes, compilés dans les hadiths qui forment la Sunna, constituent le fondement du droit islamique (fiqh). Il est le juge, le modèle de comportement par excellence (uswa ḥasana). Son héritage devient un corpus de lois, son existence une suite de précédents juridiques.
C’est précisément contre cette vision, perçue comme une usurpation, que se construit en partie la lecture chiite, brillamment exposée par Mohammad Ali Amir-Moezzi. Le chiisme propose un récit alternatif. La mission de Mahomet ne trouve son accomplissement qu’avec la désignation d’Ali comme son successeur. Il est surtout le transmetteur d’un savoir ésotérique dont seuls les Imams, membres de sa famille, seront les héritiers. La révélation ne se clôt pas avec sa mort ; elle se prolonge et s’intériorise dans leur lignée. Le Mahomet chiite est une figure de rupture, initiateur d’une histoire sainte qui ne fait que commencer.
Un Prophète défiguré ?
Le choc de la modernité et l’expérience coloniale provoquent une réinvention radicale de la figure prophétique. Mehdi Ghouirgate analyse l’appel des réformistes à un retour au Mahomet « historique », homme d’État et réformateur social. Un Mahomet rationalisé, adapté aux exigences nouvelles du nationalisme et du progrès scientifique.
Mais ce volume révèle des facettes plus inattendues. Dans l’archipel indonésien, comme le montre le fascinant chapitre de Rémy Madinier, émerge une figure profondément syncrétique. Le Mahomet javanais est teinté d’hindouisme et de bouddhisme, Sa Sainteté se conjuguant à celle des wali songo, les neuf saints propagateurs de l’islam. Le récit de sa vie se mêle à l’imaginaire onirique des épopées locales, et son autorité se fond dans une tradition mystique qui valorise l’union avec le divin. Ce Mahomet libéral, nourri de spiritualités multiples, contraste vivement avec les modèles plus rigoristes du Moyen-Orient, offrant un contrepoint essentiel à la prétendue uniformité de la mémoire islamique. De même, chez les Ottomans, décrits par Renaud Soler, la figure de Mahomet est mobilisée pour légitimer la double autorité du sultan et du calife. Les siyer (vies du Prophète) y deviennent un genre littéraire à part entière, synthétisant les traditions arabes, persanes et turques pour forger une image impériale du Prophète, à la fois chef de guerre et source de légitimité cosmique.
À cette pluralité culturelle s’oppose la standardisation idéologique des mouvements islamistes contemporains. Stéphane Lacroix et Sabrina Mervin explorent comment, pour les Frères musulmans et les théoriciens comme Sayyid Qutb, le Prophète devient avant tout un chef d’État, un conquérant dont l’action doit servir de modèle pour la prise du pouvoir. Le Mahomet mystique est évacué au profit d’une figure de pouvoir, un modèle politique où la dimension militaire et législative occulte toute autre lecture.
Quand Mahomet devient prétexte : l’usurpation djihadiste du Prophète
La dernière et terrifiante métamorphose est celle du Mahomet des djihadistes, qu’analyse Sabrina Mervin. La rupture est totale. La figure de Mahomet est réduite à un arsenal de justifications pour la violence. Présenté exclusivement comme un chef de guerre impitoyable, tueur d’apostats, il est vidé de toute épaisseur historique, de toute pédagogie. Au nom d’un « retour aux sources » qui n’est qu’une fiction idéologique, les textes sont soumis à une sélection radicale. Ce Mahomet spectral, entièrement subordonné à un usage nihiliste, devient l’antithèse absolue du Prophète de miséricorde de la tradition dévotionnelle.
Au terme de ce parcours aussi érudit qu’éprouvant, ce second volume du Mahomet des historiens révèle la plasticité infinie du Prophète au sein même de la civilisation islamique. L’ouvrage, dans son ensemble, devient ainsi plus qu’une simple collection d’études : une réflexion sur la nature même de la mémoire religieuse. Il montre que la tension entre foi, histoire et idéologie est universelle, mais qu’elle prend une acuité singulière pour Mahomet, figure si souvent mobilisée dans les débats contemporains.
La démarche historiographique se fait ici lecture critique des usages internes du passé. Il ne s’agit ni de célébration ni de déconstruction stérile, mais d’une mise à nu des intentions et des contextes qui animent chaque représentation. L’ouvrage devient ainsi un miroir, parfois difficile mais nécessaire, tendu à l’islam contemporain, le confrontant à la diversité de ses propres héritages. Il ne donne pas de réponse à la question « qui fut Mahomet ? », mais il fournit les outils pour comprendre pourquoi, pour des milliards de fidèles à travers l’histoire, il a toujours été, et demeure, une question si vive. À travers ces deux volumes, la figure de Mahomet cesse d’être une silhouette fuyante pour devenir un continent à part entière, dont les directeurs de l’ouvrage ont dressé la première carte complète. Par son ambition, sa rigueur et sa profondeur, Le Mahomet des historiens s’impose comme la plus grande somme jamais rassemblée sur le Prophète, un océan de savoirs dont l’exploration ne fait que commencer.