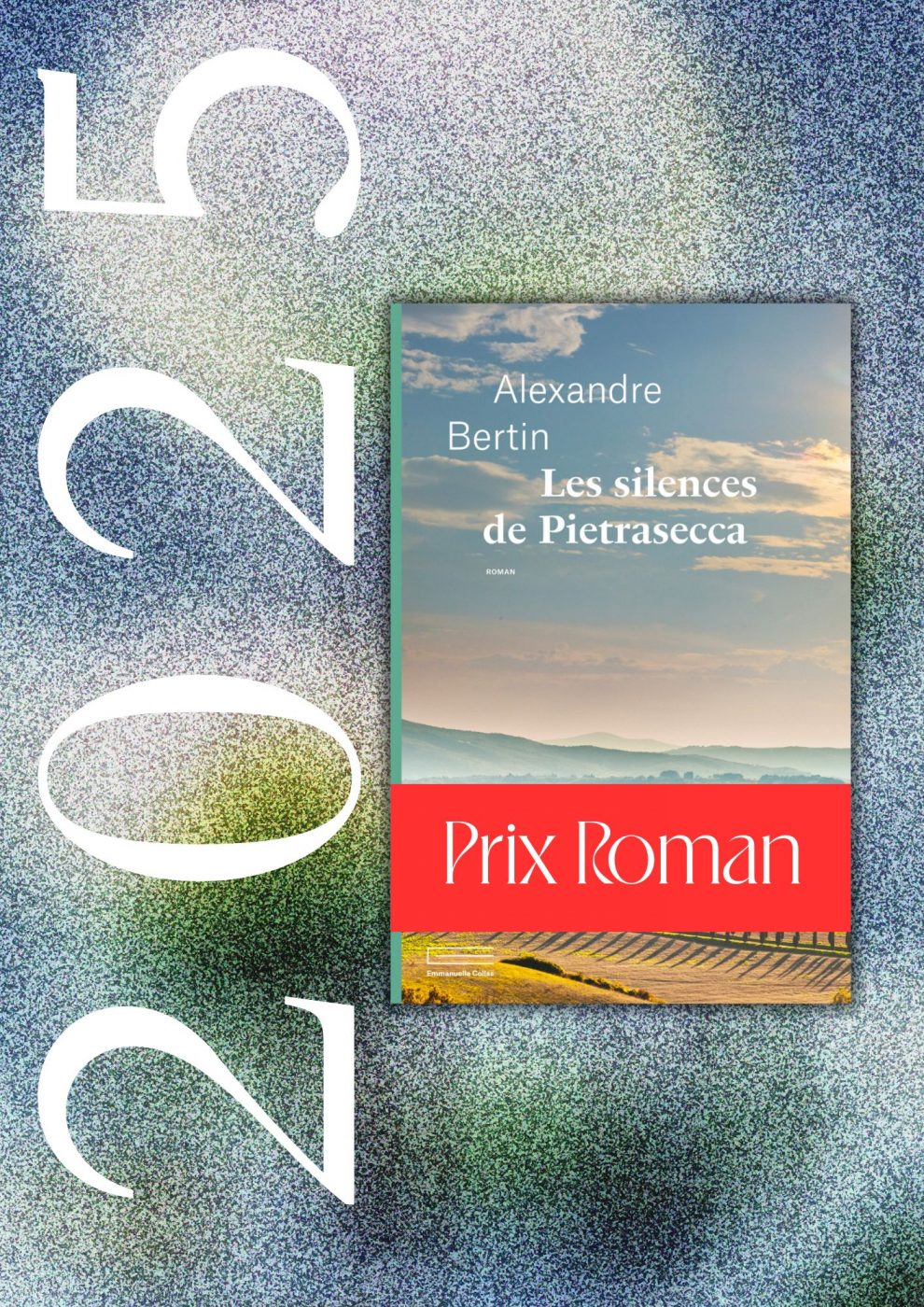Alexandre Bertin, Les silences de Pietrasecca, Emmanuelle Collas, 02/05/2025, 300 pages, 21,90 €
Entre récit initiatique et roman politique, Les silences de Pietrasecca tisse une intrigue haletante dont chaque détour dévoile un pan du passé refoulé. Alexandre Bertin orchestre un jeu de révélations successives qui éveille les thématiques centrales du roman : violence, filiation, mémoire collective. Un récit où le personnel et le politique se superposent sans jamais se dissoudre.
Les mots absents, les corps marqués
Ce qui saisit d’emblée, c’est cette scène inaugurale, brutale, prologue glaçant qui expose la violence fondatrice sur laquelle reposera une grande partie du silence à venir. Le viol, décrit dans une prose économe mais viscéralement marquante, n’est pas seulement l’agression d’un corps ; il est l’inscription d’une mémoire traumatique qui, faute de mots, de justice, ou même de simple reconnaissance, se transformera en non-dit, en béance existentielle. Cet acte de barbarie, qui introduit d’emblée la figure énigmatique d’Ava Magris, mère biologique de Lorena et première victime d’un silence imposé, vient fissurer la narration et préfigure le lent travail de déconstruction de Lorena. La langue que Bertin emploie, dépouillée, accuse la violence indicible, la transformant en un fardeau que « tu porteras ce fardeau toute ta vie. ». Dès lors, le silence devient personnage, une gangue dont il faudra s’extraire.
Lorena Mancini, figure centrale de ce drame intime et collectif, nous est présentée sous les traits d’une activiste romaine, une femme engagée dans les luttes féministes des années soixante-dix italiennes. Son implication dans le groupe Donne Libere et sa participation passionnée aux manifestations pour le droit à l’avortement, dont le procès de Gigliola Pierobon à Padoue en juin 1973 forme une toile de fond vibrante et documentée, la dépeignent comme une conscience politique de son temps. Sa prise de parole publique, son engagement pour que chaque femme puisse revendiquer son corps – « Questo è il mio corpo. Ceci est mon corps. » – contraste violemment avec les silences qui emmurent son histoire personnelle. Héritière malgré elle d’une maison familiale à Arquà Petrarca et d’un passé dont elle ignore encore l’ampleur des ramifications, Lorena est une femme clivée, portant en elle les germes d’une quête identitaire. La convocation chez le notaire, après les funérailles de ses parents adoptifs, Léo et Suzana Mancini, marque l’irruption du passé dans un présent déjà lourd des échos des « Années de Plomb ». Ce n’est pas tant l’héritage matériel qui est en jeu que celui, immatériel et autrement plus conséquent, des secrets de famille.
Les premiers indices d’un passé trouble surgissent par fragments : une enveloppe timbrée d’un cabinet notarial, les réminiscences d’une enfance à Arquà Petrarca marquée par l’autoritarisme glacial de Suzana. La découverte fortuite du mausolée mussolinien que son père entretenait dans son bureau constitue une première brèche : « Tout était dédié à Mussolini et au fascisme. Et c’est en lisant ce mot, fascisme, que j’ai pris peur. » Cette peur infantile annonce la confrontation future avec un héritage familial et national bien plus complexe, où les silences entourant la figure d’Ava commencent à prendre forme. L’adoption, révélée tardivement, est une autre déflagration, la première d’une série qui l’amènera à questionner sa filiation, son identité, et à déconstruire le récit familial, occultant par la même occasion la vérité sur sa mère biologique. Ce décalage entre l’apparente respectabilité des Mancini et la noirceur du fascisme, entre le silence des parents et l’engagement politique de Lorena, pose les fondations d’une quête où l’intime ne cessera de dialoguer avec le politique.
La mémoire familiale comme champ de bataille
L’exploration des demeures familiales – Arquà Petrarca, Castro dei Volsci, Vallefratta – s’avère un puissant objet narratif. Chaque lieu est une métaphore du refoulé, un palimpseste où les secrets s’accumulent. La maison des Mancini à Arquà, avec son grenier qui recèle des uniformes d’enfants-soldats fascistes (Balilla) et des carnets codés, n’est pas un simple décor ; elle est le symptôme d’une mémoire malade, d’un passé qui n’en finit pas de ne pas passer. Le grenier devient un conservatoire du secret. L’uniforme de Giampaolo Gandolfi, dont le rôle se précisera douloureusement, enfant du fascisme et figure clé potentielle de la jeunesse de sa mère Ava, les carnets remplis d’une graphie indéchiffrable évoquant une comptabilité occulte, les photographies fantomatiques : tous ces éléments épaississent le mystère autour des origines de Lorena. Le délabrement des maisons symbolise autant l’oubli que l’obstination du passé à s’accrocher.
Le rôle du village, que ce soit Arquà Petrarca ou Castro dei Volsci, est crucial dans la construction de ce consensus du silence. La communauté rurale, souvent idéalisée, se révèle ici le lieu d’une complicité passive, d’une omertà tacite. L’accueil réservé aux Mancini à Arquà en 1945 soulève des questions. Comment un village a-t-il pu, ou voulu, ignorer le passé fasciste d’un médecin et d’une directrice d’école ? Des personnages comme Antonia Leonetti ou Alvise Mazzola incarnent cette ambivalence. Ils savent, ou soupçonnent, mais choisissent le silence, soit par peur, soit par convenance, soit par un pacte social visant à préserver une cohésion de surface après les déchirements historiques. Le dialogue entre Lorena et le maire Mazzola est éloquent, révélant comment le non-dit s’est institutionnalisé, comment le souvenir des Marocchinate – viols de masse commis par les troupes coloniales françaises, dont le récit initial du viol d’Ava par Ursula est une troublante réminiscence – a été enfoui sous une chape de déni. Ce silence du village n’est pas une simple absence de mots ; il est une action, une manière de refouler le traumatisme, un mécanisme qui explique en partie l’effacement de la figure d’Ava.
L’écriture du secret est, elle-même, un enjeu narratif central. Les carnets d’Amelia Magris, tenus dans un code complexe, suggèrent une activité clandestine et une volonté de protéger une information vitale. Les dates – « la personne a pris soin de brouiller les pistes. Si on regarde attentivement, il semblerait que nous ayons tout d’abord le mois puis l’année. » – les abréviations désignant des localités, constituent un langage secret dont la clé réside autant dans la graphie que dans le contexte. Ces objets nécessitent une interprétation. La lettre finale de Giampaolo Gandolfi, véritable pivot de l’intrigue, constitue le paroxysme de cette écriture du secret. Sa confession posthume ne se contente pas de lever le voile sur l’identité du père de Lorena ; elle dynamite les certitudes, révèle l’inceste insoupçonné et le poids des décisions d’Amelia. L’impact sur Lorena est dévastateur, la confrontant à une vérité généalogique et affective qui redéfinit entièrement son rapport à sa mère Ava, à sa grand-mère, et à elle-même. Le traumatisme n’est plus seulement celui du viol (désormais déconstruit comme un récit fabriqué), mais celui d’une histoire familiale entachée d’interdits et de manipulations, dont Ava fut aussi victime que complice passive par son silence.
Sous le silence, la faille : les strates d’une mémoire impure
Les silences de Pietrasecca dépasse le drame familial pour entrer en résonance avec l’actualité des combats féminins. Le corps de Lorena, de sa mère Ava – désormais vue non plus comme la victime directe d’une agression étrangère mais d’un ordre familial et sociétal implacable – et des innombrables victimes des Marocchinate ou des avortements clandestins, est au centre du récit. L’engagement de Lorena pour le droit à l’avortement fait écho aux débats contemporains. Le roman souligne comment le patriarcat et l’ordre moral ont cherché à contrôler le corps des femmes. Le traumatisme des violences sexuelles, qu’il soit réel ou construit comme un leurre pour masquer d’autres horreurs, pose la question de la mémoire : comment dire l’indicible ? Bertin, en entrelaçant le destin de Lorena avec celui de ces femmes, suggère que le silence est une forme de perpétuation de la violence. La transmission traumatique intergénérationnelle, particulièrement à travers l’héritage du fascisme – qui n’est pas seulement une idéologie politique mais un système de valeurs imprégnant les relations familiales, comme le montre la soumission d’Amelia aux Gandolfi – devient un fil rouge. Le secret entourant la naissance de Lorena est directement lié aux compromissions d’Amelia avec les fascistes, illustrant comment le poids du passé politique façonne les destins intimes.
L’adoption de Lorena peut être lue comme une métaphore du mensonge institutionnalisé, d’une filiation tronquée interrogeant les mécanismes de transmission et d’effacement de l’identité. Le secret entourant les origines de Lorena, orchestré par Amelia et Leonardo Gandolfi, révèle les arrangements qui ont pu prévaloir dans une Italie d’après-guerre. L’impossibilité pour Lorena d’accéder à une histoire familiale claire, la découverte progressive de ramifications (l’inceste, la collaboration d’Amelia), illustre la complexité de l’héritage. On hérite aussi de silences, de traumatismes. La quête de Lorena pour la vérité sur ses origines, notamment sur Ava, est une quête pour se réapproprier son histoire.
Enfin, Les silences de Pietrasecca ne propose pas de résolution simple. La fin du roman laisse Lorena face à une histoire reconfigurée. Le passé ne se referme pas comme un livre ; il se relit. L’ultime révélation de Giampaolo ne solde pas les comptes ; elle ouvre de nouvelles interrogations. Elle invite Lorena à une vigilance mémorielle. Le cheminement de Lorena, de Rome à Hoboken, est avant tout intérieur, une descente dans les strates d’une mémoire personnelle et collective. La complexité d’Amelia Magris, résistante et collaboratrice, illustre l’impossibilité de réduire l’histoire à des catégories binaires. Le roman suggère que la vérité est souvent polyphonique. Les silences de Pietrasecca ne sont peut-être pas tant ceux d’un lieu que ceux que nous portons, héritages d’une histoire dont nous sommes, consciemment ou non, les dépositaires. Le silence d’Ava, mère absente qui a choisi l’exil, devient compréhensible, non comme une fuite égoïste, mais comme une tentative de survie face à un traumatisme originel indicible et à un ordre social destructeur.