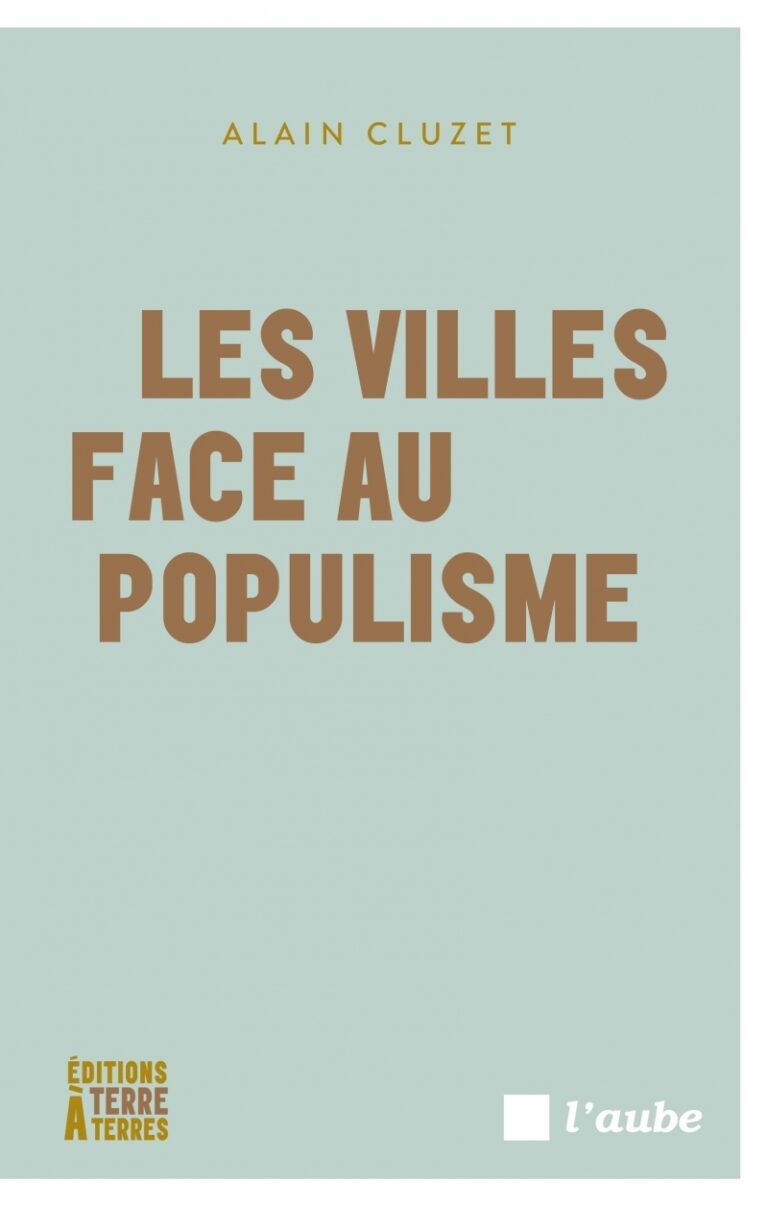Ancien camp d’internement devenu agora des mémoires, le Mémorial du camp de Rivesaltes est devenu le pôle de liberté d’expression. Il est taxé de “wokisme” par l’extrême droite. En instrumentalisant l’histoire pour attaquer ce pôle de dialogue, le RN masque mal sa défaite culturelle : une politique du repli identitaire incapable de penser la pluralité, qui préfère l’indignation à la culture.
Un pôle de liberté d’expression et de transmission
Le Mémorial du camp de Rivesaltes n’est pas un musée figé. Bâti sur un terrain où furent jadis relégués des « indésirables » – Républicains espagnols, juifs étrangers, prisonniers de guerre, harkis – il s’est donné pour mission d’ouvrir les frontières de la mémoire. Dans sa programmation, il associe les voix qui étaient jadis bannies : en 2025 il s’est ainsi associé au centre LGBT+66 et au festival Et Alors ? pour une soirée consacrée à la lutte contre les discriminations. Des projections et des tables rondes y mettent en évidence la condition des personnes LGBT+ et les réponses de l’État, de la justice et de l’éducation nationale ; une séance consacrée au film Out of Uganda montre des exilés contraints de fuir un pays où l’homosexualité est punie de mort. En invitant des représentants du ministère, de la justice, de l’éducation et des associations, le Mémorial transforme un ancien camp d’internement en agora.
Dans ce lieu, admirablement dirigé par Céline Sala et ses équipes, on n’impose pas un « penseur unique » : on écoute des récits hétérogènes, on confronte des voix qui portent des mémoires concurrentes. La demeure où soufflait jadis le vent du silence devient un pôle culturel où se croisent les disciplines (histoire, justice, sociologie, cinéma) et les sensibilités. Loin d’un centre partisan, il s’agit d’une maison commune qui honore les harkis, mais qui refuse de les isoler de l’ensemble des populations passées par le camp ; une exposition permanente leur est consacrée, actuellement en rénovation. Ce choix d’ouverture répond à un principe : préserver la mémoire tout en s’ouvrant à la citoyenneté et à l’altérité.
Les éructations du RN : un rejet de la pluralité mémorielle
Le 25 septembre 2025, jour national d’hommage aux harkis, le député Laurent Jacobelli s’est rendu au Mémorial. Alors que l’institution organisait un programme en hommage aux harkis, l’élu du Rassemblement national a filmé une tribune où il dénonçait « le temple du gauchisme » et du « wokisme » qu’aurait selon lui l’endroit. A l’écouter, les collectivités locales auraient « volé » le mémorial pour en faire un lieu militant où l’on donnerait « des expositions sur l’Ouganda, les LGBT, tout et rien, pour diffuser une pensée pro‑migrants », et l’on ne parlerait plus des harkis.
Cette colère a suscité une réponse ferme. Laurent Joly, directeur du conseil scientifique, a rappelé que ces propos étaient factuellement inexacts : le Mémorial travaille « sur toutes les mémoires du camp, dont celle des harkis » et l’insulte de « temple du wokisme » relève d’une pensée slogan ignorant le travail des équipes. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, a dénoncé des propos « indécents et insultants » révélant une profonde ignorance de l’histoire locale et un irrespect envers ceux qui ont subi les heures sombres de notre pays. Ces rappels soulignent que la vraie mission du Mémorial est de transmettre et de relier les mémoires plutôt que de servir les anathèmes.
La crise montre en creux la gêne du Rassemblement national. Parce que le Mémorial s’est affirmé comme un lieu vivant où s’expriment des récits multiples – histoire des harkis, mémoires juives, luttes LGBT+ –, la formation d’extrême droite y perçoit une remise en cause de son récit monolithique. Loin de se réjouir que le département puisse disposer d’un pôle culturel dédié à la liberté d’expression, elle y voit un « temple du wokisme » et accuse les collectivités de « voler » une mémoire qui ne leur appartiendrait pas. Cette crispation révèle un rapport anxieux à la pluralité : l’institution est accusée parce qu’elle met en valeur des minorités qui ne cadrent pas avec la vision identitaire du RN.
Harkis et électoralisme : l’ambivalence du Rassemblement national
Le Rassemblement national se présente volontiers comme le défenseur des harkis et des rapatriés. Pourtant, les archives et le travail des historiens montrent une relation bien plus ambiguë. Jean‑Marie Le Pen se prévaut d’avoir « toujours été du côté des harkis », mais la première grande manifestation publique en leur faveur à laquelle il participe ne date que de 2011, à Mas‑Thibert ; sa venue tardive est immédiatement critiquée comme un geste de campagne présidentiel. Dans son analyse des origines du Front national, l’historien Abderahmen Moumen rappelle que le parti s’est approprié le discours de l’Algérie française et que la thématique des harkis est réactivée « à la veille des échéances électorales ». Cette mémoire instrumentalisée est moins une solidarité qu’une ressource politique.
L’ambivalence se poursuit avec Marine Le Pen. En 2022 elle estime qu’il ne saurait être question de réconcilier les mémoires si cela revient à « se flageller devant l’Algérie » et que la France ne doit répondre au devoir de mémoire que si l’Algérie demande pardon aux harkis. Ce discours conditionnel, qui réclame une repentance croisée pour consentir à la compassion, montre que la mémoire des harkis est utilisée comme un levier dans la compétition électorale et dans les relations internationales. Dans les faits, le Rassemblement national multiplie les hommages mais ses prises de position demeurent fluctuantes ; des polémiques récurrentes, comme l’attaque du Mémorial par Laurent Jacobelli, révèlent les limites de ce soutien.
Les critiques savantes rappellent que l’extrême droite confond souvent pieds‑noirs, harkis et partisans de l’Algérie française, amalgamant des mémoires distinctes. Cette confusion nourrit un paradoxe : comment prétendre défendre les harkis tout en rejetant l’immigration maghrébine ? Les contradictions s’accumulent : la mémoire harkie est utilisée comme symbole de l’abandon de la France plutôt que comme cause sociale, et l’amalgame avec l’Algérie française masque la singularité de leur destin.
Une méditation sur la mémoire et la liberté
En contemplant le Mémorial de Rivesaltes, je pense à ces murs épais qui ont vu passer les vents de l’Histoire et les cris étouffés des exilés. De la guerre d’Espagne à la guerre d’Algérie, de la Shoah au confinement des harkis, le lieu est un palimpseste. Le visiter, c’est sentir les paroles des absents qui murmurent, c’est entendre les pas des survivants qui résonnent sous les galets.
La polémique suscitée par le député Jacobelli me rappelle une leçon simple : la mémoire n’est pas un bien privatif. Elle est un fleuve à plusieurs sources, un chantier où se tressent des récits, des blessures, des espérances. Ceux qui se sentent trahis lorsqu’une institution publique accueille une projection sur les droits LGBT+ ou un débat sur l’exil confondent la conservation avec la fermeture. Or, ce qui donne sens à un lieu de mémoire, c’est précisément sa capacité à faire dialoguer des expériences diverses.
Symbole de pluralisme et de lucidité historique, le Mémorial de Rivesaltes fait donc affleurer les voix des réfugiés espagnols, des juifs déportés, des nomades et des harkis, là où la mairie RN voisine de Perpignan se contente de slogans creux et d’une politique Identitaire doublée d’un conservatisme revanchard. En qualifiant ce lieu de « temple du wokisme » et en s’offusquant qu’il accueille des projections sur des sujets contemporains, les divers élus du parti dévoilent leur intolérance à toute mise en perspective qui dépasse le récit national figé. Cette animosité révèle en réalité l’impasse d’une mairie qui, faute de vision pour sa ville, s’acharne à dénigrer un monument que sa municipalité n’a ni créé ni compris, préférant l’anathème à l’émancipation. Incarnation d’une culture vivante et inclusive, le Mémorial expose par contraste la défaite culturelle de tout ce que honnit le RN : le dialogue, la diversité des mémoires et la véritable liberté d’expression.
Écrivain de ce pays aux racines multiples, je vois dans le Mémorial un symbole de liberté d’expression : un pôle où l’on ose confronter des histoires et où l’on apprend que la dignité humaine ne se divise pas. Le Rassemblement national éructe parce qu’il redoute ce brassage qui dérange les certitudes. Mais l’éthique de la mémoire exige l’inverse : accueillir l’autre dans sa différence pour mieux comprendre nos propres histoires. C’est ainsi que ce lieu, en mêlant mémoire des harkis et combats contemporains, honore sa vocation.
En fin de compte, la question n’est pas de savoir si l’on parle assez des harkis ; elle est de savoir si l’on est prêt à écouter toutes les voix. Le Mémorial de Rivesaltes, par ses expositions, ses festivals et ses conférences, montre que la liberté d’expression est un acte de réparation. Refuser d’en faire un simple totem identitaire, c’est choisir de faire de l’histoire un espace de rencontre et de réflexion – ce que les héritiers de l’extrême droite, pris dans leurs contradictions, semblent avoir tant de mal à accepter.