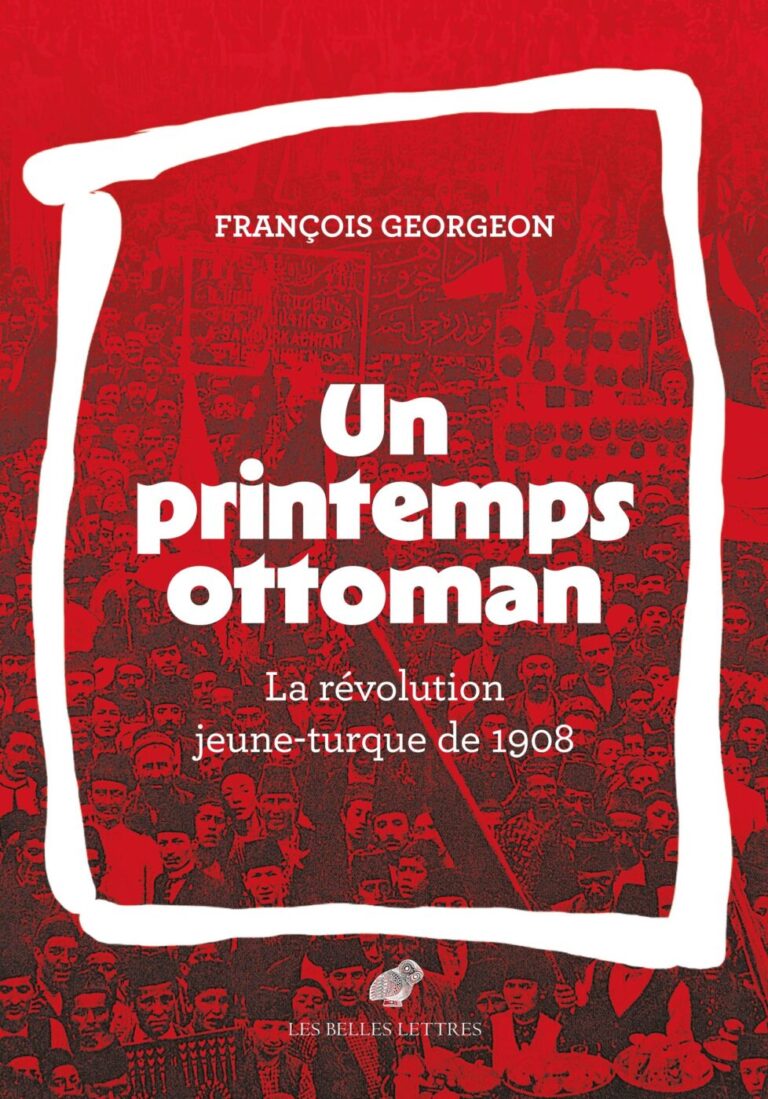Lorsqu’il s’installe à San Francisco en 1977, Kevin Bentley commence un journal : ses errances, ses quêtes, ses espoirs deviennent les nôtres. À travers deux décennies, tout un monde se déploie, empli d’écriture, de liberté et d’amours poignantes.
Au moment où je commençais Mes animaux sauvages, ma pile de livres à lire s’enrichissait du journal d’Arthur Dreyfus ; et tout à coup, je me suis demandé quel intérêt nous pouvions trouver à la lecture du journal d’un autre. Le début me semblait d’abord un peu long, quoique le diariste n’écrive pas tous les jours. Les nouveaux amis, les prénoms qui vont et viennent donnent le vertige. La succession de rencontres et la description précise des rapports sexuels satisfaisaient bien sûr un certain voyeurisme, mais cela ne pouvait pas suffire. En réalité, très rapidement, la curiosité pour l’expérience du quotidien de ce jeune homme s’approfondit. Comme dans un roman, l’identification fonctionne à plein. Son expérience est la nôtre.
On comprend souvent très mal cette notion d’identification. Il ne s’agit pas d’un trouble psychanalytique de perte d’identité pour acquérir, le temps d’une lecture ou plus longuement, une autre personnalité, une vie différente. C’est une expérience humaine, anthropologique, qui réside dans la reconnaissance de l’autre comme un autre moi-même. L’expérience fonctionne dans les deux sens : parce que je reconnais le diariste (ou le personnage d’un roman) comme mon semblable, parce que son expérience, quoique singulière, devient par la puissance de l’écriture, aussi la mienne, le livre me reconnaît en humanité. Et cette expérience-là, “Mes animaux sauvages” la réalise de la plus belle des manières car, très vite, la succession de ces rencontres éphémères révèle notre propre solitude, notre quête d’achèvement dans une relation. On touche là l’universel humain, l’universalité anthropologique. Voilà pourquoi il faut lire les bons journaux, voilà pourquoi le journal de Kevin Bentley connaît un tel succès depuis sa parution, et ici en France, avec la traduction de Romaric Vinet-Kammerer.
L’écriture du journal permet à celui qui tient la plume de prendre de la distance par rapport à sa vie, tout en étant dans l’immédiateté vitale du quotidien. Les émotions s’y lisent sur le vif, mais l’écriture introduit déjà une forme de recul. L’humour en est la manifestation la plus agréable et donne de l’entrain à la lecture. Il révèle l’ironie qui nous échappe parfois et devient un signe pour l’auteur :
Lorsque le pompiste de l’une des stations-service de Needles posa les yeux sur ma plaque d’immatriculation texane et me demanda avec un clin d’œil s’il était vrai que tout était plus gros au Texas, j’ai su que j’avais pris la bonne direction.
Il est frappant d’ailleurs, que le journal s’interrompe lorsque le quotidien prend toute la place, lorsque l’émotion submerge et que l’observer hors de soi-même devient un effort trop difficile. L’année 1986 tient en deux dates. Le 1er février, Kevin, enfin en couple et assis seul dans un bar, se souvient sans regret quand, à cette même place, il espérait rencontrer quelqu’un. Le 1er mars, dans la librairie où il travaille, après avoir transféré un appel à sa collègue Martha, il s’inquiétait de la trouver en larmes. Est-ce que son mari aurait découvert qu’elle le trompait ? Non, ce n’est que le chat de sa mère qui est mort. “Je l’ai prise dans mes bras avec un grand sourire de soulagement contre mon épaule.” Le soulagement ne peut être que de courte durée dans ces premières années de la découverte du sida.
Rien pour l’année 1987.
1988 se résume en une seule date, celle du 30 juillet :
Il y a trois ans, j’ai répondu au sourire d’un mec canon assis au bar du Giraffe, et une nouvelle vie a commencé. Maintenant que les événements des six derniers mois refluent, lorsqu’une pensée ou un objet, soudain, le font réapparaître devant moi avec netteté, c’est l’horreur.
Le prénom s’efface. La mise à distance est trop difficile. L’indicible de la douleur se dit mieux dans le silence et le repli. Il y aura d’autres rencontres, un autre amour, une nouvelle interruption, mais la vie malgré tout l’emporte. Ce n’est pas un journal du VIH, ni un carnet de coups d’un soir, pas plus qu’une ode à San Francisco. Il n’en ressort pas moins de Mes animaux sauvages, une très belle fresque humaine où la liberté, le sexe, les drogues, l’humour, l’amour scintillent de tous leurs feux.
Dans la postface, Kevin Bentley explique “aux animaux apprivoisés de 2020”, que ce journal était une tentative pour le “gamin” qu’il était “de répondre à la question : Qui suis-je ? Et, de manière plus pressante encore : Qui m’aimera ?”. Poser ces questions est plus important que la réponse. Aucune n’est mauvaise. “Qui suis-je ?” et “qui m’aimera ?” sont les deux questions fondamentales qui ouvrent en nous une béance dans laquelle nous espérons qu’un autre s’engouffrera. Alors, est-ce que cela vaut le coup de lire un journal, de lire “Mes animaux sauvages” ? Répondons comme Kevin Bentley à la dernière ligne : “Oui, j’ai répondu”.
Marc DECOUDUN
contact@marenostrum.pm
Bentley, Kevin, “Mes animaux sauvages : journaux de Polk Street et d’après”, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Romaric Vinet-Kammerer, Éditions Philippe Rey, 07/01/2021, 1 vol. (301 p.), 20,00€
Retrouvez cet ouvrage chez votre LIBRAIRE près de chez vous ou sur le site de L’ÉDITEUR