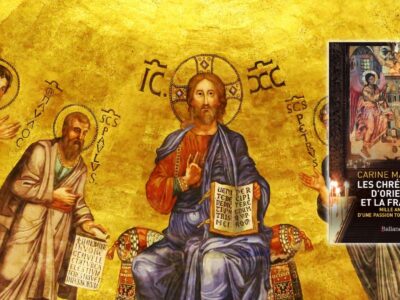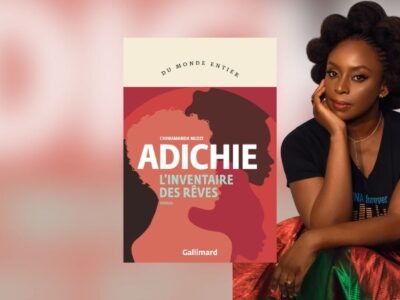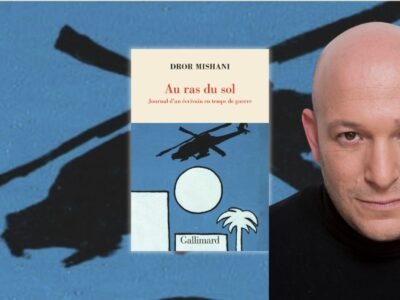Tamás Gyurkovics, Migraine – Une histoire de culpabilité, traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba, Viviane Hamy, 04/09/2024, 416p, 23,50€.
Tamás Gyurkovics, plume incisive de la littérature hongroise contemporaine, excelle à explorer les profondeurs insondables de la psyché humaine, ces zones d’ombre où se nichent la culpabilité et le poids implacable du passé. Migraine traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba, confirme cette inclination. Ce roman, poignant et bouleversant, dresse le portrait saisissant de Zvi Spielmann, un rescapé de l’Holocauste vivant en Israël dans les années 1960, un homme dont l’âme est traversée par une douleur lancinante, écho fantomatique de son passé et des horreurs auxquelles il a survécu. La métaphore des migraines, saisissantes dans leur brutalité et leur constance, se révèle rapidement une transposition viscérale de ses tourments intérieurs, et offre une perspective éclairante sur la puissance insidieuse de la mémoire collective.
Entre silence et souvenirs : le spectre du passé
L’œuvre débute par le tableau saisissant d’un quotidien soigneusement organisé, d’une existence rythmée par les rituels immuables et réconfortants d’une vie paisible. Zvi Spielmann, comptable méticuleux dans un théâtre israélien, évolue dans une routine soigneusement construite autour du travail, de sa femme, Nitza, et de leurs enfants. Cette impression de stabilité est rapidement mise à mal par la présence lancinante et destructrice des migraines qui frappent Zvi avec une intensité terrifiante. “Une veine se contracte dans la tête de Spielmann. Il appuie fortement sur son front, mais il espère plutôt que la sauce forte et épaisse du ragoût de Nitza fera passer cette crise-là aussi”. Ce passage met en évidence l’ambiguïté de ses symptômes: douleur physique, manifestation psychosomatique, expression d’un mal profond et impensable ? Le voile se lève progressivement sur les cauchemars qui assaillent Zvi, irruptions soudaines et douloureuses de son passé au camp de Birkenau. Le lecteur, à l’instar de la famille de Spielmann, est plongé dans une ambiance où domine le silence et l’absence, une tension constante née de la difficulté à partager et à exprimer l’indicible.
Si la question de la transmission du traumatisme se pose dès le départ, les premières parties se focalisent avant tout sur le combat intérieur de Zvi. L’auteur Tamás Gyurkovics nous dévoile l’intimité meurtrie de son personnage et ses tentatives désespérées pour endiguer le flot des souvenirs qui l’assaillent. Nitza est présente, bien sûr, mais plus comme un témoin muet, une figure bienveillante et protectrice, qu’un interlocuteur véritablement apte à dialoguer avec le fantôme omniprésent du passé. “Chacun a des souvenirs différents, dit Mme Fischel, conciliante. Il y en a qui ne se souviennent de rien.” La réplique, prononcée par la voisine lors d’une conversation banale entre femmes, prend une résonance toute particulière. Cette phrase, dans sa simplicité désarmante, met en lumière un des nœuds centraux du récit : l’impossibilité de véritablement comprendre et partager l’expérience traumatique, et ce, même pour les êtres les plus proches.
la culpabilité : un poids partagé
“Spielmann, car elle vit ici depuis ses deux ans” La réplique met en relief le questionnement autour de la transmission : comment l’innocence peut-elle s’épanouir sous le ciel lourd d’une histoire si sombre ? La culpabilité, sentiment complexe et insidieux, devient un des fils conducteurs du roman. Zvi Spielmann, nommé Zwillingsvater (Père des Jumeaux) durant l’Holocauste, a été responsable de la vie d’enfants utilisés pour des expérimentations médicales à Birkenau. Ce passé, cette lourde responsabilité dans un contexte de violence et d’arbitraire absolus, se révèle une blessure impossible à cicatriser.
L’arrivée d’anciens jumeaux à Tel-Aviv, les frères Salamon, confronte brutalement Zvi au spectre du passé. Cette rencontre, loin d’apporter le soulagement d’une réconciliation, réveille ses angoisses et met en relief l’impuissance qui le ronge face à l’incommensurable injustice de ce qu’il a vécu et à l’immensité du deuil des familles détruites. Ses migraines, saisissantes dans leur violence, resurgissent avec une intensité redoublée, comme si la douleur physique devait compenser le manque de mots, l’impuissance face au langage. “L’ordre et son père, son père et l’ordre“. La phrase, lancée par la fille de Zvi, résume parfaitement la recherche vaine de structure et de contrôle face au chaos d’une existence meurtrie, et nous éclaire sur la tentative désespérée d’ordonner le chaos du passé pour retrouver un semblant de sens.
Au miroir des lettres : une transmission impossible ?
“Ne pas penser aux jumeaux, voilà le plus dur“. Zvi garde précieusement, à l’insu de sa femme, les lettres des enfants survivants. Ces lettres sont un témoignage du passé, un lien ténu et fragile entre l’horreur vécue et le fragile échafaudage d’un nouveau présent, mais aussi l’expression muette d’une impossible transmission. Si le roman explore en profondeur l’impact de la Shoah sur la génération des survivants, la dimension transgénérationnelle de la culpabilité est subtilement distillée, par touches et allusions, dans ces premières parties. On la perçoit à travers le malaise diffus qui entoure le petit Israël, un enfant né “ici, rue Bitzaron, où le voisinage n’est composé que de gens de leur espèce, Tchèques, Polonais et Hongrois ; des rescapés, comme eux”, et qui grandit dans “l’ombre des maux de tête” de son père. Leurs échanges, quoique touchants, restent marqués par une distance affective perceptible, qui contraste avec l’intimité instinctive liant Zvi et Nitza. Les silences de Spielmann s’apparentent à un mur invisible, édifié pour protéger les siens de la douleur, mais qui entrave la communication et accentue leur isolement.
“C’était une idée soudaine“. Nitza décide, sur un coup de tête, de rejoindre Zvi au théâtre. La rencontre inopinée de son mari avec deux hommes “qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau”, rescapés venus lui réclamer une promesse faite à Birkenau, va faire basculer l’équilibre précaire du récit. La peur instinctive de Nitza, sa décision impulsive d’inviter les hommes chez eux, met en évidence la fracture grandissante, un écart abyssal creusé par le poids du passé. Cette première fissure laisse entrevoir les contours d’une culpabilité transgénérationnelle, la certitude instinctive que la transmission, même inconsciente, est inévitable.
Vers la transmission: rupture et déni
Migraine de Tamás Gyurkovics s’impose par son intensité et sa finesse psychologique. La plume dépouillée et saisissante de l’auteur est un scalpel qui fouille les recoins obscures de l’âme et révèle la douleur d’une vie brisée. L’alternance entre prose tranchante et poésie mélancolique souligne la fragilité du présent de Zvi, homme dont la quête illusoire de rédemption se révèle un chemin tortueux et pavé d’obstacles, où les spectres du passé se font sans cesse plus tangibles et obsédants. En utilisant le mal de tête comme une métaphore viscérale du traumatisme, Tamás Gyurkovics explore avec une justesse rare la question du rapport à la mémoire et du rôle ambivalent qu’elle joue dans la construction identitaire.
Si on retrouve l’ombre portée de l’expérience concentrationnaire et l’introspection désespérée des personnages dans l’œuvre d’écrivains comme Imre Kertész et Primo Levi, le roman de Tamás Gyurkovics se démarque par l’intégration subtile de la question transgénérationnelle, explorée à travers le lien conflictuel et muet qui lie Zvi et sa fille. Le roman s’interroge également sur la question complexe de la transmission de la mémoire: jusqu’où sommes-nous obligés de porter le fardeau du passé ? Comment le dialogue avec les générations futures peut-il s’établir ? Comment partager l’indicible, et faire du souvenir le terreau d’un avenir possible, libéré des spectres qui hantent l’ombre des survivants ? Migraine est une œuvre bouleversante et essentielle, un coup de poing littéraire qui explore les profondeurs de la culpabilité et le poids indélébile du passé, à lire absolument pour la force et la beauté de son récit.

Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.