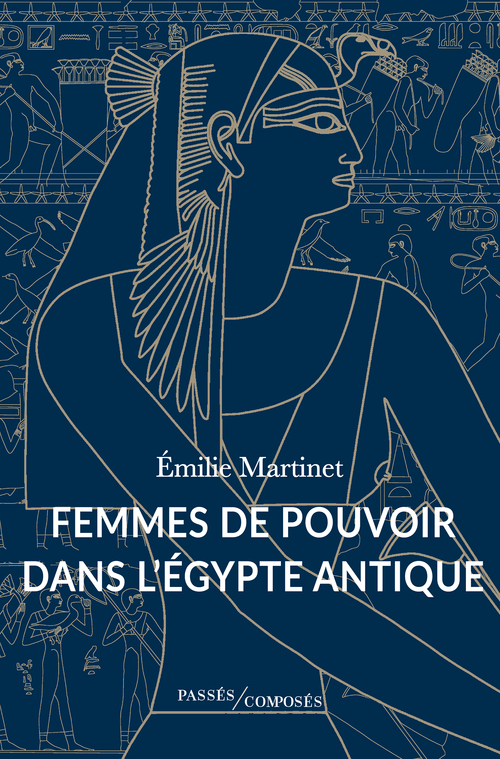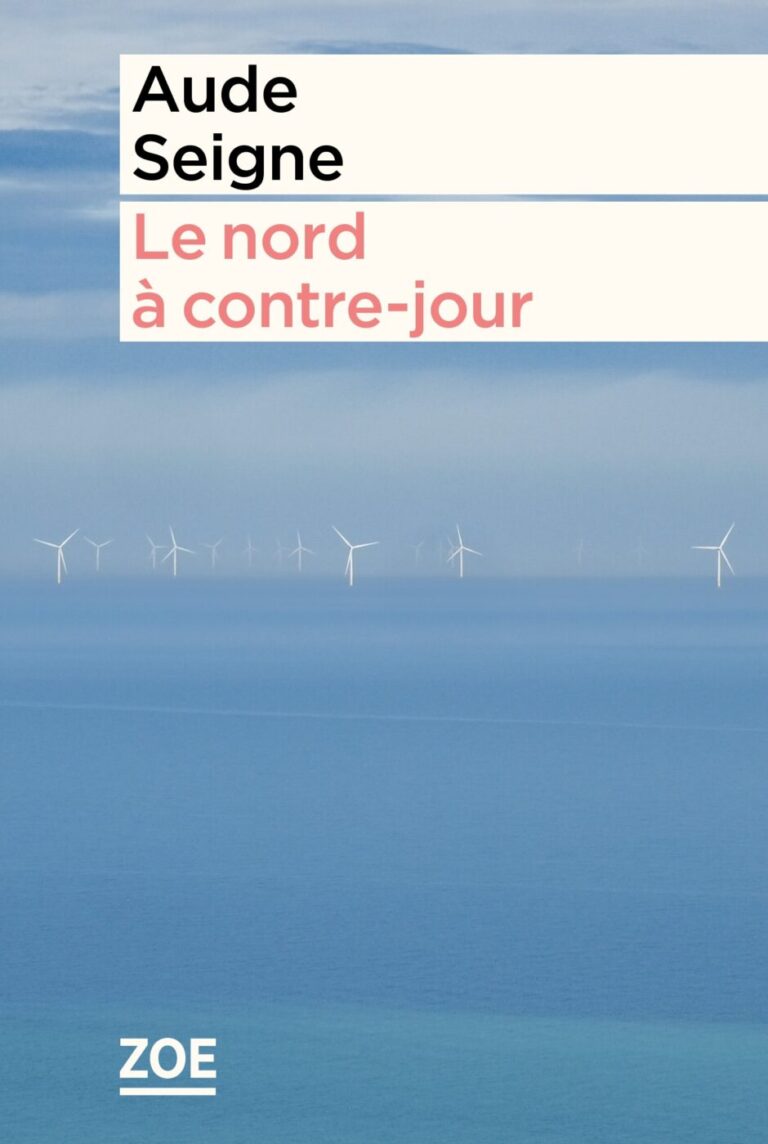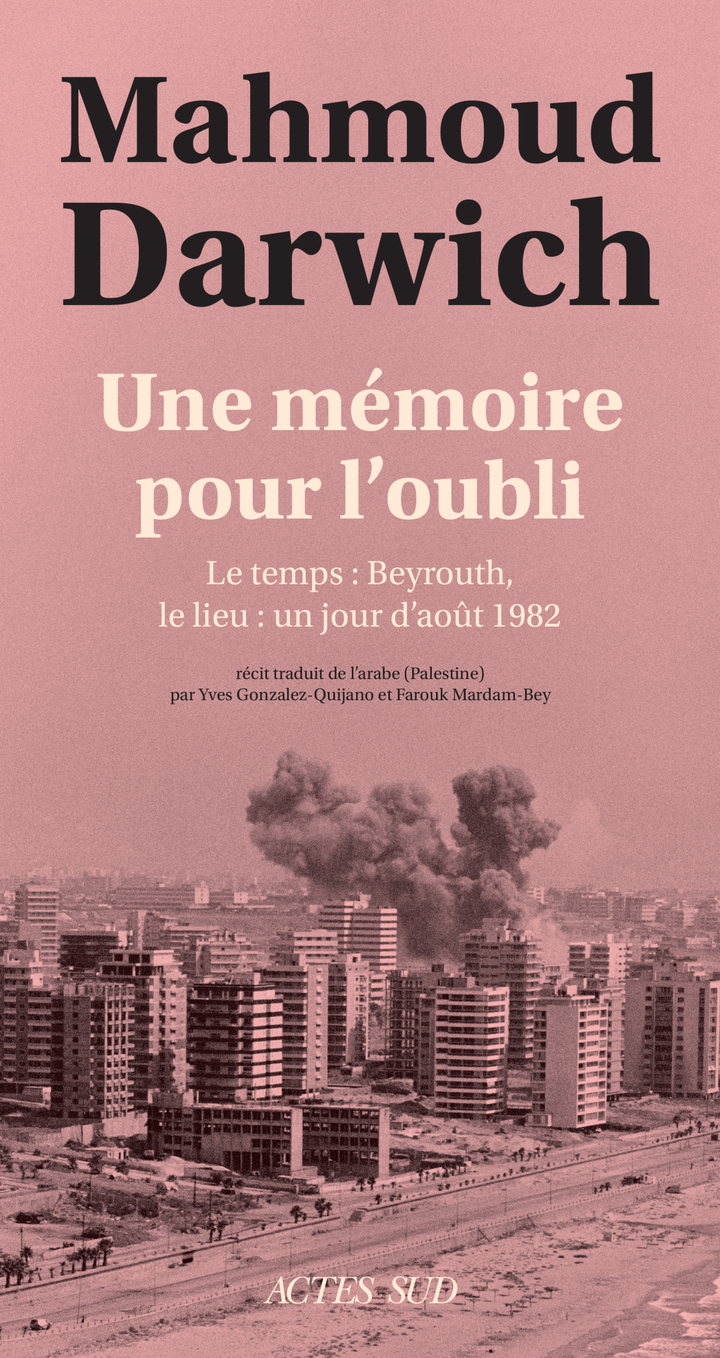Laurent Devèze, Les Grecs, leurs mythes et nous, Le Condottiere, 23/09/2025, 212 pages, 16€
Écoutez notre Podcast
Diplomate, philosophe de l’art et écrivain polymorphe, Laurent Devèze, sous la forme d’une « transe écrite », s’empare des mythes grecs pour en révéler l’écho en lui — et donc en nous. Dans ce texte inclassable, il refuse toute glose pour mieux laisser les figures d’Athéna, de Narcisse ou d’Œdipe infiltrer nos contemporanéités. Le mythe s’y fait souffle, possession, et parfois rire grinçant. Une lecture qui déconcerte, puis envoûte.
I. Les mythes grecs comme expérience vivante : refus de l’analyse, éloge de la transe
À la croisée de la mythologie grecque, de la philosophie, de la mémoire collective, de la poétique de l’intime, de la critique des stéréotypes contemporains, de la généalogie des récits fondateurs, de la psychanalyse revisitée, de la littérature autobiographique, de la symbolique du corps, de la métaphysique, de la théorie des genres, de la réflexion sur le langage, de la sociologie contemporaine et d’une lecture vivante du mythe, Les Grecs, leurs mythes et nous porte une ambition singulière : restituer aux récits anciens leur puissance d’ébranlement, leur capacité à traverser les siècles pour venir nous saisir aujourd’hui, là où nous sommes, dans nos vies ordinaires et nos questions les plus brûlantes.
Laurent Devèze pose d’emblée un geste radical. Dès l’inauguration du livre, il prévient : « cet ouvrage ne contient aucun commentaire des mythes grecs ». Formule paradoxale pour un essai qui leur consacre deux cents pages. Mais justement, il s’agit de tout autre chose. L’auteur refuse la posture du savant penché sur son objet d’étude. Il se veut « scribe dévoué », « passeur », « chaman béni d’un sens inoculé ». Les mythes s’écoutent et ne se lisent pas. Leur parole envahit nos conduits auditifs, monte à la tête, exige une réponse qui engage le corps autant que l’esprit.
Une écriture incarnée : quand Méduse surgit dans le métro parisien
Cette profession de foi ouvre un livre qui tient autant du carnet de voyage que du journal intime, de l’essai philosophique que du poème en prose. Le dispositif formel frappe d’emblée : chaque chapitre porte le nom d’une figure mythologique – Méduse, Œdipe, Narcisse, Sisyphe – et raconte sa rencontre avec l’auteur dans un lieu contemporain précis. Méduse surgit dans les couloirs du métro parisien. Œdipe parle depuis une caravane gitane. Narcisse se mire dans les plages naturistes. Dionysos investit un restaurant gastronomique. Cette structure livre après livre bâtit une géographie intime où les mythes habitent notre monde, se manifestent dans sa chair même, imposent leur présence comme une transe.
L’écriture épouse ce mouvement d’apparition. Phrases longues qui se déploient en incises successives, accumulations qui miment l’ivresse ou l’étourdissement, ruptures de ton qui passent du grave au facétieux, du lyrique au trivial. Le style refuse toute neutralité pour assumer une subjectivité pleine et entière. L’auteur raconte comment les mythes le saisissent, souvent à son corps défendant, dans des moments où il pensait à tout autre chose. « Rien, ce mardi matin quelconque, ne me disposait à la réflexion mythique », écrit-il avant de raconter sa rencontre avec Hypnos et Thanatos dans une station de sports d’hiver détestée. Les figures mythologiques surgissent précisément quand on les attend le moins, investissent les creux de l’existence, les moments de vacuité ou de désœuvrement.
Méduse et les mères qui hurlent : du mythe à la géopolitique contemporaine
Méduse ouvre le livre. Traditionnellement présentée comme un monstre qu’il faut décapiter, elle apparaît ici sous les traits d’une femme qui hurle. « C’est par la peur diffuse autant qu’incontrôlée qu’elle l’inspire que je l’ai tout de suite reconnue avec son histoire de Gorgone : maudite par Athéna, dotée en punition d’un terrible pouvoir, celui de nous pétrifier par son seul regard. » Mais très vite, l’auteur opère un renversement : « Méduse est le nom d’une bien terrible surdité. » La pétrification vient de nous, de notre refus d’écouter, de notre lâcheté devant la douleur du monde. Elle devient alors la figure de toutes ces mères qui crient devant le corps de leur enfant mort : les Folles de mai en Argentine, les mères de Tiananmen, toutes celles qui refusent d’oublier leurs disparus. « Oui, elle m’a dit que l’on n’entend que trop rarement ceux qui hurlent. »
Cette relecture traverse tout l’ouvrage. Les mythes cessent d’être des fables moralisatrices pour devenir des miroirs de nos contradictions contemporaines.
II. Œdipe, Narcisse, Sisyphe : trois figures pour penser la modernité et ses impasses
Œdipe l’errant : éloge du départ contre l’assignation familiale
Œdipe succède à Méduse. Dans une caravane gitane près des côtes languedociennes, le fils de Laïos confie à l’auteur ce que l’Histoire a oublié : son nom signifie « pieds enflés ». « C’est au camp qu’il en vint en somme à l’essentiel qu’on occulte trop souvent dans les péripéties d’un récit tant de fois rabattues : il ne cesse jamais de rompre les amarres. Toutes. » Œdipe incarne alors la figure du départ, de l’errance, de celui qui refuse l’assignation à résidence familiale. « Il a couru, seul, les pistes de sable et les chemins jaunes hérissés de pierres. » Sa malédiction devient une libération : partir, toujours partir, quitte à tuer symboliquement le père et à s’arracher à l’amour dévorateur de la mère. Laurent Devèze retrouve là l’écho de Rimbaud, de Freud en exil, de tous ceux qui ont préféré la route aux pénates.
Narcisse et l’ère des influenceurs : quand la beauté consciente d’elle-même se détruit
Narcisse, à son tour, se dévoile autrement. Sur une plage naturiste, Le philosophe observe un jeune père jouant avec son enfant, « inconscient, totalement indifférent à nous tous qui le regardions pourtant, tant il était obnubilé et attendri par la petite bavouille que l’asticot secrétait sur son épaule ». Cette scène révèle le secret du mythe : « La beauté qu’on aurait reconnue foudroyante dans l’indifférence à nos regards devient au contraire chochotte et maniérée, en un mot, hideuse, dans sa pitoyable attente d’un effet supposé. » Narcisse meurt de trop se contempler, de perdre cette innocence qui seule rend désirable. L’auteur évoque alors les jeunes influenceurs coréens qui se suicident parce qu’ils vieillissent, prisonniers d’une image qui les dévore. « Narcisse était il y a bien longtemps, toujours déjà sur X et autres réseaux d’enfants assassinés ou meurtris. »
Sisyphe l’écrivain : pourquoi les livres roulent toujours en bas de la montagne
Sisyphe apparaît devant un centre commercial. Face aux vitrines, Devèze songe à tous ces livres écrits contre l’horreur humaine qui roulent aussitôt en bas de la pente, oubliés, inefficaces. « Les dieux ont fait erreur, c’est une illusion, il ne recommence jamais. » Car Sisyphe connaît de mieux en mieux son chemin, apprend les pièges du terrain. Il incarne la figure du créateur qui sait que rien ne sera retenu, que chaque génération devra recommencer le même combat. « Balzac, Proust, Montaigne, Rousseau, ou La Boétie… N’en jetez plus ! » Tous ont poussé leur pierre au sommet. Tous l’ont vue redescendre. « Mais une telle Florence aura beau se refonder un nouveau Sisyphe se remettra à l’ouvrage, toujours condamné à l’infatigable tâche, jusqu’à ce que son travail soit à nouveau piétiné. »
Prométhée et l’ivresse du savoir : penser, c’est toujours voler les dieux
Prométhée débarque dans un bar de Lille, casque de chantier sur la tête. Le voleur de feu révèle son secret : « tu imagines la pédagogie naturiste et en transe qu’il faudrait déployer pour être vraiment honnête avec nous ? » Il incarne l’ivresse du savoir, la passion qui consume, l’addiction au travail intellectuel. « Penser à la dérobée », voilà sa devise. « Pour ce prisonnier, tout penseur véritable est toujours un peu malandrin. » Laurent Devèze évoque Rimbaud, Gurdjieff, tous ceux qui ont payé de leur corps leur soif de connaissance. Prométhée assume son foie dévoré, sa douleur éternelle, parce qu’il sait que « l’on n’approche pas les secrets des Dieux les plus inaccessibles sans quitter l’état normal de notre quotidien ».
III. Pénélope, Ganymède, Héraklès : la face cachée des héros antiques
Pénélope ou la maladie du perfectionnisme : quand l’artiste détruit son œuvre
Pénélope tisse et détisse, mais pas pour les raisons qu’on croit. Dans les ruelles d’Ithaque, elle confie à l’auteur sa vraie maladie : « une obsessionnelle de la perfection ». Chaque aurore la trouve déchirant son ouvrage de la veille, jamais satisfaite, toujours recommençant. « Les Saintes victoires ne consacrent que trop rarement, hélas, la victoire de la Sainte. » Elle devient la sainte patronne de tous les artistes qui détruisent leur œuvre, incapables de s’en contenter. « Ce n’est pas ça, pas exactement ça, que je voulais exprimer. » L’auteur reconnaît là son propre tourment d’écrivain, cette impossibilité d’achever vraiment, cette souffrance du créateur face à l’écart entre le rêve et sa réalisation.
Ganymède refuse d’être une victime : éloge du service et de la séduction
Ganymède surgit à Sounion, provocant et désirable. Le bel échanson refuse le statut de victime. « Tu trouves que j’ai l’air d’une victime, franchement ? » Il revendique sa beauté, son pouvoir de séduction, sa capacité à avoir conquis Zeus lui-même. « Tâche de bien leur faire comprendre, je suis l’Irrésistible. » Laurent Devèze en fait le patron des serveurs, de tous ceux qui tissent le lien social en servant les autres. « Servir », explique-t-il, « c’est communier activement, faire en sorte par son service même, que les plus solitaires se sentent appartenir à une réalité collective, à une quasi tribu. » Ganymède révèle qu’une société incapable d’honorer ses serviteurs finit par ne plus glorifier que ses guerriers solitaires.
Héraklès épuisé : quand l’ambition dévore celui qui la porte
Héraklès traîne les pieds dans les rues de Paris. Le héros aux douze travaux avoue sa fatigue, son épuisement. « Il n’a jamais su vraiment, m’a-t-il confié, ce qui l’avait ainsi poussé à pédaler dans le moulin à hamster jusqu’à ce que, à bout de souffle, il épouse enfin, gale comprise, ces oripeaux de SDF. » Il incarne tous ces bourreaux de travail incapables de s’arrêter, courant après la reconnaissance, accumulant les succès sans jamais trouver la paix. « Douze fois médaillés par exemple, et ce n’est pas encore assez, car arrivera le temps de la chute. » Héraklès regrette amèrement d’avoir sacrifié sa vie à cette ambition dévorante, d’avoir tué symboliquement ses enfants en les négligeant.
IV. Midas, Érysichthon, Actéon : trois mythes pour repenser nos tabous contemporains
Midas et l’éloge de la mauvaise écoute : contre le bon goût obligatoire
Midas apparaît à la Porte Saint-Denis. Le roi aux oreilles d’âne confie à l’auteur son secret : il préférait Pan à Apollon parce qu’il se méfiait du « chiadé » et du « propret ». « Midas est de cette aristocratie-là. Celle qui se fiche du bon goût et des admirations obligées, il a horreur de l’attendu comme du propret et du bien calculé. Il conchie le chiadé. » Il devient le patron de tous ceux qui écoutent vraiment, qui refusent les convenances esthétiques. « Écouter, c’est refuser sa toute-puissance personnelle », écrit Laurent Devèze. Dans une civilisation du bruit et du bavardage, Midas rappelle l’importance du silence, de l’attention, de la disponibilité à ce qui vient nous surprendre.
Érysichthon le bâtisseur : défense de la ville contre la nostalgie de la nature
Érysichthon débarque à Euralille, casque de chantier vissé sur le crâne. Le destructeur d’arbres sacrés révèle sa vérité : il aime construire, bâtir des logements sociaux, arracher aux nantis leurs parcs pour offrir un toit aux plus pauvres. « Lui, il a la vocation de construire et de nous mettre à l’abri. » Le philosophe défend alors l’audace de ceux qui transforment le monde contre les conservateurs de la nature. « Érysichthon et moi nous amusions de voir ces critiques provenir de déesses et de dieux toujours planqués dans leurs temples bien au chaud. » Le mythe devient une défense de la modernité, de la ville contre la nostalgie rurale.
Actéon et la fluidité des genres : quand les mythes refusent toute assignation
Actéon surgit dans une piscine de Stockholm. Artémis l’observe au bain, détaillant les corps nus des nageurs. Mais dans la bouche de Laurent Devèze, Actéon assume un autre visage : celui qui voulait contempler le divin dans sa nudité absolue, quitte à en mourir. « Se laisser dévorer par sa foi, cette fides si canine », voilà ce que raconte vraiment ce mythe. Et lorsque l’auteur comprend qu’Actéon est devenu femme dans sa vision, le texte bascule : « C’est en cerf ou en biche, ces métamorphoses n’en finissent pas de m’ouvrir de très belles et très excitantes perspectives. » Le mythe refuse toute assignation de genre, toute lecture univoque.
V. Achille, Terpsichore, Clio : la transmission du savoir entre corps et esprit
Achille et la culpabilité du maître : quand transmettre, c’est risquer de tuer
Achille pleure Patrocle dans les arènes de Béziers. Le héros invincible confie à l’auteur sa culpabilité : « Patrocle, qu’il se reprochait devant moi de ne pas avoir su protéger de lui-même : Tu dois le comprendre, il est mort de m’avoir imité. » Achille incarne alors la responsabilité terrible de celui qui transmet un savoir, d’un maître face à son disciple. « Qu’ai-je fait pour qu’il m’imite, lui que je voyais depuis toujours tracer sa propre voie ? » La leçon est cruelle : enseigner, c’est risquer de tuer celui qu’on aime en lui donnant des armes trop effilées trop tôt. « L’on ne peut pas ne pas aimer son élève et encore moins ne pas être aimé de lui lorsque le miracle advenait, mais l’inoculation culturelle devait vacciner et ne jamais contaminer. »
Terpsichore danse : contre les bibliothèques, le savoir du corps
Terpsichore danse dans un village héraultais lors d’une fête populaire. La muse refuse les mots, préfère le mouvement. « Comment vous transcrire en mots la sapience qu’elle me délivra, muette, trop occupée à faire parler son corps ? » Elle entraîne l’auteur dans une transe collective où rugbymen et paysans, jeunes et vieux, se mêlent dans une ronde démocratique. « Toute autre prétention d’écriture se ferait éloignement. » Terpsichore incarne le savoir du corps, celui qui échappe aux bibliothèques, qui se transmet par le geste et le rythme. « L’on aurait fort à faire à leur apprendre l’abandon au lieu de s’évertuer à les éduquer à la domestication. »
Clio au grand air : pourquoi la vraie histoire se vit dehors
Clio déboule dans un taxi athénien. La muse de l’Histoire refuse les bibliothèques, préfère le grand air. « Pourquoi séparer le corps de l’esprit dans vos études ? Qu’avez-vous oublié en chemin ? » Elle entraîne l’auteur sur un promontoire face à Salamine et lui rappelle que le savoir véritable engage tout l’être. « Regarde ces essences, hume-les et dis-toi que les paroles savantes vous atteindraient davantage au grand air. » L’auteur retrouve alors le souvenir de ses cours donnés dehors, sous les arbres, loin des amphithéâtres. Clio condamne la spécialisation à outrance qui fragmente le savoir, refuse de voir la symphonie dont chaque note participe.
VI. Antigone, Ulysse, les jumeaux : vivre malgré les contradictions
Antigone sacrifiée : quand l’amour familial devient prison
Antigone agonise dans la nuit grecque. La fille d’Œdipe, traditionnellement présentée comme une héroïne du devoir familial, révèle sa souffrance : elle fut dévorée par les siens. « Pour ses frères, elle avait endossé l’uniforme si pesant de l’infirmière. » Toute sa vie, elle s’est sacrifiée pour eux, renonçant à ses propres désirs. « Jamais personne ne s’était inquiété de ses propres désirs, ni même de sa plus minuscule aspiration. » Elle incarne toutes ces femmes assignées au soin, dont l’amour familial devient un piège, un étouffement. « Le tu es de notre sang l’assignait définitivement à résidence. » Son dilemme reste pourtant entier : comment ne pas aimer ceux qui vous détruisent en vous aimant ?
Ulysse gamer : l’Odyssée à l’ère des écrans et des stratégies virtuelles
Ulysse joue aux jeux vidéo dans une arcade montréalaise. Le héros de l’Odyssée avoue enfin sa vérité : « Tu sais, je ne suis pas très sûr d’avoir rencontré tous ces monstres, toutes ces sorcières et tous ces géants, mon odyssée est sans doute aussi imaginaire que les combats auxquels se livrent ces gamins sur leurs consoles. » Il devient le saint patron des gamers, de tous ceux qui vivent leurs épopées par écrans interposés. Mais Laurent Devèze ne le moque pas : Ulysse incarne simplement l’humanité ordinaire, celle qui survit par la ruse et le compromis. « Ulysse marque la fin du surhumain glorieux qui court à la mort dans la certitude d’accomplir son destin. » Nous sommes tous des Ulysse, rusés et fatigués, préférant les stratagèmes aux combats frontaux.
Hypnos et Thanatos aux sports d’hiver : sommeil et mort comme soulagement
Hypnos et Thanatos surgissent dans une station de ski. Les jumeaux du sommeil et de la mort hantent les pistes, guettant la chute fatale. « Thanatos ne regardait jamais les humains que comme des proies, il attendait avec une patience à faire peur la glissade fatale dans l’escalier trop bien ciré du chalet. » Mais Devèze rappelle que pour les Grecs anciens, plongés dans la souffrance permanente, ces deux figures étaient bienfaisantes. « L’on peut bien admettre que la mémoire soit souvent un lest qui nous encombre », écrit-il. Dans un monde sans antidouleurs, le sommeil et la mort apportaient le soulagement. « Difficile pour une civilisation qui file aux urgences au moindre problème de saisir à quel point la mort et le sommeil sont une solution attendue. »
VII. Athéna, Dionysos, la plage finale : le livre comme promesse toujours recommencée
Athéna hors les murs : la sagesse refuse les bibliothèques
Athéna conduit l’auteur hors d’Athènes, jusqu’à un promontoire face à la mer. La déesse de la sagesse révèle alors son secret : elle déteste les livres et les bibliothèques. « Pourquoi séparer le corps de l’esprit dans vos études ? » Elle veut une pensée à l’air libre, sous les oliviers, dans le vent qui vient de la mer. « C’est sous ces oliviers, c’est parmi eux, mes semblables ouverts aux vents, que je suis bel et bien Athéna-la-savante. » Le savoir véritable ne se trouve pas dans les traités poussiéreux mais dans l’expérience directe du monde. « Regarde ces essences, hume-les et dis-toi que les paroles savantes vous atteindraient davantage au grand air. »
Dionysos au restaurant : l’ivresse contre la mesure, le oui-à-tout contre l’ascétisme
Dionysos clôt le bal dans un restaurant gastronomique. Le dieu du vin et de l’ivresse se révèle homme et femme tour à tour, jouant de son ambiguïté pour mieux séduire l’auteur. « Tu jouis toujours autant lorsque tu goûtes ? » demande-t-il en caressant ses seins. Les plats se succèdent, les vins coulent, l’ivresse monte. Dionysos incarne la goinfrerie vitale, le refus de toute mesure. « C’est là, Laurent, que nous en sommes rendus, au monde de “l’un ou l’autre”, jamais plus de “à la fois”, jamais plus le “oui à tout”. » Il condamne notre époque de restriction, de calcul, d’ascétisme mortifère. « Ôtez les lauriers qui déguisent un peu trop la beauté de son visage mûr », songe l’auteur face à ce dieu trop triomphant. Mais il se laisse enivrer, accepte la leçon : vivre pleinement, quitte à en mourir.
La plage des mythes réunis : quand tous les héros jouent ensemble au rugby
Le livre s’achève sur une plage languedocienne. Tous les mythes sont là, jouant au rugby sur le sable. Méduse soigne Achille blessé. Ulysse marque un essai par ruse. Œdipe court pieds nus. « C’était nous, c’étaient eux, c’était peut-être surtout moi qui tentais de survivre dans un brouhaha de joie à faire parjurer le logos. » Puis, dans un épilogue fulgurant, apparaît un jeune homme qui marche sur l’eau au coucher du soleil. « Mais c’est lorsqu’il se retourna en me souriant que je compris qu’il me faudrait sans doute encore écrire. » Les mythes grecs rencontrent d’autres récits fondateurs, d’autres figures de salut. Le livre refuse de se refermer, reste ouvert sur cette promesse : la parole mythique continue, toujours recommencée, toujours vivante.
Les Grecs, leurs mythes et nous forge une langue à la fois érudite et charnelle qui fait résonner les mythes grecs avec nos vies d’aujourd’hui. Laurent Devèze y déploie une écriture de la transe, de la possession, où chaque figure mythologique devient une force qui agit, transforme, déstabilise. Le livre rappelle que ces histoires millénaires portent encore une sagesse vivante, à condition de les écouter vraiment, de les laisser nous transformer plutôt que de vouloir les expliquer. À l’heure où tant de discours cherchent à figer les identités, à imposer des lectures univoques, cette voix singulière offre un espace de respiration, de jeu, de liberté. Elle invite chaque lecteur à devenir, comme l’écrit le philosophe, « son propre incunable », à laisser les mythes inscrire en lui leur parole éternelle et toujours neuve.