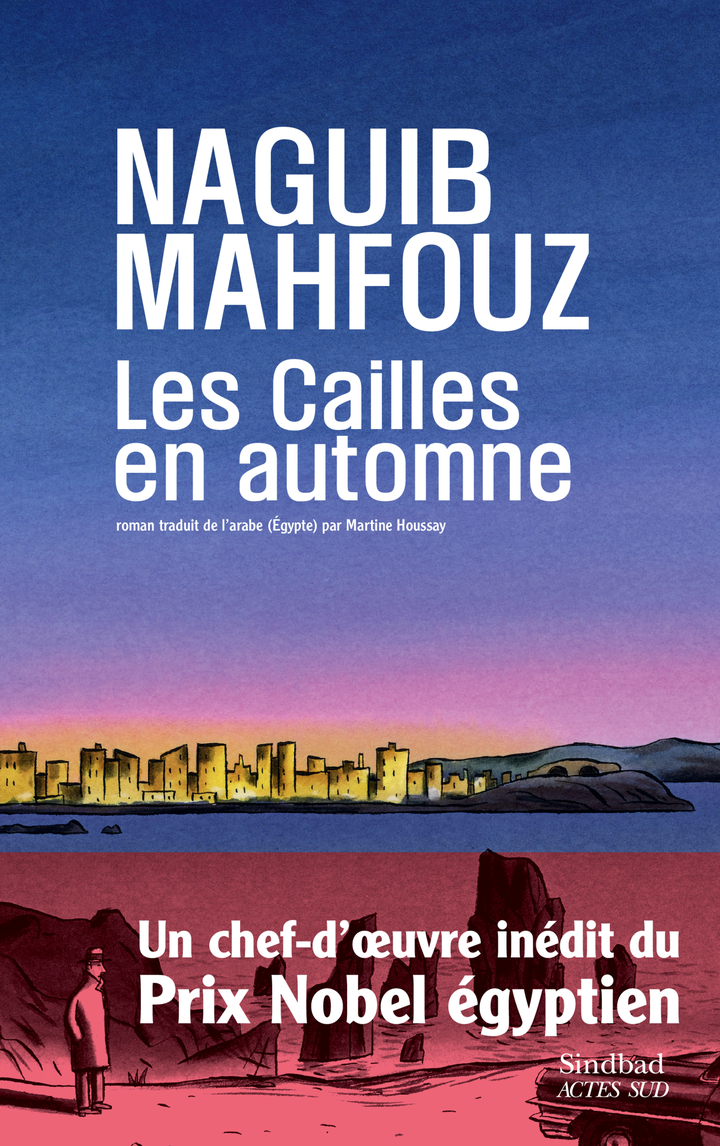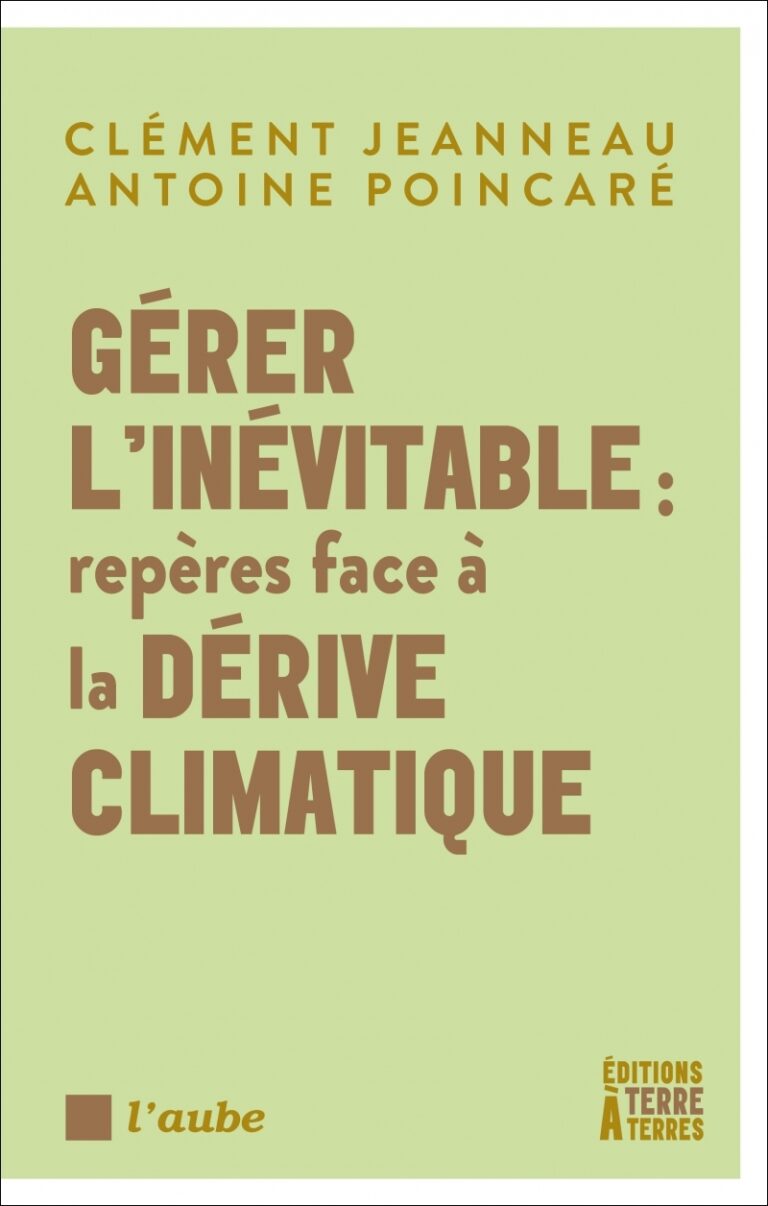Nicolas Élias, Portrait du poète en salaud, Les Argonautes, 07/02/2024, 206 pages, 20,50€
Dans l’arène souvent convenue de la biographie littéraire, où l’hagiographie le dispute à la démolition méthodique, le roman de Nicolas Élias, Portrait du poète en salaud, paru aux éditions Les Argonautes, jette un pavé singulier. Il ne s’agit pas tant de raconter Nâzım Hikmet, ce géant de la poésie turque, figure emblématique et tragique du communisme international, que de disséquer l’acte même de vouloir cerner une existence hors norme, surtout celle d’un créateur écartelé entre le mythe qu’il incarne et les trivialités de sa condition humaine. Nicolas Élias nous convie à une autopsie littéraire, non pas du cadavre refroidi d’une légende, mais du processus vivant, ambivalent et douloureux de sa propre construction.
Les prémices d’un corps-à-corps
L’entrée en matière est saisissante. Moscou, janvier 1963. Une neige omniprésente, presque métaphysique, enveloppe la ville et le projet naissant. Le narrateur, double à peine masqué de l’auteur, prend ses quartiers dans un hôtel soviétique dont le confort spartiate – le chauffage, l’eau chaude – tranche avec l’ampleur démesurée de l’entreprise qui l’attend. Sur la table, une Remington de seconde main, dont les touches « e » et « M. » fatiguées préfigurent peut-être la fragilité même de la mémoire et des mots face à la stature du Maître. Le biographe s’apprête à rencontrer Nâzım Hikmet, le poète en exil, l’icône. L’air s’alourdit d’une tension indicible, fruit non de l’adoration mais d’une conscience perçante qui s’approche du soupçon.
Le dilemme originel est posé d’emblée, à travers l’hésitation du narrateur sur le titre à donner à son travail. D’un côté, la sobriété attendue, académique presque : Vie de Nâzım Hikmet Ran, propre à satisfaire les conventions éditoriales. De l’autre, cette formule souterraine, provocatrice, quasi blasphématoire qui le taraude : Portrait du poète en salaud. Toute l’ambiguïté de l’entreprise réside dans cette oscillation : comment rendre compte de la grandeur de l’œuvre, du symbole de résistance, sans occulter les failles de l’homme, ses petitesses, ses reniements, sa part d’ombre – sa part de « salaud » ? Se réclamant implicitement d’une lignée critique qui refuse l’idolâtrie, celle qui, à l’instar d’un Octave Mirbeau face à Balzac, sait que c’est « par ses péchés qu’un grand homme nous passionne le plus », le narrateur affiche son intention : éviter l’écueil de « l’admiration qui tétanise, embrouille l’esprit ». Il ne s’agira pas de redorer la statue, mais de la scruter sous tous les angles, quitte à y découvrir les fissures, les traces d’usure, voire les actes de vandalisme commis par l’homme lui-même. Cette quête s’éloigne du fracas du scandale pour s’enfoncer dans le labyrinthe d’une vérité humaine aux ramifications infinies, un élan pour soustraire le poète à ce temple d’épithètes laudatives où l’on ensevelit si avidement les figures consacrées.
Un kaléidoscope d’idéaux effondrés
Le roman déroule alors le fil biographique, mais à la manière d’un récit fragmenté, éclaté, constamment médiatisé par le regard subjectif du narrateur et par la mémoire sélective, parfois défaillante, du poète lui-même lors de leurs entretiens moscovites. Au lieu d’une progression linéaire et exhaustive – qui, soulignons-le, serait un défaut dans une entreprise qui se veut littéraire et critique –, Nicolas Élias choisit des moments clés, des épisodes significatifs qui cristallisent les tensions et les paradoxes de cette vie hors du commun.
L’enfance et la jeunesse stambouliote (1902-1921) révèlent un terreau d’influences hétéroclites : l’héritage ottoman finissant, la fascination pour la culture française via sa mère Celile, la spiritualité soufie transmise par un grand-père lui-même figure de l’entre-deux (ce Moustapha Djelaleddin Pacha, Polonais converti devenu général ottoman), l’appel du large via Jules Verne, et déjà l’ombre portée du nationalisme turc naissant, mais aussi celle, plus intime, de Baudelaire. Cette complexité initiale annonce la suite : un homme pétri de contradictions, capable des plus grands élans comme des replis les plus déconcertants.
Le ralliement à la cause kémaliste en Anatolie (1921) et l’aventure soviétique qui s’ensuit sont traités avec une ironie distanciée. L’enthousiasme révolutionnaire se heurte vite à la réalité prosaïque : l’enseignement à Bolu, la découverte d’un “peuple” idéalisé mais lointain, puis l’immersion à Moscou à l’Université communiste des travailleurs de l’Est (KUTV). Là, c’est la rencontre décisive avec le futurisme russe, l’ombre écrasante de Maïakovski – poète dont Nâzım, selon le narrateur, cherchera toute sa vie à se démarquer tout en subissant son influence. L’expérience moscovite est celle d’une adhésion fervente à la modernité poétique et politique (“Devenir machine”), mais aussi celle des contraintes idéologiques, de la discipline de parti, prémices d’une relation complexe avec le communisme soviétique. C’est également l’occasion pour le roman d’aborder de front les enjeux linguistiques : la révolution du vers libre turc que Nâzım s’attribue, en écho à la réforme de l’alphabet et à la politique d’épuration linguistique menée par Atatürk, politique complexe que certains chroniqueurs, par facilité, réduisent parfois à une “simple” modernisation.
Le retour à Istanbul (1928-1938) est marqué par une intense activité polémique. Nâzım, devenu une figure littéraire en vue, s’acharne contre les « idoles » de la vieille garde dans Le Mois illustré, jouant un rôle d’accélérateur de la modernité. Mais c’est aussi une période de surveillance accrue, de procès, et de fractures personnelles. La violente rupture poétique avec son ami Vâ-Nû, accusé sans ménagement de compromission, jette une lumière crue sur la capacité de Hikmet à la brutalité, même envers ses proches, quand son image ou son engagement lui semblent menacés. Le “salaud” n’est pas qu’une hypothèse, il affleure dans les actes et les écrits.
Les douze années d’incarcération (1938-1950), ce gouffre au cœur de sa vie d’adulte, sont évoquées comme une épreuve initiatique paradoxale. Le récit souligne la force de caractère, l’organisation quasi monacale de la survie, la continuation acharnée du travail littéraire, notamment les Paysages humains de mon pays. Mais il suggère aussi une transformation intérieure : face à la solitude et à la proximité de la mort, le poète, épuisé par l’optimisme volontariste, semble redécouvrir la profondeur méditative des mystiques persans de son enfance. Sa libération, fruit d’une grève de la faim devenue affaire internationale autant que des luttes de pouvoir internes en Turquie, apparaît presque comme une sortie de scène ironique, le sauvant peut-être d’une introspection plus poussée.
L’exil définitif (1951-1963), enfin, est dépeint comme une gloire ambiguë. Célébré comme un héros dans le bloc soviétique, Hikmet est en réalité prisonnier d’une nouvelle cage, dorée cette fois. Le narrateur le montre suffocant sous les honneurs officiels, lucide quant à la mascarade stalinienne puis post-stalinienne, mais incapable de rompre. Moscou est devenu sa seule patrie possible, mais une patrie où il étouffe. Ses relations tumultueuses avec les femmes durant cette période – l’ombre persistante de Münevver Andaç, la présence stable et médicale de Galina Kolesnikova, l’embrasement tardif pour la jeune Véra Touliakova – sont moins des épisodes amoureux que les symptômes d’une quête éperdue de sens et d’ancrage dans un monde qui lui échappe. L’épisode tragi-comique des retrouvailles avortées avec Münevver et son fils à Varsovie illustre jusqu’à l’absurde ce décalage entre la grandeur affichée et les misères intimes.
La fatigue d’un siècle qui croyait à la beauté salvatrice des mots
Au-delà de la figure de Nâzım Hikmet, Portrait du poète en salaud fonctionne comme un miroir tendu à notre propre rapport aux artistes et aux intellectuels. À travers le regard tour à tour fasciné, irrité, critique et finalement empreint d’une étrange compassion du narrateur, le roman interroge : qu’attendons-nous de ceux que nous admirons ? Une cohérence impossible entre l’œuvre et la vie ? Une exemplarité morale ? La confirmation de nos propres idéaux ? Nicolas Élias, en refusant de trancher, nous renvoie à nos propres contradictions. Il nous met face à la difficulté d’accepter que le génie puisse frayer avec la médiocrité, l’engagement avec l’aveuglement, la générosité proclamée avec l’égoïsme profond.
L’œuvre dialogue implicitement avec les débats actuels sur la légitimité de juger les artistes à l’aune de leur comportement privé, sur la possibilité ou l’impossibilité de dissocier l’homme de l’œuvre. Sans jamais sombrer dans l’anachronisme ou le didactisme – ce qui serait manquer d’élégance –, le roman suggère que ces questions ne sont pas nouvelles, qu’elles hantent depuis longtemps notre rapport à la création et à ceux qui la portent. La figure de Hikmet, écartelée entre l’Est et l’Ouest, entre l’engagement communiste et l’individualisme forcené, entre la fidélité à ses origines turques et le cosmopolitisme de l’exil, devient ainsi emblématique des dilemmes de l’intellectuel engagé au XXe siècle.
La formule finale que le narrateur trouve pour qualifier Hikmet, “oublieux et nostalgique“, est particulièrement éclairante. Elle dépasse le jugement moral binaire (“salaud” ou “héros”) pour toucher à une vérité psychologique plus profonde, plus universelle peut-être. Oublieux des souffrances infligées, des promesses non tenues, du réel immédiat ; nostalgique d’une patrie perdue, d’un idéal trahi, d’une plénitude à jamais inaccessible. C’est dans cette tension irrésolue que résiderait l’essence de cet homme et, par extension, la condition humaine elle-même, souvent tissée d’oublis nécessaires et de nostalgies incurables.
Le refus final de l’éditeur – ou l’autocensure du narrateur – quant au titre initial Portrait du poète en salaud laisse la question ouverte. Faut-il nommer la faille, au risque de réduire l’homme à sa caricature, ou faut-il, par respect pour l’œuvre ou par lassitude devant la complexité, laisser planer une forme d’ambiguïté ? Le roman de Nicolas Élias, lui, a choisi sa voie : celle d’une exploration exigeante, parfois dérangeante, toujours intelligente, de la vérité plurielle d’un homme et d’une époque. C’est une invitation à lire Hikmet autrement, mais aussi à réfléchir à la manière dont nous construisons – et déconstruisons – nos propres héros littéraires et politiques. Une œuvre qui parvient à toucher juste, avec une lucidité douloureuse mais salutaire.