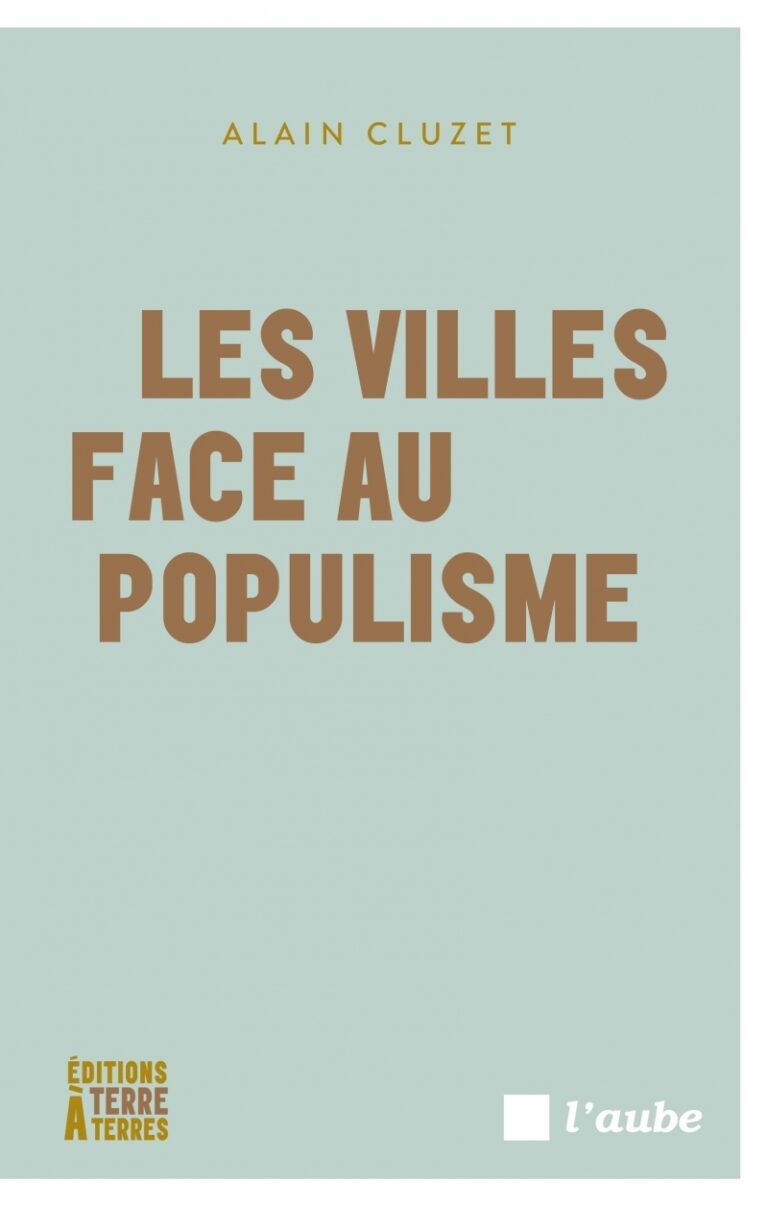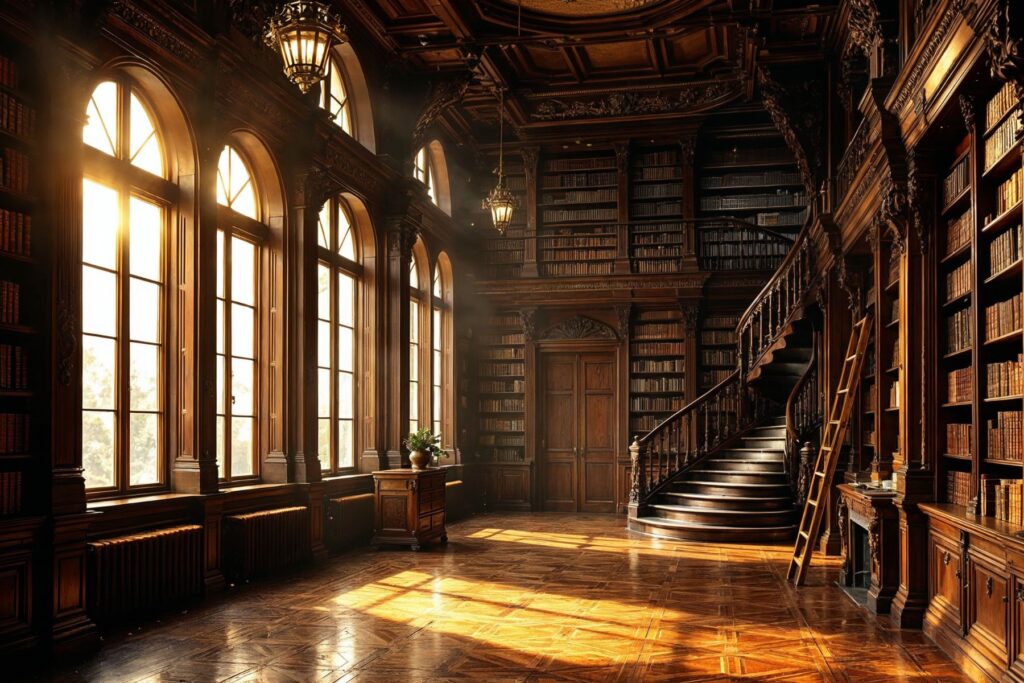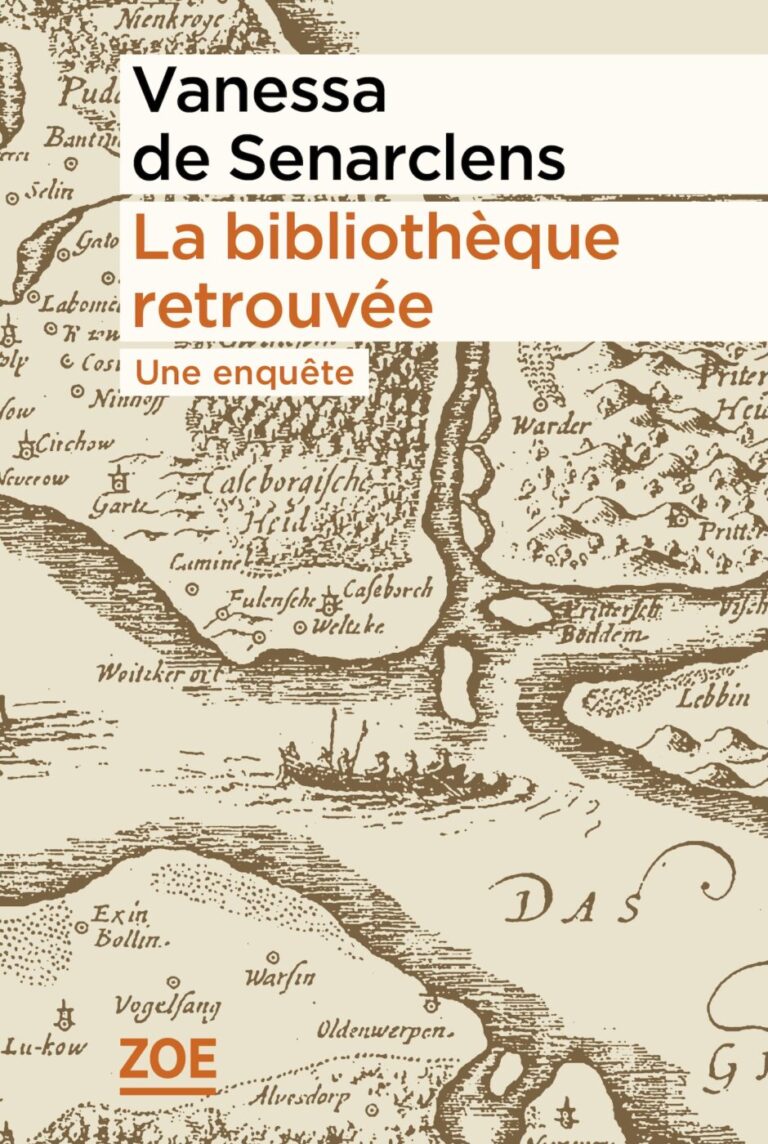Angela Bubba, Elsa, traduction française par Florence Courriol-Seita, Éditions Héloïse d’Ormesson, 27/03/25, 416 pages, 23 €
Oubliez la biographie figée. Dans Elsa, Angela Bubba s’immerge dans l’âme incandescente d’Elsa Morante, moins pour documenter que pour réinventer une existence. C’est une plongée vertigineuse dans la forge intime où la douleur, les rêves et la nécessité féroce de l’écriture sculptent le destin d’une icône insoumise.
« Vivre, alors ? Ou écrire ? Ne me demandez pas de choisir. » Cette aporie, posée d’emblée par la voix que prête Angela Bubba à Elsa Morante dans son roman Elsa, n’est pas tant un dilemme qu’une condition d’existence, la faille originelle où s’engouffre une vie vouée à l’alchimie des mots. Angela Bubba, avec une audace respectueuse, ne prétend pas livrer une biographie exhaustive de l’immense figure littéraire italienne. Elle choisit plutôt la voie sinueuse de la réinvention poétique, de la mosaïque sensible, où les éclats de mémoire, les blessures fondatrices et les échappées oniriques composent le portrait fragmenté, non seulement d’une écrivaine majeure du XXe siècle, mais d’une âme aux prises avec les démons intimes et les spectres d’une Histoire convulsive. Ce faisant, elle nous offre une méditation subtile sur la genèse de l’écriture comme refuge et comme fatalité, sur la pesanteur des origines et la quête éperdue d’une identité propre.
L’aube d’une conscience à Testaccio
Le récit s’ouvre sur les pavés romains du quartier de Testaccio, dans l’entre-deux-guerres. Elsa est une enfant, mais déjà lestée d’une gravité, d’une lucidité qui détonne. Angela Bubba esquisse avec délicatesse cette atmosphère de précarité flottante, moins matérielle que psychique, au sein d’une cellule familiale où les silences pèsent plus lourd que les mots. La mère, Irma, institutrice pétrie de contradictions, et le père légal, Augusto Morante, homme effacé et tourmenté, composent un premier cercle d’ombres chinoises, dont Elsa perçoit instinctivement les failles et les secrets tus. C’est dans ce terreau d’ambivalences que germe une solitude fondamentale, une conscience aiguë de sa propre étrangeté.
L’identité d’Elsa est d’emblée marquée par le sceau du symbolique et de la prédestination ambiguë. Son prénom, apprend-elle, désigne la garde de l’épée, cette pièce défensive mais aussi potentiellement offensive, qui arrête la lame. « Je suis une épée ? » interroge-t-elle, déjà consciente de porter en elle une dualité, une force tranchante et une vulnérabilité à protéger. La singularité lui est assignée comme une essence : « Il n’y a pas deux épées qui se ressemblent. N’oublie jamais ça ». Cette unicité revendiquée deviendra le fil conducteur de sa quête existentielle et littéraire. Le scorpion blanc, autre emblème précoce, capturé puis contemplé avec une fascination mêlée de respect « Un scorpion n’a peur de rien »), agit comme un miroir de cette âme résiliente, refusant d’être écrasée, déjà armée pour affronter la marginalité et l’abandon – notamment celui de l’école, délaissée au profit de l’errance, de l’observation directe du théâtre de la rue, première matière de son œuvre à venir. La poésie, ou du moins une sensibilité exacerbée au pouvoir évocateur des mots, s’infiltre très tôt, esquissant les contours de ce qui deviendra sa seule patrie véritable, le seul lieu où la tragédie de l’écriture lui semblera « bien plus heureuse » que l’« intolérable » de la vie brute.
Apprentissages et création
Le roman d’Angela Bubba n’est pas linéaire ; il épouse plutôt les ressacs de la mémoire, explorant comment les expériences formatrices gravent leurs sillons dans la chair et dans l’esprit d’Elsa, nourrissant son œuvre future. La révélation de ses origines troubles – non pas fille d’Augusto, mais d’un accord secret entre Irma et un Sicilien nommé Francesco – est un séisme intime. Au-delà d’un secret de famille, c’est la confirmation d’une illégitimité ressentie, d’une place incertaine dans l’ordre du monde. Cette bâtardise symbolique (elle portera pourtant le nom de Morante) ancre en elle ce sentiment d’être « enfant de personne », ou plutôt l’enfant d’elle-même, contrainte de forger sa propre lignée à travers les mots.
Cet arrachement initial semble inaugurer un long apprentissage marqué par l’épreuve de la perte et de la douleur consentie ou subie. Quitter le foyer pour une mansarde près de Navona est un acte d’émancipation choisi, mais qui la confronte à la précarité, à la solitude radicale. Puis vient l’avortement, épisode central narré avec une retenue remarquable dans la confession au vieux cordonnier M. Franz. Ce n’est pas seulement la perte d’un enfant – qu’elle nommera plus tard Arturo, figure spectrale et aimée –, c’est aussi l’expérience d’une maternité impossible, d’une blessure infligée au corps et à l’âme qui la hantera à jamais. « J’ai péché », murmure-t-elle, moins par repentance religieuse que par conscience d’une transgression existentielle profonde. La cicatrice, comme le suggère Franz, ne disparaît pas mais devient part intégrante de son être, informant sa vision tragique du monde. Les années de guerre, la fuite avec Alberto Moravia, leur refuge précaire à Fondi puis à Sant’Agata, ajoutent une strate historique à cette expérience de la dépossession et de la vulnérabilité, où la survie physique et la préservation de l’intégrité morale deviennent un combat quotidien.
Comment survivre à tant de “malheur” ? Par l’imaginaire, qui constitue pour Elsa, plus qu’un refuge, une véritable contre-offensive. Les créations de son enfance – la poupée Bellissima, le condottiere Tit – témoignent déjà de cette faculté à peupler le vide, à opposer la fiction à la désolation. Son amour pour les chats, et plus tard pour le jeune peintre américain Bill Berger, relève de cette même quête d’une altérité élective, d’une beauté fragile et indomptée capable de défier la laideur du monde. Mais c’est l’écriture qui devient l’arme principale, l’atelier où se forge sa résistance. Angela Bubba nous montre Elsa au travail, accumulant les cahiers, raturant, réécrivant sans cesse (Mensonge et Sortilège lui prendra dix ans). L’acte d’écrire est ici dépeint comme une lutte corps à corps avec la langue, une discipline quasi monastique, une “embuscade” où l’on traque sa propre vérité. Sa relation complexe avec Alberto Moravia, écrivain à la reconnaissance plus aisée, met en lumière leurs approches divergentes : la sienne, tourmentée, viscérale ; la sienne, plus cérébrale, peut-être plus protégée. Leurs dialogues sur la littérature (Dostoïevski comme une révélation partagée, Rimbaud comme une idole personnelle) révèlent autant leurs affinités que leurs irréductibles différences. Elsa se mesure à lui, mais surtout à elle-même, dans un dialogue intérieur incessant sur le sens et la finalité de son art. La publication de son premier roman pour enfants, Les Très Belles Aventures de Caterina à la petite tresse, dans le Corriere dei Piccoli en 1942, marque une étape, mais la satisfaction est vite tempérée par la lucidité critique sur les limites de son propre travail.
Résonances d’une insoumise
En choisissant de réinventer Elsa Morante plutôt que de la figer dans une biographie classique, Angela Bubba donne à son personnage une dimension archétypale. L’Elsa du roman, avec ses doutes, ses révoltes, ses fulgurances et ses abîmes, transcende le cadre historique pour incarner la figure de l’artiste face à sa création, de l’individu en quête de sens dans un monde fracturé. Ses questionnements sur l’identité, l’amour, la perte, la solitude, le rapport au corps et à la mémoire, sa manière de négocier entre le besoin d’absolu et l’acceptation de l’imperfection, font écho aux dilemmes de toute conscience qui refuse les simplifications et les assignations. Sa trajectoire est celle d’une adolescence qui se prolonge, non par immaturité, mais par fidélité à une exigence première, celle de ne jamais trahir ni sa vision ni sa voix.
Le roman est aussi une cartographie sensible de l’Italie du siècle passé. La Rome populaire de Testaccio, puis celle, plus ambiguë, de l’après-guerre avec ses intellectuels et ses artistes (on croise Pasolini, Natalia Ginzburg, Luchino Visconti…), forment la toile de fond d’une société en pleine transformation, marquée par les inégalités sociales, le poids de la tradition et les traumatismes encore vifs du fascisme et de la guerre. La romancière suggère, sans didactisme, comment le contexte historique informe les subjectivités, comment la grande Histoire s’inscrit dans les replis de l’intime. La condition féminine est également explorée à travers le parcours d’Elsa : son refus des rôles traditionnels, sa lutte pour s’imposer comme écrivaine dans un milieu largement masculin, son rapport complexe à la maternité (réelle ou symbolique) en font une figure d’insoumise, précurseure à bien des égards. Son dialogue constant, souvent conflictuel, avec les figures masculines (Augusto, Francesco, M. Franz, Alberto, Pier Paolo, Bill…) révèle les tensions et les impasses, mais aussi les complicités possibles, dans les rapports entre les sexes à cette époque.
Au terme de ce voyage dans l’intimité recréée d’Elsa Morante, ce qui demeure est l’empreinte indélébile de sa relation passionnée, presque sacrificielle, aux mots. Angela Bubba réussit à nous faire ressentir ce que signifie dédier une vie à l’écriture : non pas une carrière, mais une ascèse, une forme de martyre choisi, où chaque livre est une bataille gagnée sur le silence et l’oubli, mais aussi une nouvelle blessure ouverte. L’écriture comme « tragédie bien plus heureuse » que la vie, certes, mais une tragédie tout de même, qui exige un don total et laisse exsangue. Le roman d’Angela Bubba, par sa langue précise et poétique, par sa construction en fragments lumineux et sombres, rend hommage à cette exigence sans concession. Il ne cherche pas à résoudre les mystères d’Elsa Morante, mais à en restituer la vibration unique, la beauté convulsive. C’est le portrait kaléidoscopique d’une conscience en état d’alerte permanent, une invitation à relire Morante, mais aussi à interroger notre propre rapport à la création, à la mémoire et à la quête irrépressible de vérité dans un monde qui semble si souvent la dénier.