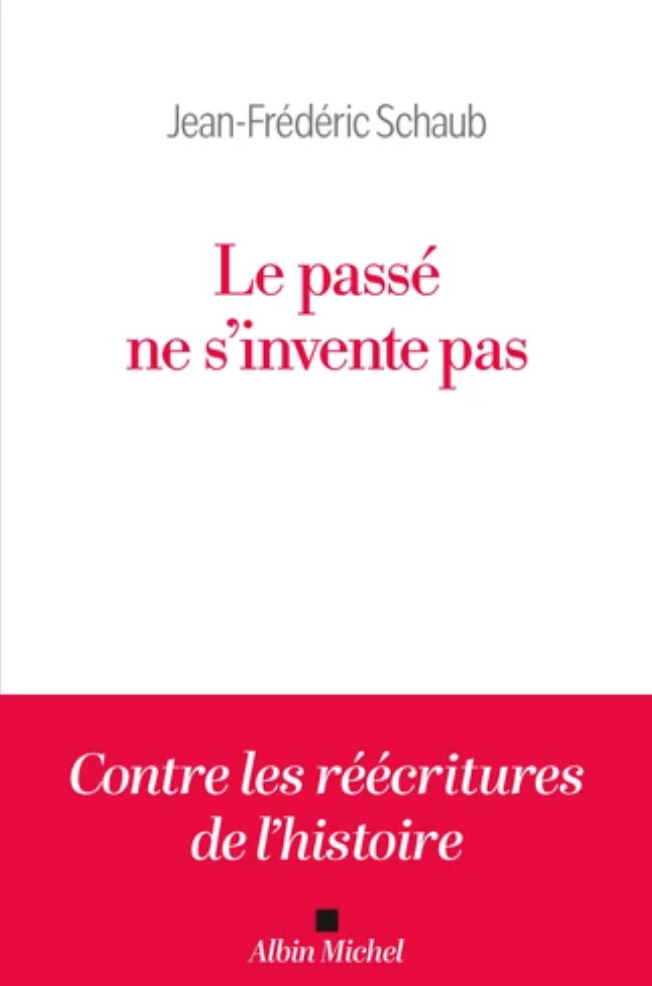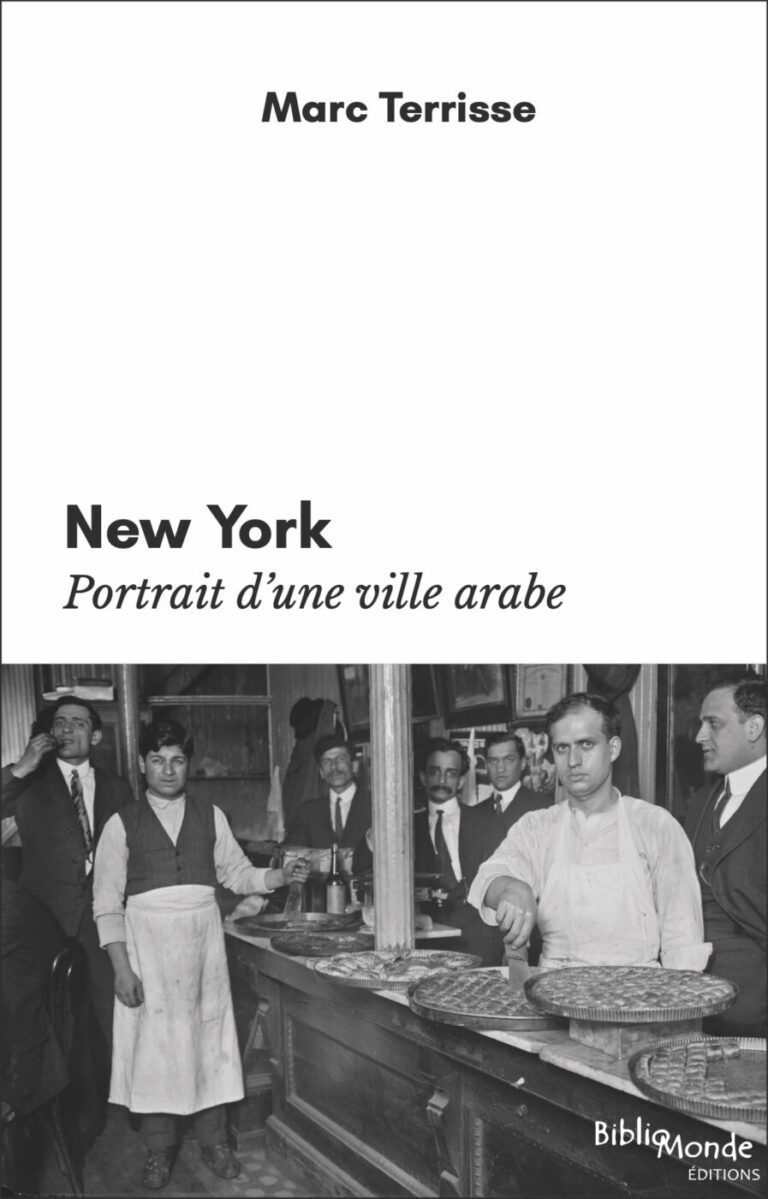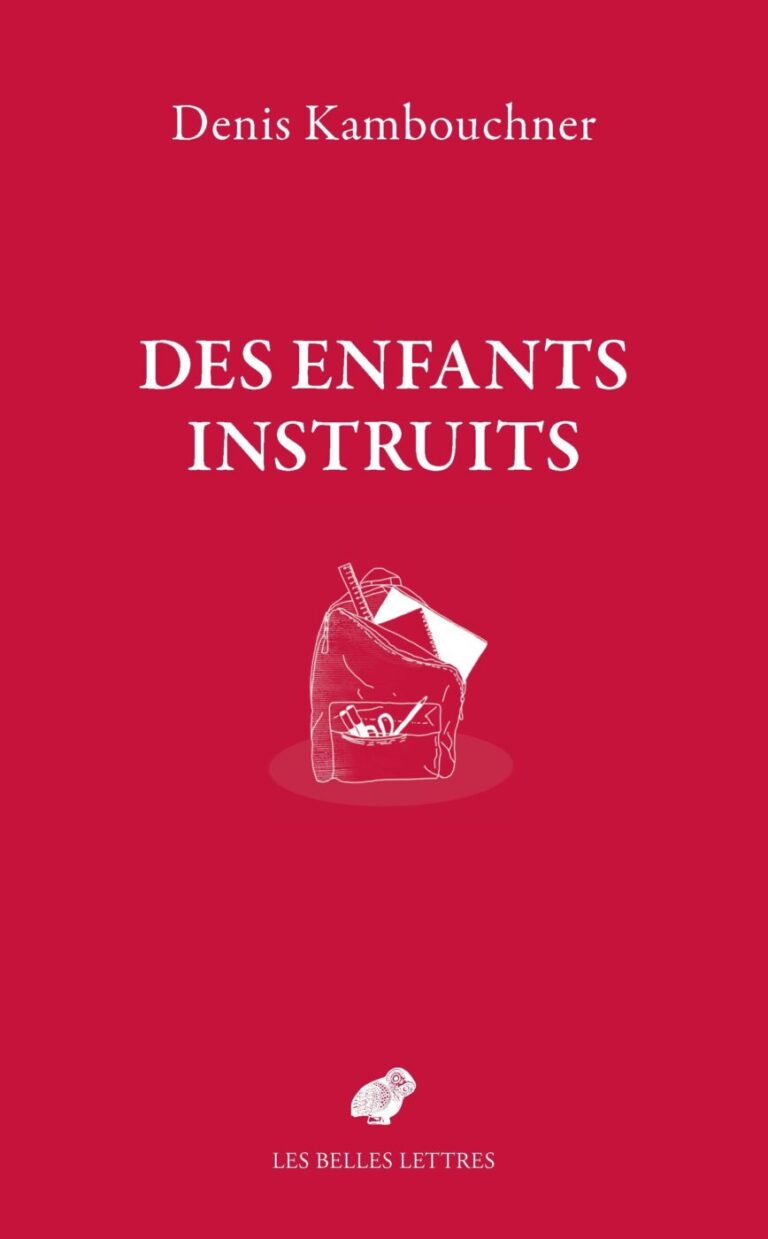Max Lobe, La Danse des pères, Éditions Zoé, 07/02/2025, 176 pages, 17€
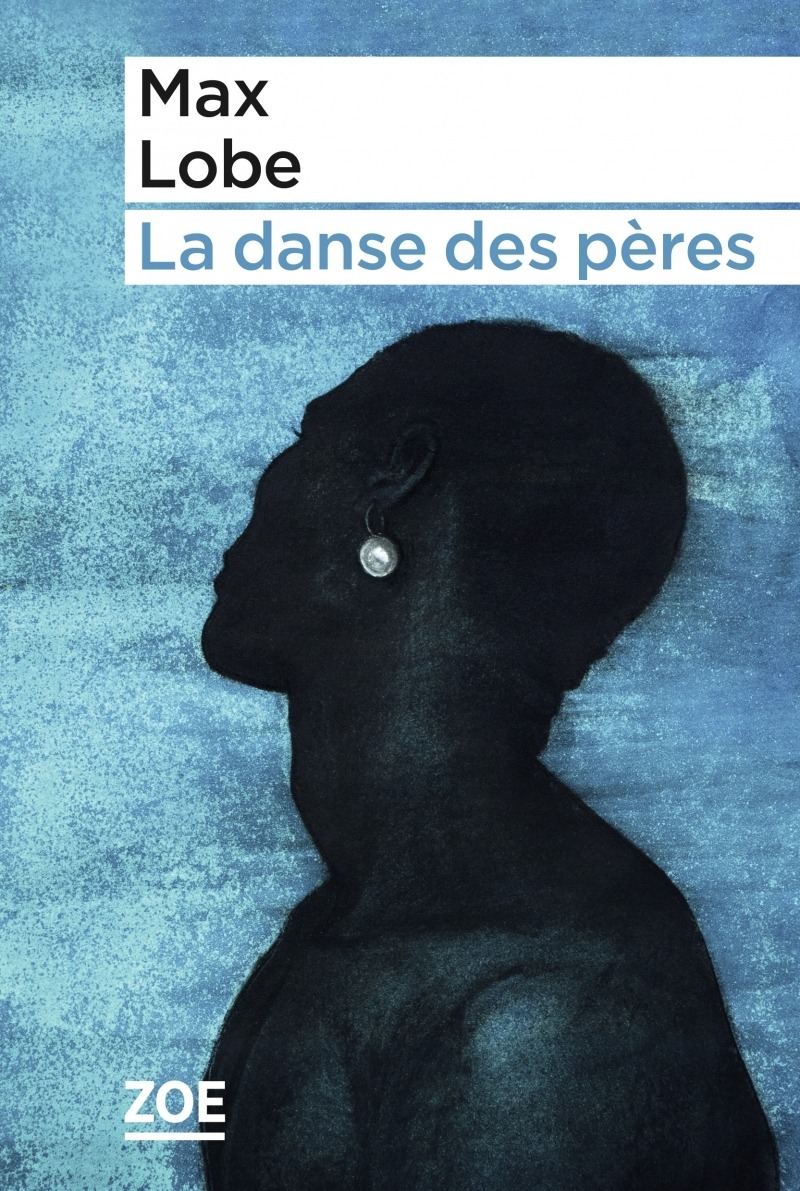
Max Lobe, voix singulière des littératures francophones, tisse dans La Danse des pères une trame narrative où la quête identitaire de son protagoniste, Benjamin Müller, s’entrelace intimement avec les fantômes du passé familial et l’ombre complexe d’un héritage paternel. Loin de se limiter à une simple chronique personnelle, ce roman déploie une méditation profonde sur la transmission, la mémoire et la possibilité, ou l’impossibilité, d’une réconciliation avec les figures tutélaires qui nous façonnent. À travers une prose vibrante, infusée des rythmes du Cameroun et des silences de l’exil genevois, Max Lobe nous invite à une danse où chaque pas est une négociation entre fidélité et émancipation, entre l’amour filial et la blessure du rejet. Le roman interroge avec une acuité parfois douloureuse ce que signifie “être fils“, particulièrement lorsque les attentes paternelles se heurtent à la singularité d’un être en devenir. C’est une exploration des masculinités, des identités diasporiques et des mémoires intergénérationnelles, où la danse, plus qu’une simple métaphore, devient un langage corporel pour dire l’indicible et peut-être, tenter de se réparer.
Saga familiale et mémoire fracturée
L’incipit nous plonge dans l’intimité de Benjamin, depuis sa cuisine genevoise, “fenêtre sur le souvenir“, d’où s’échappent les réminiscences d’une enfance camerounaise. Le lecteur est immédiatement saisi par la figure charismatique et ambivalente de Kundè Di Gwet Njé, le père, “le Lion guerrier“, dont les récits, imprégnés de Castel Beer et d’une verve imagée, constituent la première strate d’une mémoire en construction. Ce père est un conteur né, transmettant une saga familiale et nationale où se mêlent la fierté d’une lutte pour l’indépendance – symbolisée par le grand-père Wolfgang, “guetteur de l’indépendance” – et une vision du monde où la “chose blanche” reste une référence omniprésente, bien que souvent critique. Le quotidien à Beedi, rythmé par les traditions culinaires de grand-mère Frida, les éclats de rire, mais aussi par une discipline paternelle parfois sévère, façonne l’univers de l’enfant. Très tôt, cependant, une dissonance se fait jour : l’inclinaison naturelle de Benjamin pour la danse, son aspiration à une forme de grâce corporelle, se heurte aux attentes implicites de virilité. Le père, lui-même danseur exubérant de funky-makossa, capable de transporter son auditoire avec des pas endiablés, ne reconnaît pas dans l’expression de son fils un écho de sa propre masculinité. La phrase couperet tombe, violente et stigmatisante, lors d’une dispute où Benjamin prend parti pour sa mère : “C’est ta faute si cet enfant-là est comme ça comme une femme, eh, regardez, regardez-moi comme il marche !” Cette parole fondatrice installe une faille, un sentiment de ne pas correspondre, qui sera le moteur souterrain de la quête de Benjamin. C’est le début d’un long apprentissage du rejet et de la nécessité de se définir en dehors du regard paternel. L’exil vers la Suisse, chez Auntie Bwamè, figure diasporique pragmatique et pieuse, marque une nouvelle étape, où la distance physique avec le Cameroun coïncide avec une tentative de reconstruction. Mais le passé n’est jamais loin, et la rupture la plus douloureuse interviendra lorsque des courriels, témoignant de son orientation sexuelle, seront découverts et transmis à son père. La condamnation de Kundè est sans appel, signant un exil affectif et symbolique : “Ne remets plus jamais les pieds ici. Compris ? Jamais.” Cette injonction structure la suite du récit, contraignant Benjamin à un travail de deuil et de réinvention de soi loin de la terre natale.
La danse comme langue de soi
La danse devient alors le lieu privilégié de cette réinvention. Si elle fut source de conflit avec le père, elle se transforme en un espace de souveraineté personnelle, un langage à travers lequel Benjamin explore son identité, ses désirs, et tente de métaboliser les traumatismes. De l’initiation ludique avec sa sœur Dorcas, où se dessinent déjà les prémices d’une sensibilité artistique, aux cours rigoureux avec Miss Okonko à Genève, inspirée par le parcours d’Arthur Mitchell et son “Theatre Dance of Harlem” – figure emblématique d’un artiste noir ayant conquis un espace traditionnellement blanc –, chaque mouvement est une affirmation. La danse est ici bien plus qu’une discipline ; elle est un acte de résistance, une manière de réclamer son corps et son histoire. L’écriture de Max Lobe elle-même semble suivre une partition syncopée, mêlant la truculence du pidgin camerounais, les incursions en langue bassa, et la retenue d’une introspection menée en français. Cette polyphonie linguistique et stylistique reflète la complexité d’une identité “entre-deux“, façonnée par des cultures et des temporalités multiples. Les récits enchâssés, où les souvenirs du père, les légendes familiales et les chroniques de l’exil se superposent, créent un effet de palimpseste, illustrant la manière dont le passé ne cesse de s’inscrire et de se réinscrire dans le présent. L’oralité, marquée par les exclamations de Kundè (“Aaah les enfants !“), confère au texte une chaleur et une immédiateté, comme si le lecteur était convié à une veillée où les histoires se transmettent de bouche à oreille. Mais ces moments de partage sont aussi traversés de silences, de non-dits, qui soulignent les failles de la communication et les blessures encore à vif. C’est une mémoire fragmentée que Benjamin s’efforce de rassembler, une histoire trouée qu’il tente de recoudre.
Danser avec les pères : entre legs et légèreté
L’irruption de Pâ Mapoubi, ce voisin genevois qui se révèle être “Pierre-Joseph Gwet Njé Mapoubi Junior“, cousin de Kundè et porteur d’une part occultée de l’héritage familial, vient bousculer l’édifice mémoriel de Benjamin. Mapoubi n’est pas un simple messager providentiel ; sa personnalité est complexe, teintée d’humour, de sagesse populaire, mais aussi de ses propres doutes et des ambiguïtés liées à son propre parcours d’exil et d’adaptation. “Ah mon fils, que veux-tu que je dise ? J’ignorais tout et tout sur toi jusqu’au jour, à la fenêtre…” Sa rencontre avec Benjamin est moins une résolution magique qu’une nouvelle strate de complexité, offrant une perspective latérale sur la figure paternelle. Le message qu’il transmet, celui de l’arbre-Ancêtre, par la voix de la grand-mère Frida en rêve – “Dis-lui que son père l’aime.” – est une parole puissante, qui ouvre une brèche vers une possible, mais toujours incertaine, réconciliation. Ce n’est pas tant un pardon explicite de Kundè qu’un amour ancestral qui refait surface, contournant les conflits terrestres. La figure de l’oiseau de feu, qui apparaît à plusieurs reprises, semble incarner cette transmission fragile, cette étincelle de mémoire et d’espoir qui persiste malgré les ténèbres. Le roman, en fin de compte, ne propose pas de clôture facile. La “danse des pères” est une extraodinaire chorégraphie sans fin, une quête pour habiter un héritage complexe sans s’y laisser enfermer, pour trouver sa propre mélodie au sein d’une polyphonie familiale et historique souvent dissonante. L’émancipation de Benjamin, si elle s’opère, passe par cette acceptation de la tension, par cette capacité à danser avec ses fantômes, à transformer la douleur en une forme de grâce, même si celle-ci demeure toujours précaire, toujours à réinventer.
C’est un roman d’une beauté fulgurante qui transforme la douleur en danse, où chaque pas devient une négociation avec l’héritage paternel, chaque pirouette une tentative de pardon, et où Max Lobe révèle son génie dans cette capacité à faire danser ensemble la tragédie et la grâce.