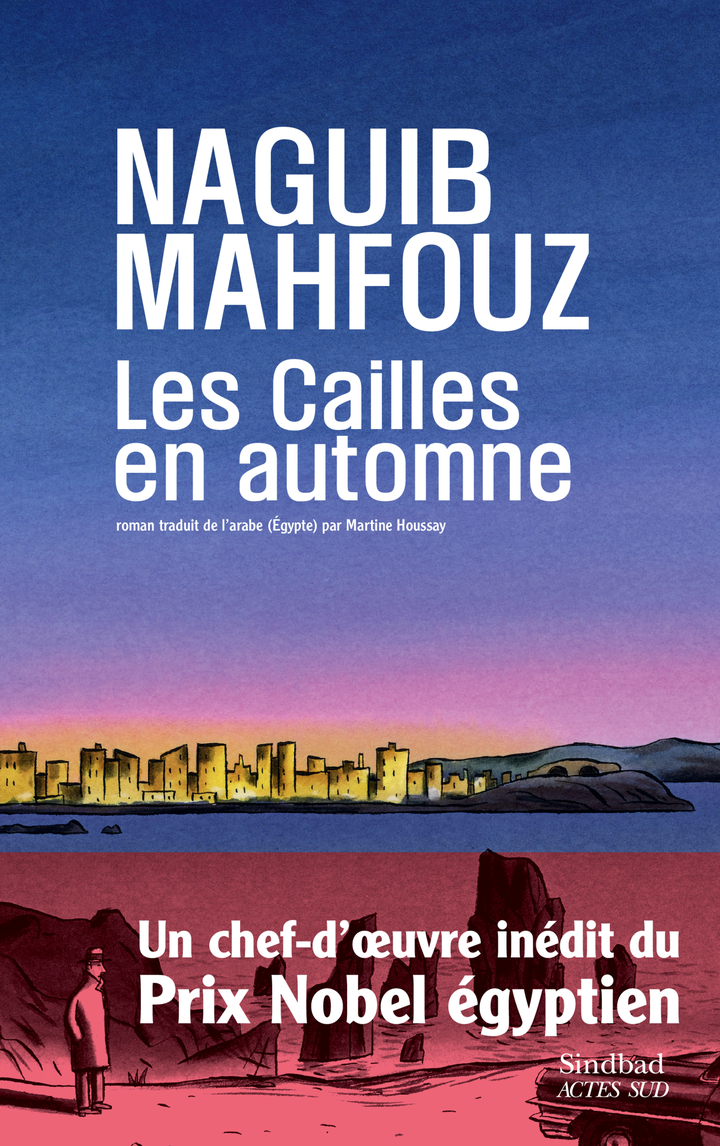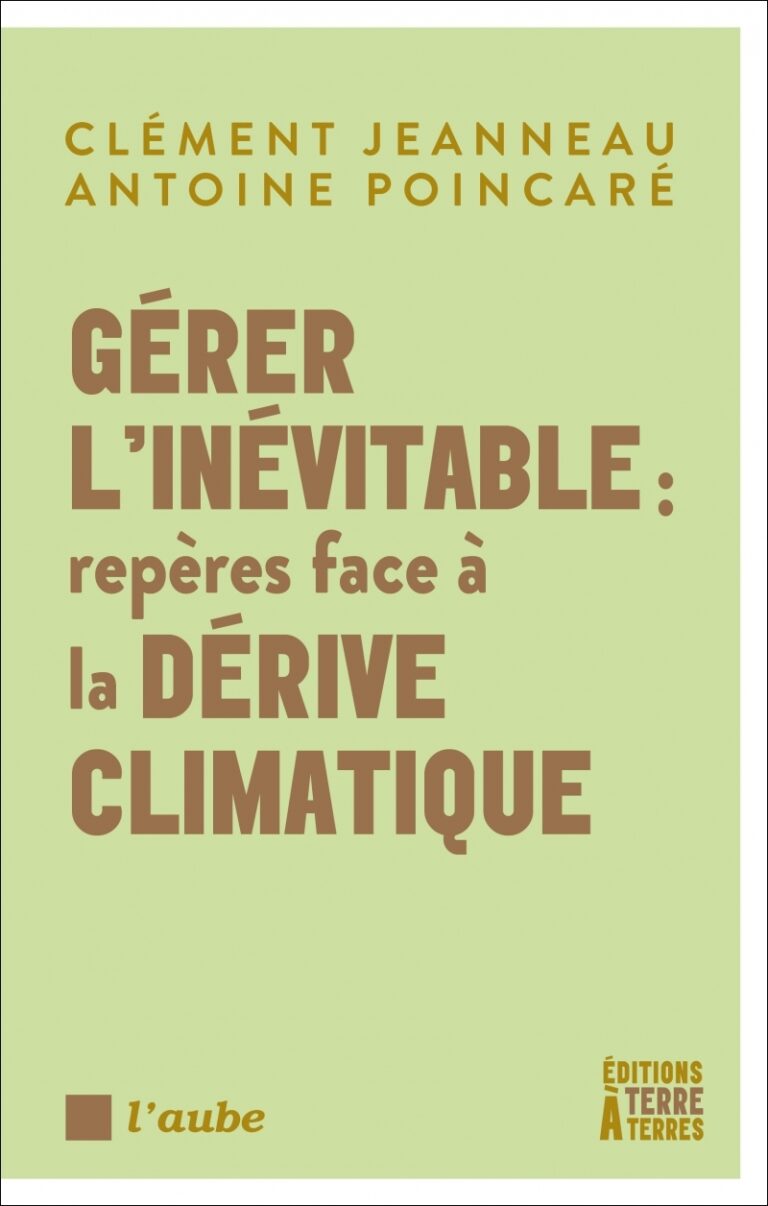Ouvrage bref mais dense, “Que sur toi se lamente le Tigre” tire vers le genre littéraire de la lamentation, qui faisait partie des rites funéraires de nombreux peuples antiques, comme les Grecs ou les Égyptiens. On songe en particulier à l’épisode de la mort de Patrocle dans l’Iliade, ou à certains versets bibliques, mais avec un écart notoire : ici, la pleureuse confie au fleuve le soin de se déplorer sa mort imminente, car elle a commis un crime d’honneur, impardonnable dans la société irakienne. Jamais nommée, et seul personnage à ne pas l’être, comme si la privation du droit à l’existence la déshumanisait, en la dépossédant aussi de celui de porter un nom, l’héroïne raconte sa brève histoire d’amour avec Mohammed, qui, mort au combat, n’a pu revenir l’épouser. Elle demeure, enceinte et seule, et doit affronter les conséquences de son acte, effectué par amour, mais sans plaisir, ce qui colore le récit d’une ironie tragique. La sexualité des femmes apparaît toujours soumise et celle pratiquée par les hommes s’apparente à un viol. Les descriptions faites par les deux belles-sœurs en témoignent, Baneen, la bonne épouse, note que son mari la “touchait comme on touche une arme”, une métaphore guerrière qui exprime la violence des rapports hommes / femmes et la souffrance éprouvée par ces dernières.
L’annonce de sa grossesse faite à la narratrice à l’hôpital résonne avec une extrême brutalité, que retranscrit le style incisif de l’auteur : “Alors, c’était comme une sentence de mort. En une phrase, le médecin avait placé ma tête sur le billot.” Car le livre pourrait s’intituler “Chronique d’une mort annoncée”, pour reprendre la formule de Gabriel Garcia Marquez. C’est en effet vers la tragédie, plus que vers le romanesque, que tend ce récit, constitué d’une série de monologues, que recouvre la voix de la narratrice et dont on connaît l’issue. Le principe de la tragédie consiste, justement, à ne pouvoir réussir à enrayer la machine infernale si bien décrite par Cocteau, ni d’empêcher que le protagoniste coure à sa perte. Le dénouement est en route, tandis que tour à tour, les trois frères, la belle-sœur, la sœur cadette, l’amant mort, la mère de la jeune femme et le fleuve donnent leur point de vue sur l’acte condamné par une société très répressive pour les femmes. Ce choix des voix multiples permet aussi de comprendre l’inéluctabilité du destin de l’héroïne, chacun confortant, tour à tour, le modèle social. Enfermement physique, enfermement narratif et enfermement tragique se conjuguent. La question de la sexualité, du tabou, du franchissement de l’interdit revêt une intensité dramatique. La transgression, ici, devient synonyme de mort. “L’honneur est plus important que la vie. Chez nous, mieux vaut une fille morte qu’une fille-mère”.
Dès le début, ce roman choral oppose deux mondes, le masculin et le féminin, l’un marqué par la liberté, l’autre par des restrictions. Les femmes dissimulent leur corps, comme en témoigne la scène glaçante de l’abaya, ce long manteau noir imposé par le frère aîné dès que la fillette devient pubère. Cette opposition est relayée par d’autres : le rouge et le blanc, écarlate du sang menstruel ou celui de la défloration, blancheur du sperme assimilé au lait, détournant par là l’image du lait maternel que la jeune femme ne verra pas couler. Le sang intervient de manière obsessionnelle, teintant de rouge le récit. Le rouge et le blanc, deux couleurs qui se caractérisent par leur ambiguïté, car elles symbolisent à la fois la mort et la vie. L’usage des linges apparaît significatif et renvoie à des rites de passage : le drap taché de sang des noces, celui qui éponge le sang des menstrues, ou l’abaya dont on couvre la fillette devenue nubile. La grossesse illicite entraîne la condamnation à mort. Donner la vie peut tuer, et les deux figures de femmes, Baneen et sa belle-sœur attendent toutes deux un enfant, mais l’un aura le droit de naître, l’autre non : “Son ventre à elle porte la vie, le mien la mort”, constate l’héroïne. Le corps devient lui-même synecdoque, le fragment se substitue à la totalité. “Mon corps n’était plus que ventre”, ou encore : “Les mots sont restés bloqués dans mon ventre”, dit-elle.
Mais au-delà de cette opposition des corps, la guerre opère une monstrueuse réconciliation, en faisant du sang des hommes celui du martyre. Au corps piège de la femme répond celui, sacrifiable, de l’homme. Eux aussi risquent leur vie. La jeune femme évoque son amour mort : “Je pense à Mohammed, dont le corps a disparu sous Mossoul. J’ai encore mal, mon amour, à penser à ce corps écrasé sous les pierres, brûlé, anéanti”. Le fleuve, dont l’eau se mêle au sang, avec une récurrence terrifiante, conserve la mémoire d’autres morts, de toute éternité, tandis que le texte égrène le nom de cités célèbres, Uruk, Bagdad, Ninive. La description de la ville moderne porte les stigmates de la guerre, les blindés en stationnement y évoquent de gros insectes, les palmiers eux-mêmes semblent décapités, tandis que la mention des attentats crée une insoutenable toile de fond. Le paysage porte les cicatrices des conflits, tout comme les corps. “À chaque martyr les hommes tiraient sur les étoiles et les femmes déchiraient leurs voiles.” Amir, le frère assassin, c’est ainsi qu’il se définit, apparaît lui-même victime d’un syndrome post-traumatique, hanté par les morts de la guerre, “nos vivants, nos victoires”. Derrière le mari brutal on découvre un enfant effrayé, incapable de trouver le sommeil : “Nous sommes devenus un pays d’insomniaques”. Cela ne l’empêche pas de s’exonérer de toute responsabilité dans la mort de sa sœur, car s’il est coupable, “la rue, le quartier, la ville, le pays” en portent aussi le poids. Amir s’inscrit dans cette lignée de figures tragiques dévidée par le roman. Il ne peut fuir le rôle qui lui est assigné. Aucun d’eux ne le peut. Chacun des personnages, englué dans la fonction que lui impose la norme sociale, semble n’avoir d’autre choix que d’obéir. Pourtant profondément humains, ils sont incapables de rébellion, et demeurent avec leurs doutes et leurs peurs, jusqu’à l’issue fatale. Ce que résume l’héroïne : “Nous tuons, nous sommes tués. Nous sommes un pays de victimes et d’assassins”. Les extraits de Gilgamesh, qui entrent en résonance avec quelques passages du roman, sur l’amour ou sur la mort, cette épopée primordiale, qui a influencé la Genèse et l’Odyssée, confèrent au texte sa profondeur et son universalité.
Le livre, en dépit de sa brièveté, imprime en nous une trace vive. À travers l’économie de la parole et le lyrisme d’une langue aussi précise que poétique, se pose la question de la condition des femmes au Moyen-Orient, mais aussi de celle des hommes, enfermés dans une société qui oppresse les individus en leur imposant des normes d’un autre temps. L’expérience personnelle et professionnelle de l’auteur, photographe et journaliste, lui permet de porter un regard critique sur ces existences. La présence du Tigre s’avère essentielle. La jeune femme se lamentant dans la chambre verte, (elle n’a plus le droit de s’asseoir sur ses rives depuis qu’elle est femme, et se trouve recluse en raison de sa faute) ou le frère au bord de l’eau avec ses fantômes, pourraient aussi s’apparenter à des images bibliques, comme celle de l’exil à Babylone, et des lamentations auprès du fleuve. Une dimension cosmique parcourt le texte, qu’il s’agisse de la terre tremblant dans le ventre de la femme sacrifiée, (ce sont les mots qu’elle prononce), ou du rappel de l’étoile tombée aux pieds de Gilgamesh. Personnage à part entière, le Tigre s’avère à la fois porteur d’histoire et lieu de mémoire, terme qui jouerait simultanément sur la mémoire du paysage et la mémoire de l’eau. Tout en se situant au présent, ce beau livre excède la dimension temporelle que l’on pourrait lui croire assignée. Il se joue des frontières pour nous renvoyer à d’autres époques, d’autres civilisations, rappelle des fragments d’autres textes, et en particulier ce récit fondateur, l’épopée de Gilgamesh, réflexion sur la condition humaine, la mort, la quête de l’immortalité, qui a influencé la Genèse ou l’Odyssée, fondateurs à leur tour d’autres récits, et accédant, comme lui, à l’immortalité littéraire.
Marion POIRSON-DECHONNE
articles@marenostrum.pm
Malfatto, Emilienne, “Que sur toi se lamente le Tigre”, Elyzad, Littérature, 03/09/2020, 13,90€
Retrouvez cet ouvrage chez votre LIBRAIRE près de chez vous