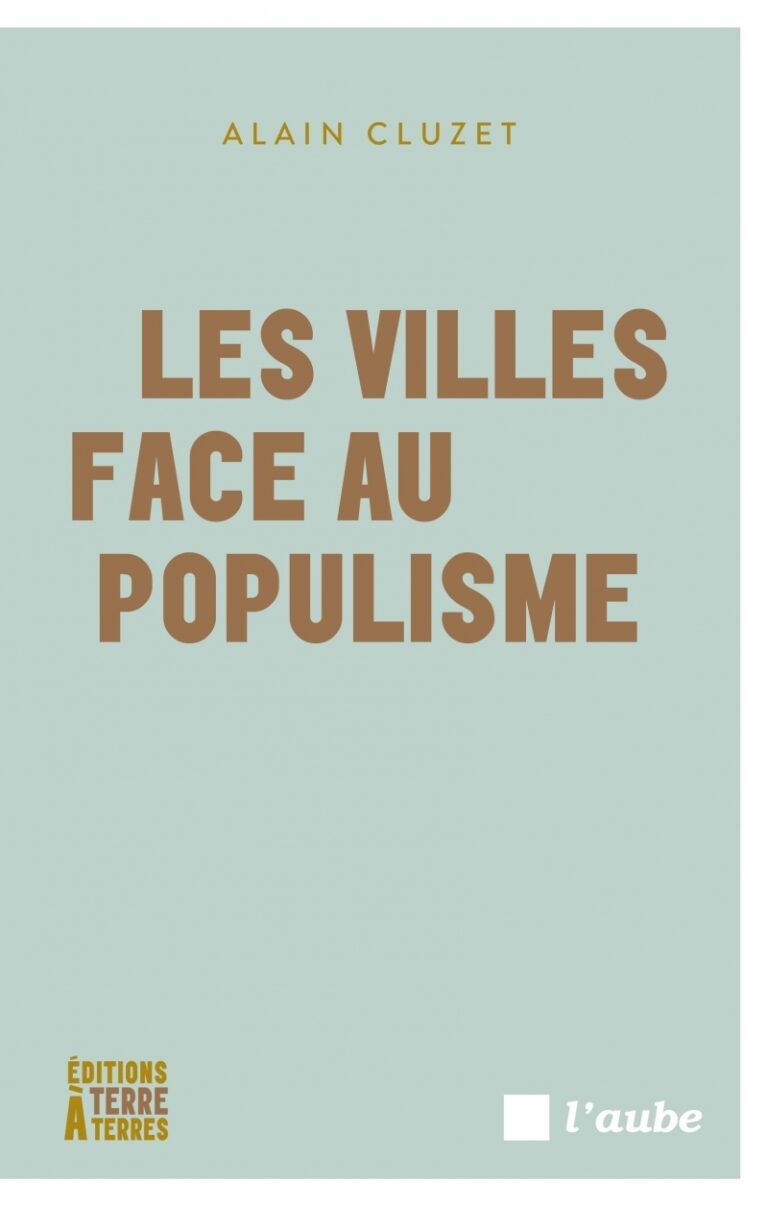Christophe Carrées, Mais où vont les poussières, Les Éditions du Cerf, 21/08/2025, 224 pages, 18€.
Écoutez notre Podcast
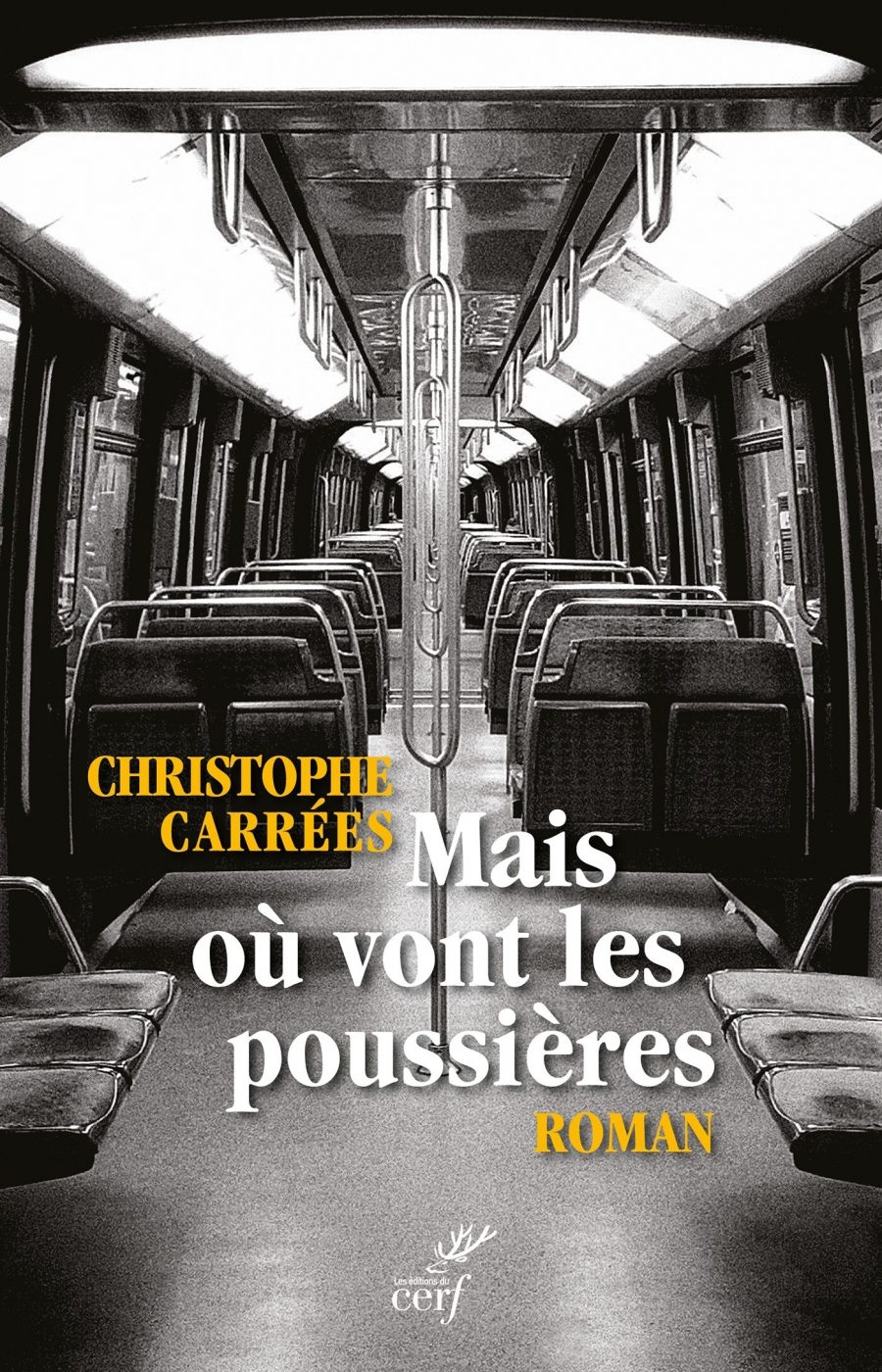
Christophe Carrées déploie avec Mais où vont les poussières une fresque intime et sociale d’une rare intensité, où chaque fragment narratif devient tesselle d’une mosaïque existentielle vertigineuse. Le roman s’ouvre sur cette confession programmatique : “J’ai en commun avec Darwin d’être persuadé que tout est bel et bien là par hasard”, posant d’emblée les jalons d’une œuvre qui embrasse le chaos ordinaire avec une lucidité désarmante. L’architecture du récit, structurée en sept chapitres aux titres évocateurs – Vestiges, Vétilles, Rebuts, Rognures, Salissures, Ruines, Reliques – compose une symphonie du déclin où chaque mouvement explore les strates successives d’une existence marquée par l’érosion sociale. Cette progression lexicale, qui va du fragment archéologique à la relique sacrée, dessine le parcours initiatique d’un narrateur-Poussière confronté aux béances de la modernité tardive.
La prose du prolétariat
Christophe Carrées saisit avec une acuité redoutable la captation des micro-violences du monde du travail contemporain, transformant chaque entretien d’embauche, chaque contrat précaire, chaque licenciement en stations d’un chemin de croix postindustriel. Le Patron et la Boss, figures archétypales du management toxique, incarnent les dérives d’un capitalisme prédateur où “le libre marché, l’économie libre, ça marche comme ça, pas autrement, il n’y a que le résultat qui compte”. L’auteur radiographie avec une acuité remarquable les stratégies de survie des travailleurs précarisés, contraints de naviguer entre “contrats à durée putrescible” et promesses d’embauche fantômes. La langue de Christophe Carrées épouse les soubresauts de cette condition, alternant registres argotiques et envolées lyriques, comme dans cette évocation du chômage : “Tel un bourgeois du XIXe siècle, j’ai commandé à un artiste du quartier de nous peindre dans notre habitat, soit quatre hères vivant dans un appartement décati de trois pièces situé sous les combles”. Cette oscillation stylistique traduit la schizophrénie sociale du narrateur, tiraillé entre ses aspirations culturelles et sa réalité économique.
Au cœur du récit pulse la relation tumultueuse avec “ma Dame”, figure centrale dont la maladie – ce “crabe” qui revient par trois fois – structure la temporalité narrative. Christophe Carrées dépeint avec pudeur et précision les ravages de la maladie sur le couple, transformant l’hôpital en territoire littéraire : “Le couloir est immaculé, sans tache ni poussière (…) La définition même de l’enfer”. L’écriture fragmentaire épouse les intermittences du cœur et du corps souffrant, chaque vignette capturant un instant de grâce ou de désastre dans cette traversée commune de l’épreuve.
L’héritage des humbles
Le quartier populaire parisien où évolue le narrateur devient personnage à part entière, microcosme où se croisent dealers philosophes, artistes fauchés et bobos gentrificateurs. Christophe Carrées cartographie avec finesse les mutations urbaines qui transforment les anciennes zones industrielles en territoires de spéculation : “La scierie tout près de mon domicile, érigée en 1904 et que j’ai toujours connue murée, va être rasée pour laisser place à un immeuble de placement immobilier”.
Le roman excelle particulièrement dans sa restitution des lignées ouvrières, depuis l’arrière-grand-père traumatisé par Verdun jusqu’aux générations contemporaines broyées par la flexibilisation du travail. Cette archéologie familiale révèle les permanences de la domination sociale, les héritages invisibles qui déterminent les trajectoires : “Ce patronyme confinant au ridicule condamnera des générations d’écoliers à crouler sous les quolibets”.
L’œuvre de Christophe Carrées s’impose comme témoignage essentiel sur les invisibles de notre époque, ces existences pulvérisées que l’auteur rassemble avec tendresse dans une prose où affleurent, sous l’ironie protectrice, une humanité bouleversante et une urgence politique sourde. Roman-mosaïque d’une France précarisée, Mais où vont les poussières offre à la littérature contemporaine ses lettres de noblesse prolétariennes.