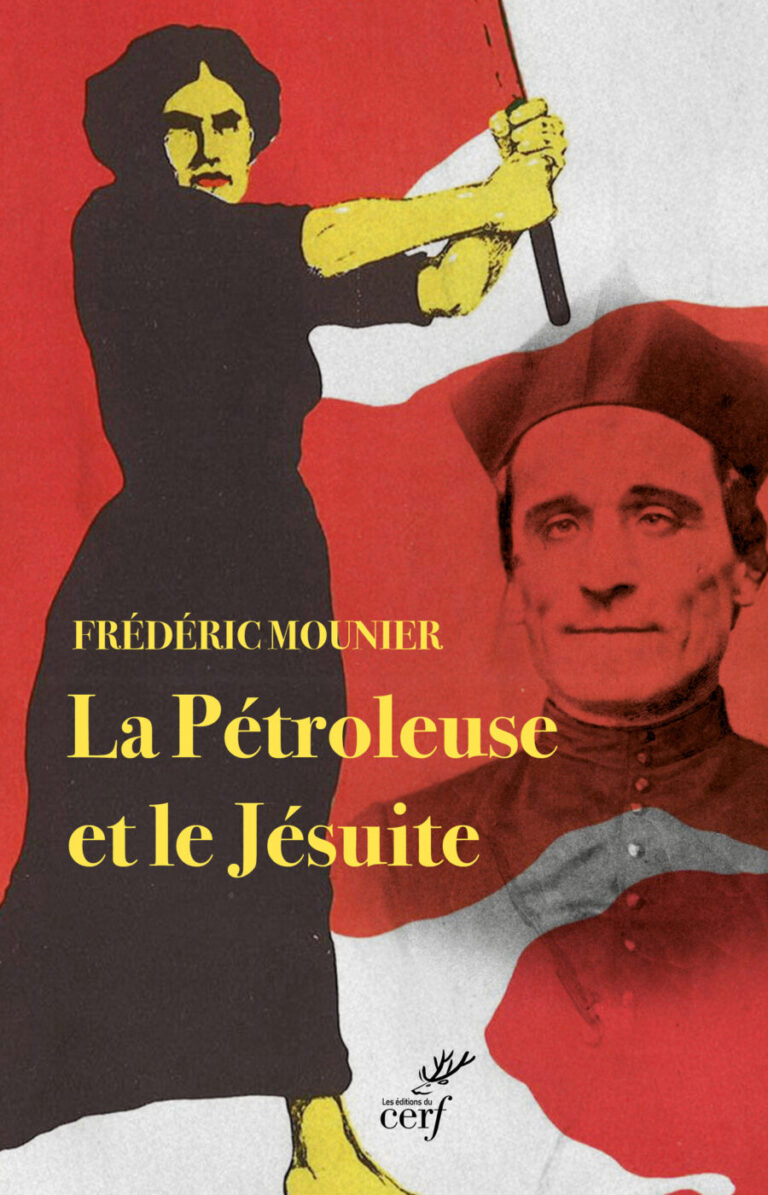Helen Faradji, La Corde blanche, Héliotrope, 03/10/2025, 276 pages, 18€
Un homme est accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis. Une détective privée en disgrâce remonte la piste. Un flic désabusé prend tous les risques. Voilà les ingrédients apparents de La Corde blanche. Mais à mesure que le récit avance, ce n’est plus le « qui a tué ? » qui importe, mais le « qui manipule ? ». Car dans ce roman noir, l’intrigue policière éclaire un récit beaucoup plus vaste sur le délitement du contrat social.
Ici commence le mystère
Le bitume de Montréal a une mémoire. Chaque fissure raconte une histoire, chaque ruelle conserve l’écho d’un secret. C’est sur ce palimpseste urbain que s’ouvre La Corde blanche, le premier roman d’Helen Faradji, publié en 2025 chez Héliotrope Noir. Un corps atrocement mutilé, abandonné dans le stationnement d’une aréna du Plateau-Mont-Royal, devient la première syllabe d’un langage de violence qui contamine aussitôt le récit. Le quartier, avec sa mosaïque culturelle et ses tensions latentes, se mue en un théâtre où la brutalité du crime expose les fractures invisibles de la métropole.
Le roman déploie d’emblée son triangle humain, trois figures ciselées qui portent le poids de l’intrigue. Omar Masraoui, acteur respecté du milieu interlope et pilier de sa communauté, incarne le bouc émissaire parfait, celui dont la chute symbolique sert des desseins qui le dépassent. Face à lui, et pour lui, se dresse un duo lié par une amitié indéfectible forgée sur les bancs de l’université : Lisa Giovanni, détective privée en disgrâce, louve solitaire dont la rage carbure à l’injustice, et Thomas Villeneuve, lieutenant-détective pétri de doutes, homme d’intégrité funambule sur la ligne de crête d’une institution corrompue. Leur pacte de loyauté irrigue ce récit où la corruption, le silence et la peur sculptent le quotidien dès les premières pages, instaurant un climat de suspicion généralisée.
Le néant comme promesse
Helen Faradji sculpte un ballet narratif où le tempo de l’enquête épouse les convulsions d’une ville fiévreuse. Le récit alterne les voix, passant du « je » rageur de Lisa, dont les chapitres exsudent l’urgence et le goût de la vodka, aux chapitres de Villeneuve, écrits à la troisième personne, qui traduisent sa distance, son analyse méticuleuse et son impuissance face à la procédure. Cette polyphonie structure un suspense qui se nourrit de la tension entre l’intuition viscérale de l’une et le légalisme de l’autre. Leurs filatures dans les rues de Montréal, leurs interrogatoires où la vérité se dérobe, leurs confrontations avec une hiérarchie policière complice dessinent une géographie de la peur. La langue est à l’avenant : rêche, nerveuse, québécoise, elle entremêle l’humour discret des dialogues du quotidien à la froideur clinique des descriptions.
C’est dans cet entrelacs que la romancière fouille le territoire à la recherche d’indices qui relèvent d’une sémiotique de la haine. Le roman cartographie un complot dont les signes sont partout, pour qui sait voir : le tatouage d’un triangle rouge frappé d’un chiffre, les graffitis qui maculent les murs, les sigles d’organisations fantômes. Chaque détail ancre le roman dans une hyper-réalité politique, transformant le récit policier en une fresque sociale. L’œuvre dialogue ainsi avec la grande tradition du néo-polar politique à la Jean-Patrick Manchette, où le crime individuel expose le crime collectif. On y retrouve la précision systémique d’un David Simon qui, dans The Wire, auscultait la faillite des institutions américaines, et l’exploration poétique d’un territoire abîmé qui caractérise les romans d’Andrée A. Michaud. L’exergue emprunté à Jérôme Leroy (« L’identité, on ne parlait plus que de ça / dans le monde de la fin… ») agit comme une clé de lecture : le roman explore le poison des crispations identitaires qui hantent le Québec contemporain.
Des dynamiques conspirationnistes
Le roman révèle avec une logique implacable la manière dont l’extrême droite tisse sa toile, depuis les arrière-salles numériques et les forums haineux jusqu’aux cercles du pouvoir politique et financier. La Corde blanche dissèque la mécanique du populisme. Des figures comme l’essayiste Jérôme Beaudoin, l’avocat Luc Tremblay ou l’homme d’affaires Jean-Pierre Lévesque incarnent cette nouvelle élite qui instrumentalise la peur de l’autre pour asseoir son influence. Le personnage de Sébastien Larrivée-Roy, jeune journaliste avide de reconnaissance, est fondamental : il montre la porosité entre la fabrique de l’information et la propagation d’une idéologie mortifère. Le roman expose comment le langage lui-même devient une arme, comment la fiction médiatique se met au service du pouvoir pour créer une réalité sur mesure, prête à être consommée par une opinion publique anesthésiée.
L’œuvre résonne ainsi avec les dynamiques conspirationnistes de notre époque, illustrant le passage de la haine virtuelle à la violence physique via des réseaux d’influence diffus et une propagande savamment orchestrée. La Corde blanche se termine sur une ouverture inquiète. Le complot est exposé, mais ses racines sont profondes. La Corde continue de se tendre, bien au-delà des protagonistes identifiés, suggérant que le mal est viral, systémique, et qu’il suffit d’une étincelle pour que tout s’embrase à nouveau.
Helen Faradji compose un roman noir qui se lit comme un sismographe de notre temps. En orchestrant un récit dense qui entrelace avec brio l’identité, le racisme structurel, les violences policières, le communautarisme, la manipulation médiatique, la politique populiste, la criminalité, l’amitié, la justice, la mémoire et l’intégrité, elle magnifie le genre pour en faire un puissant outil d’analyse sociale. La Corde blanche est une fable politique sur la fragilité du pacte social, un appel à la lucidité face aux discours de haine, et une magnifique démonstration que la littérature demeure un lieu de résistance essentiel.