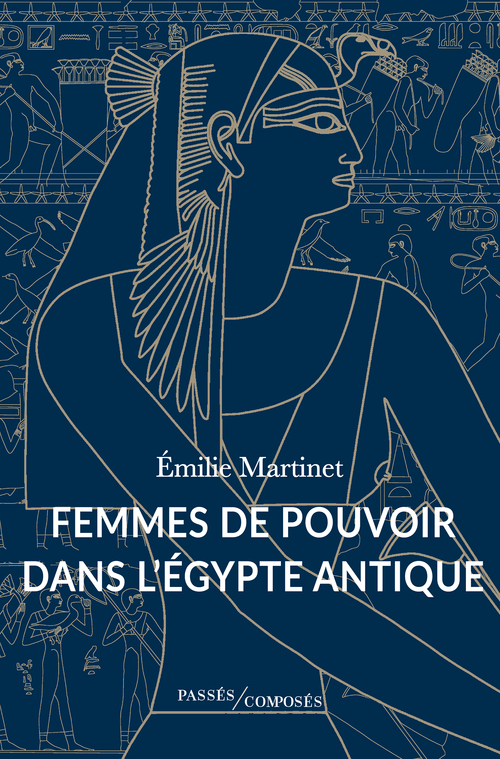Olivier Amiel, Touchdown, journal de guerre, Les Presses littéraires, 18/07/24, 134p, 12€.
Touchdown, journal de guerre, le troisième roman d’Olivier Amiel, emprunte la voie escarpée et glissante de La cloche de détresse, le magnifique livre de Sylvia Plath, lequel attendra une dizaine d’années avant de devenir un classique incontournable de la littérature mondiale, le succès poursuivant parfois, en claudiquant, son bonhomme de chemin. Et cela frustre justement Olivier Amiel :
Voilà, mon second roman a eu l’honneur de très bons retours dans la presse, d’excellents articles et des recensions ne pouvant que flatter mon ego. Pourtant ce n’est pas assez pour moi.
La machinerie du “Milieu littéraire” – ce terme donne une saveur mafieuse, un arrière-goût de bandits à la petite semaine – est implacable et les élus sont rares. Sont-ils pour autant glorieux et dévorés de génie ?
Les premiers, derniers des derniers
Ce journal de guerre a le grand mérite d’ouvrir le débat : vendre beaucoup de livres ne signe pas la qualité de grand écrivain, définissant juste, ce qui est appréciable, et très apprécié des éditeurs et autres distributeurs, les contours de solides revenus et de retombées en cascades, suivant la politique éculée de l’arroseur arrosé. Qui plus est à notre époque, laquelle se tâte pour interdire Sade et Céline, stylistes exceptionnels et explorateurs déchaînés de toutes formes artistiques de liberté. En son temps, déjà, Flaubert se contentait d’une élite de lecteurs raffinés et intelligents. Peinerait-il à en trouver deux mille aujourd’hui ? Stendhal voyait le succès le fuir, un comble, et se réfugiait derrière cette terrible formule que Bruno de Cessole me rappela un jour, avec un grand sourire et un fond de tristesse dans la voix : “Il faut se foutre de tout !” Charmante époque que la nôtre où l’on n’embrasse plus les princesses endormies de peur d’une plainte pour viol (la confrérie des dragons remercie d’ailleurs très chaleureusement les possédées ayant mitonné ce concept novateur sur un coin de leur table de cuisine, elles ont sauvé l’espèce, les cailles au secours des écailles, quoi !), où l’on torpille des titres établis (voir du côté d’Agatha Christie ou de Joseph Conrad) et encense les uns plutôt que les autres.
Olivier Amiel se livre, avec audace, à un parallèle particulièrement éclairant entre un écrivain dont je n’ose écrire le nom et Annie Ernaux, dont certaines prises de position ont de quoi faire rougir un humaniste bon teint, s’il en existe encore. La loterie littéraire a plus besoin de bonne conscience que de grands capitaines. Jünger, souvent cité par Olivier Amiel, entre journaux de guerre sans doute, immense écrivain s’il en est, peut-être le plus grand du siècle dernier, abandonne toutes chances de Nobel pour avoir porté l’uniforme de l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale (on oublie ses critiques appuyées contre le dictateur local, bien sûr) alors que Gunter Grass, un autre parmi les tout meilleurs (préférez cependant Une Rencontre en Westphalie, superbe d’imagination, au Tambour, plus déstabilisant, même s’il reste incontestablement grandiose), sous couvert de positions sociales-démocrates, le sens du vent, les moutons panurgeant, obtient la distinction suprême, qu’il méritait, là n’est pas notre propos, pour laisser glisser un peu après qu’il avait servi dans les Panzers-maison de la Waffen SS, une activité bien plus virulente que les ronds-de-jambe parisiens de Jünger. Il faut plaire avant de savoir écrire, peu importe d’ailleurs si l’on écrit bien, si l’on pense comme il faut. Un sursaut de l’intelligence collective, celle qui se bâtit en lisant des pages, où se déguste la liberté et se cultive l’indépendance, est appelé. Le succès, on peut s’en foutre. Il faudrait même le fuir, l’éviter comme une nouvelle peste brune, la qualité d’une écriture devenant plus incertaine le nombre d’exemplaires vendus augmentant (sont-ils lus d’ailleurs, voilà une question intéressante !)
À L’Ouest, rien de nouveau
Olivier Amiel échappera à cette décadence ? Il est chanceux et ses lecteurs l’apprécieront d’autant. Succombera-t-il, dans sa retraite intérieure, exil faussement doré, à l’américanisme qui le guette ? L’héroïne de Sylvia Plath ne dispose pas d’une voix intérieure, celle du père qui plus est, qui le sauve de tout : “l’Américanisme est du mime, on singe donc l’American way of life exporté par l’impérialisme culturel ?” Exit les John Wayne sur-burnés, les Rambo confits à la testostérone, les Popeye shootés à l’épinard, les footballeurs en armure, véritables gladiateurs de foire (diable, on joue ici sans, que nous soyons treize ou quinze et cela claque plus joliment), Pirandello, dès 1920, avait déjà tout compris : “L’argent qui circule dans le monde est américain et derrière cet argent court le monde de la vie et de la culture.” Le bon président Hoover n’avait-il pas remarqué que “là où le film américain pénètre, nous vendons davantage d’automobiles américaines.” Restons attachés à l’azur de notre maillot, à la saucisse grillée toastée d’aïoli, au rouge qui tabasse le gosier mais bétonne nos artères. Pour cela, cultivons notre indépendance, lisons des livres, les remue-méninges, les à contre-courant, les seuls-contre-le-monde. Commencez donc par ce Touchdown, journal de guerre et sortez la tête, avec son héros, de l’eau de là !