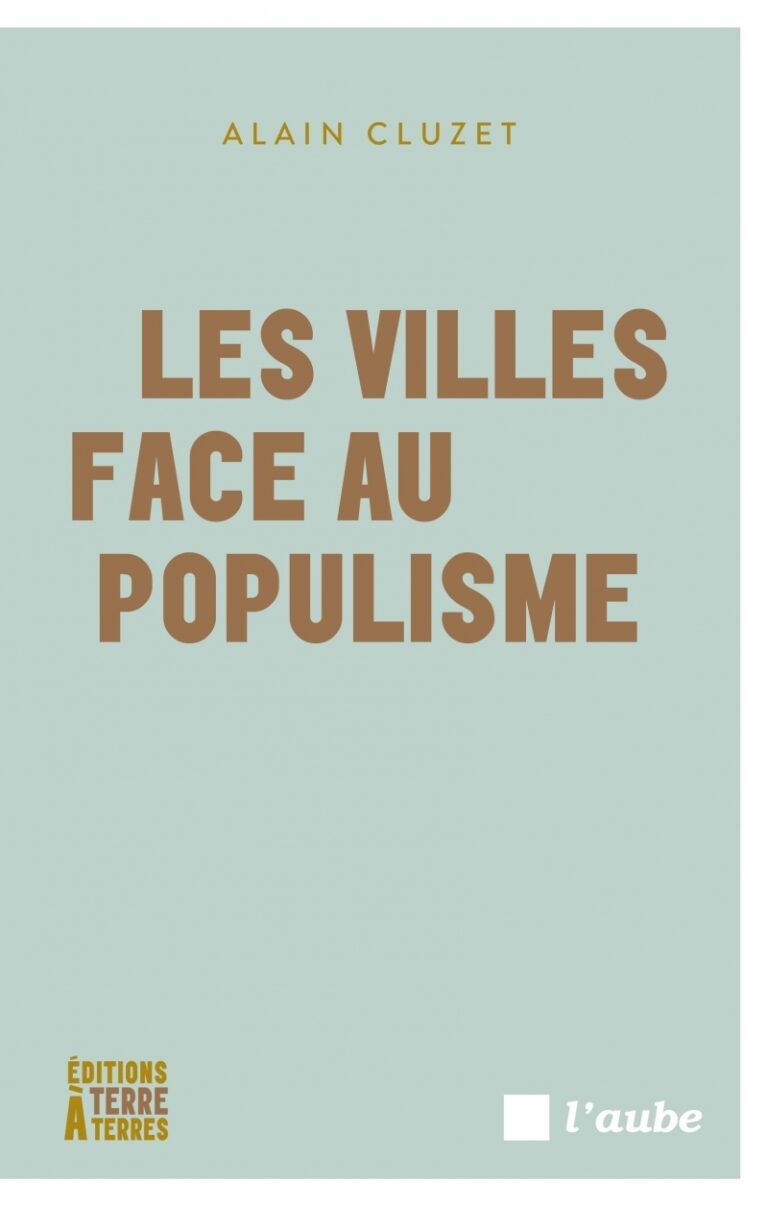Clara Breteau, L’avenue de verre, Éditions du Seuil, 03/01/2025, 224 pages, 20,50 €
L’Avenue de verre, premier roman de Clara Breteau, offre une méditation saisissante sur les héritages invisibles de la colonisation française en Algérie. Présenté comme une suite de fragments-vitraux, ce texte d’une limpidité trompeuse nous invite à scruter les transparences et les opacités qui structurent la conscience postcoloniale contemporaine. Entre enquête familiale et exploration des silences transmis, l’autrice plonge dans l’histoire de son père, laveur de vitres d’origine algérienne, et remonte jusqu’à son grand-père disparu durant la guerre d’indépendance.
Le verre comme matière narrative
Au cœur du roman se trouve une métaphore structurante : le verre, matériau paradoxal qui à la fois sépare et relie, révèle et déforme. Les vitrines que le père d’Anna, protagoniste du roman, nettoie inlassablement sur “l’avenue de verre” à Tours deviennent le prisme à travers lequel se lit toute l’histoire : “pour certains, rapportait le journaliste, Johnny était ‘un rayon de soleil’ – et il y avait dans cette image passe-partout quelque chose de spectral, de transparent, qu’Anna ne pouvait s’empêcher d’approuver”.
Cette transparence s’avère moins une qualité qu’une condition existentielle imposée : le père est devenu transparent, quasi fantomatique, prisonnier de son propre effacement. Clara Breteau joue magistralement avec cette symbolique du verre qui traverse tout le texte, depuis les vitres nettoyées quotidiennement jusqu’aux amulettes berbères brisées, en passant par la “tache méditerranéenne” qui s’efface progressivement sur la peau d’Anna.
Le roman entrelace cette matérialité vitreuse à la construction même du récit. Les fragments qui composent le texte fonctionnent comme autant d’éclats réfléchissants, chacun renvoyant une image partielle d’une histoire familiale éclatée. L’écriture procède par touches impressionnistes, faisant émerger non pas une narration linéaire, mais une constellation de sensations, de souvenirs et d’indices : “Anna cherche des histoires, et on lui en raconte. Elle parle à des amis de son père, des anciens collègues, des familles arrivées d’Algérie à la fin de la guerre, comme lui. Elle sait qu’elle oublie vite, alors elle note, collecte”.
Archéologie du silence colonial
L’Avenue de verre s’inscrit dans une quête mémorielle qui fait écho aux travaux de Benjamin Stora ou d’Alice Zeniter. Mais la particularité de Breteau tient à sa façon d’aborder l’histoire coloniale non comme un récit à reconstituer, mais comme une présence fantomatique qui continue de hanter les corps et les espaces. Le père d’Anna, arrivé en France à 17 ans en 1962, incarne cette dimension évanescente : “son père tout en haut d’une échelle appuyée contre le mur d’une maison coquette. Sa mobylette avec ses seaux est garée sur le bas-côté, il y a des balais qui flottent sur la page, et puis aussi un palmier, une pastèque, comme des meubles rescapés d’une tornade. Anna a colorié la peau de son père en marron foncé, il porte un béret rouge, une combinaison violette, et tout son corps est transparent“.
Le silence qui enveloppe la figure paternelle n’est pas simplement personnel – c’est un silence systémique, institutionnalisé. La narratrice explore comment les traumatismes de la guerre d’indépendance algérienne ont été effacés de la conscience française, créant des trous dans la mémoire collective qui se répercutent dans les histoires familiales. Lorsqu’Anna découvre, par hasard, dans un commentaire en ligne sous un article nécrologique sur son père, que son grand-père aurait été “harki” et “massacré par le FLN algérien”, ce fragment d’information devient emblématique de la manière dont les histoires coloniales circulent : par bribes, incomplets, en marge des récits officiels.
La quête d’Anna pour comprendre ce qui est arrivé à son grand-père Hadj s’apparente à une archéologie impossible : “Peut-être qu’Anna ne saura jamais qui a assassiné son grand-père Hadj, ni de quelle force le cancer qui a frappé son père était le nom exact. Elle sait autre chose pourtant : ces deux hommes, pour elle, comme Bouziane et son fils, sont les têtes émergées de l’iceberg colonial“. Cette image d’iceberg est particulièrement révélatrice de l’approche de l’auteure : ce qui est visible n’est qu’une infime partie de ce qui structure les relations postcoloniales.
La double absence et les identités flottantes
Le roman explore avec finesse les identités hybrides et leur fragilité. Anna, élevée par sa mère française, sans le nom de son père, porte en elle une absence, un vide généalogique. Son corps même semble poreux, incertain : “Anna est une sorte de caméléon. Elle prend l’apparence du lieu où elle se trouve“.
Cette indétermination identitaire n’est pas seulement individuelle mais caractéristique des enfants de l’immigration postcoloniale, qui vivent dans ce qu’Abdelmalek Sayad appelle une “double absence” – ni pleinement ici, ni vraiment là-bas. Le roman analyse subtilement comment cette condition se manifeste dans les détails quotidiens : les canines pointues qu’Anna découvre être un trait hérité de sa famille paternelle, la façon dont son père se fait appeler “Johnny” plutôt que par son nom arabe, l’étrange fascination d’Anna pour les espaces intermédiaires et les reflets.
Clara Breteau propose une réflexion subtile sur la transmission et ses ruptures. Le père d’Anna a délibérément coupé ses enfants de leur héritage algérien, comme s’il avait voulu “que les traces s’effacent et les rares qui restent perdent toute substance“. Cette coupure crée chez Anna une identité lacunaire, marquée par le manque et l’absence. Pourtant, le roman suggère que même cette absence est une forme de transmission : “était-elle l’un des spectres fatigués du monde de son père ?”
Le roman aborde également la question de l’invisibilisation sociale des immigrés, à travers la figure du père laveur de carreaux qui devient presque transparent à force de nettoyer les vitres des autres : “Qu’est-ce que ce papa de verre que l’on a façonné et donné à Anna, et qu’elle regarde aujourd’hui, comme on contemple une figurine, sans trop savoir qu’en faire ?”. Cette invisibilité, loin d’être accidentelle, apparaît comme le produit d’un système colonial qui se perpétue dans les hiérarchies sociales contemporaines.
Une topographie des fractures
L’espace dans L’Avenue de verre n’est jamais neutre. La ville de Tours, traversée par son “avenue de verre” où travaille le père d’Anna, devient un microcosme des fractures coloniales françaises. Les frontières invisibles qui séparent les différentes vies du père – entre sa famille officielle et la mère d’Anna, entre son passé algérien et son présent français – se matérialisent dans la géographie urbaine.
La narratrice cartographie ces espaces fracturés avec une acuité remarquable, montrant comment les traumatismes historiques s’inscrivent dans les lieux du quotidien. Les échos de l’histoire coloniale résonnent dans ces espaces vidés, comme dans le corps de l’avenue de verre elle-même, où la France expose ses marchandises derrière des vitrines impeccables.
Le roman esquisse également une géographie plus vaste, allant du château tourangeau d’où est partie la conquête de l’Algérie en 1830 aux montagnes des Aurès, en passant par les archives d’outre-mer à Aix-en-Provence. Cette cartographie révèle les connexions secrètes qui lient ces espaces apparemment distincts : “Mais quelque chose du massacre avait commencé là, s’était nourri de cette pierre, de ce vin, de cette eau, dans cette petite vallée juste à côté de chez eux“.
Une écriture de l’effacement
Le style de Clara Breteau est remarquablement adapté à son sujet. Son écriture travaille par accumulation de détails sensoriels qui créent une atmosphère brumeuse, légèrement floue, comme une vitre sur laquelle la buée s’est déposée. Les phrases courtes alternent avec de plus amples périodes, créant un rythme heurté qui mime les hésitations de la mémoire.
La structure fragmentaire du texte – composé de courts chapitres qui fonctionnent comme des tableaux ou des instantanés – reproduit formellement l’expérience d’une mémoire trouée, incomplète. Les répétitions et les variations autour des mêmes motifs (le verre, les vitres, les reflets, le sable) tissent un réseau d’associations qui donne au roman sa cohérence poétique : “Plus loin, figés sur quelques centimètres carrés, des tombées de pollen roux, un insecte à carapace orange, puis un autre aux mandibules collées. Des entomologistes pourraient venir là, récolter ces êtres déjà saisis sur des lames de verre“. Cette attention aux détails infimes, ces traces à peine perceptibles qui s’accumulent sur les surfaces, caractérise l’écriture de Claire Breteau. Elle fait de ces résidus apparemment insignifiants les indices d’une histoire plus vaste qui se joue en arrière-plan.
Entre enquête personnelle et fresque historique
L’Avenue de verre oscille constamment entre l’intime et le collectif. L’enquête personnelle d’Anna sur son père et son grand-père s’élargit progressivement pour englober une réflexion plus vaste sur l’héritage colonial français et ses effets sur les générations actuelles. Ce premier roman de Clara Breteau, par sa sensibilité aux traces et aux absences, s’inscrit dans une lignée d’œuvres qui tentent de réparer les silences de l’histoire coloniale française. Mais il le fait avec une originalité formelle qui renouvelle l’approche de ces questions. En faisant du verre – matériau à la fois révélateur et occultant – sa métaphore centrale, l’autrice propose une méditation subtile sur la façon dont les traumatismes historiques se transmettent et se transforment à travers les générations.
L’Avenue de verre nous rappelle que l’histoire coloniale n’est pas un chapitre clos des manuels scolaires, mais une présence active qui continue de modeler les corps, les espaces et les relations contemporaines. À travers ce prisme, ce très beau premier roman de Clara Breteau offre une contribution précieuse à notre compréhension collective des héritages postcoloniaux et de leurs réverbérations intimes.