Jonas Hassen Khemiri, Les Sœurs, traduction Marianne Ségol-Samoy (français), Actes Sud, 03/09/2025, 688 pages, 26,80 €
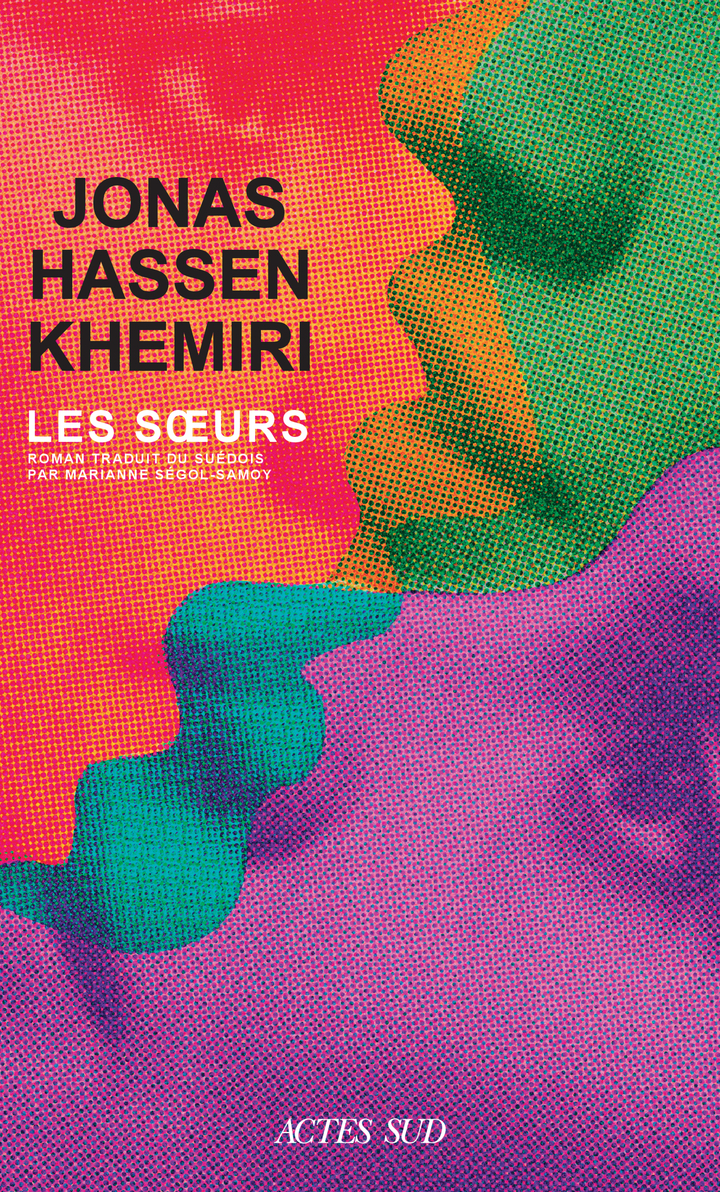
Et si raconter était l’acte ultime de résistance contre la disparition ? C’est peut-être le geste fondateur de Les Sœurs, le roman-matrice de Jonas Hassen Khemiri, une œuvre qui refuse la consolation facile pour explorer les failles sismiques de la mémoire, de la langue et de l’héritage. Au cœur de ce vertige mémoriel, un homme, Jonas, écrivain hanté depuis trente ans par trois sœurs aussi magnétiques qu’insaisissables : Ina, Evelyn et Anastasia. Apparues dans sa vie à Stockholm en 1991 comme une onde de choc, elles disparaissent aussi subitement, laissant derrière elles une béance et le murmure d’une malédiction familiale axée autour de la perte. Le roman devient alors le récit de cette obsession, une fresque tentaculaire qui nous emporte de Stockholm à Tunis, de Paris à New York, à la recherche de ces vies éclatées. Plus qu’un récit de deuil, c’est un manuel de survie narrative, où les fragments de ces existences sont assemblés non pour former un tout cohérent, mais pour témoigner de la beauté obstinée de ce qui a été brisé.
Plus qu’un roman, une quête de soi
Avec Les Sœurs, Jonas Hassen Khemiri poursuit l’excavation de l’archive intime déjà entreprise dans le saisissant La Clause paternelle. Ce nouveau roman déploie une ambition orchestrale, où la quête des origines devient une épopée tentaculaire traversant les continents et les décennies. L’œuvre nous est d’emblée confiée sous le sceau de deux marraines littéraires : Toni Morrison (“Si l’on s’abandonne à l’air, on peut le chevaucher”) et Selma Lagerlöf. Ces exergues ne sont pas que des ornements : ils constituent la clé de voûte philosophique du roman, articulant la tension entre l’abandon aux forces invisibles qui nous façonnent, et la nécessité de préserver son “horloge” intérieure face au chaos du monde. Le livre devient ainsi ce territoire précaire où la narration se fait acte de sauvetage. Sur cette vaste toile, Jonas Hassen Khemiri cartographie, avec une précision empathique, les thématiques qui innervent toute son œuvre : la sororité et la filiation ; la paternité et l’obsession du narrateur ; l’identité métisse et diasporique ; la migration et l’exil ; les langues et le code-switching (suédois, anglais, français, arabe) ; la mémoire et sa fragmentation ; une “malédiction” familiale et les pertes qu’elle engendre ; les amours, amitiés et loyautés fluctuantes ; les classes sociales et la mobilité ; le travail et les précarités urbaines ; les addictions et la santé mentale ; l’éthique du récit et son autoréflexivité ; l’humour et la gravité ; les villes-personnages (Stockholm, Paris, Tunis, New York) ; et enfin, l’art, la littérature et la création comme formes ultimes de résistance.
L’architecture mouvante du souvenir
La structure de Les Sœurs est une machine narrative d’une complexité admirable, qui incarne physiquement la nature fuyante du souvenir. Le roman est divisé en sept “livres” dont la temporalité se contracte à mesure que le récit avance : un an, six mois, trois mois, jusqu’à un jour, et enfin, une minute. Cette accélération vertigineuse elle transforme le temps en une matière plastique, tangible, donnant au lecteur la sensation d’une existence qui, en se rapprochant de son terme, se densifie en instants critiques. La voix narrative, portée par Jonas, un écrivain miroir de l’auteur, est elle-même une entité fracturée. Son projet de reconstituer la trajectoire des trois sœurs Mikkola – Ina, Evelyn et Anastasia – se heurte constamment aux trous noirs de sa propre mémoire et à la question éthique de son regard. Est-il un archéologue bienveillant ou un pilleur d’histoires ? Cette tension est au cœur du livre. Le narrateur, en cherchant à comprendre le lien qui l’unit à ces femmes et à son propre père, figure aussi énigmatique qu’écrasante, révèle les mécanismes de l’autofiction : comment l’écriture se nourrit de la vie des autres, la transforme, et peut-être, la trahit. Le style polyphonique du roman, où se mêlent les voix, les langues et les perspectives, compose une mosaïque où le code-switching agit comme une politique de la voix, révélant les intimités, les distances et les fractures d’une identité diasporique.
Le poids des traumatismes familiaux
Au centre du récit palpite le motif de la malédiction : “Tout ce que vous aimez, vous le perdrez”. Jonas Hassen Khemiri en fait moins un ressort fantastique qu’une grammaire psychologique, une économie intime du risque et du deuil. Pour les sœurs Mikkola, cette phrase devient le prisme à travers lequel elles perçoivent le monde, une prophétie auto-réalisatrice qui conditionne leurs attachements et leurs renoncements. C’est une manière de nommer l’innommable, de donner une forme au chaos des traumatismes familiaux, de la migration, de la perte du père. Cette malédiction devient une forme de lucidité tragique, comme le formule Evelyn avec une forme de défi bravache, en passant à l’anglais comme pour mieux tenir à distance la douleur : “ok, tu peux dire à tout le monde […] qu’on est spéciales parce qu’une malédiction ultra-puissante pèse sur nous qui dit que tout ce qu’on aime nous sera retiré, et malgré cette malédiction, on est toujours là !” Cette posture de résistance face au destin est ce qui confère au roman sa portée politique. L’histoire des sœurs Mikkola est aussi celle de ceux qui doivent composer avec un héritage fragmenté, qui se sentent à la fois d’ici et d’ailleurs, ou de nulle part. C’est un roman profondément ancré dans les questionnements contemporains sur l’appartenance et la mobilité sociale, qui explore la manière dont les trajectoires individuelles sont façonnées par les forces collectives de l’histoire, du genre et de la classe. La narration elle-même, avec ses allers-retours, ses fausses pistes, ses révélations tardives, devient une métaphore de cette quête d’identité, comme le confie une amie du narrateur : “Je suis flattée qu’elle soit si curieuse, lui sourit Ina. Elle était à deux doigts de te demander de lire à haute voix ton journal intime, dit Hector.“
La fin de Les Sœurs est une porte qui ne se referme pas tout à fait, laissant filtrer les courants d’air de l’inachèvement et l’infini des possibles. Si la disparition des sœurs agit comme une prophétie tout au long du récit, la narration elle-même devient l’acte de résistance qui la tient en échec. Jonas Hassen Khemiri ne nous offre pas de réponses ; il nous laisse avec des traces, des voix qui continuent de résonner, des présences spectrales qui habitent désormais notre propre mémoire de lecteur. Le livre refermé, la recherche du narrateur continue en nous. C’est la preuve la plus vibrante que le seul véritable antidote à l’effacement est peut-être de continuer à raconter. Comme le suggère l’exergue de Toni Morrison, “Si l’on s’abandonne à l’air, on peut le chevaucher“. Les Sœurs est une invitation à cet abandon, à ce vol plané au-dessus des ruines du temps, là où la littérature, obstinément, fabrique de la vie.
















