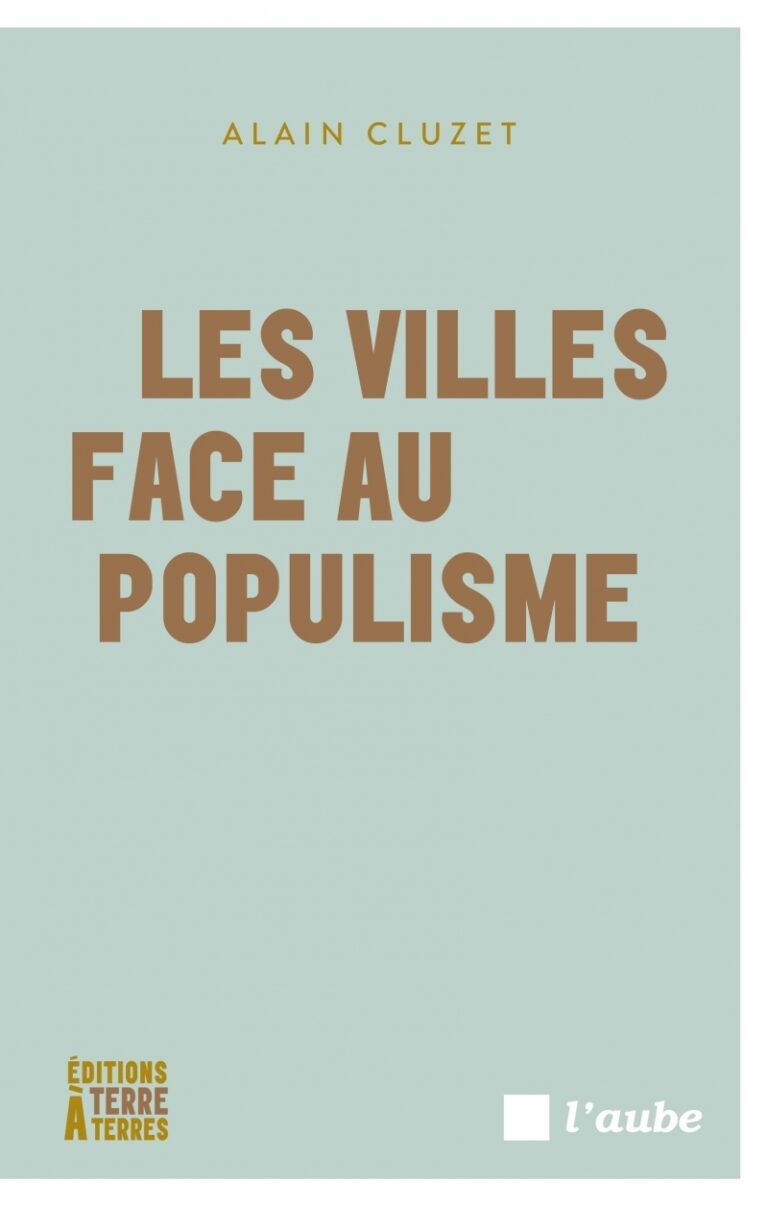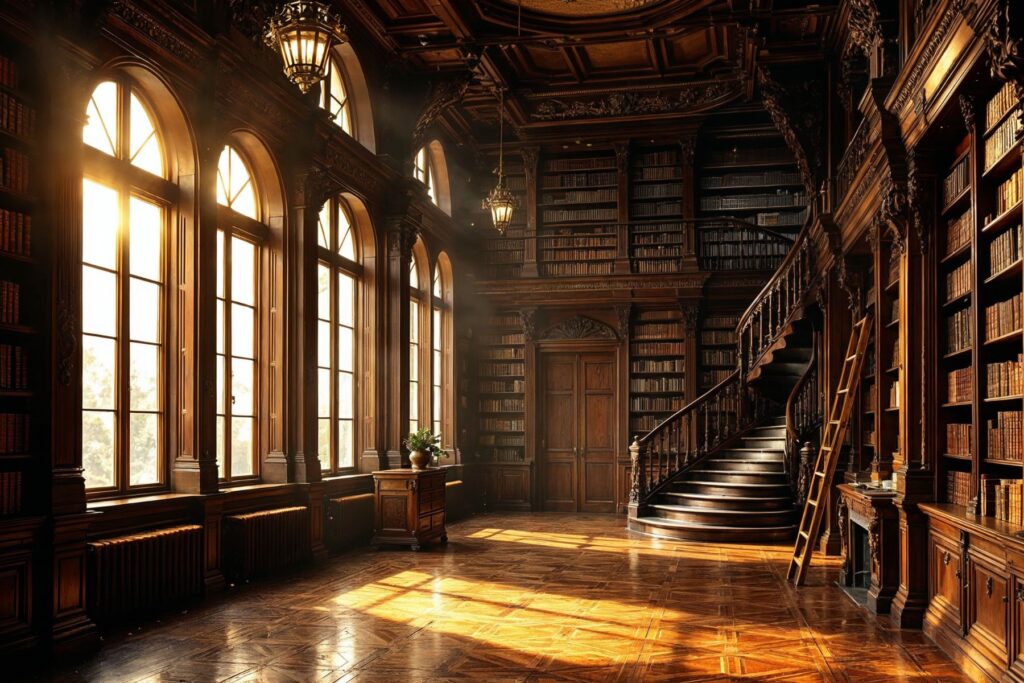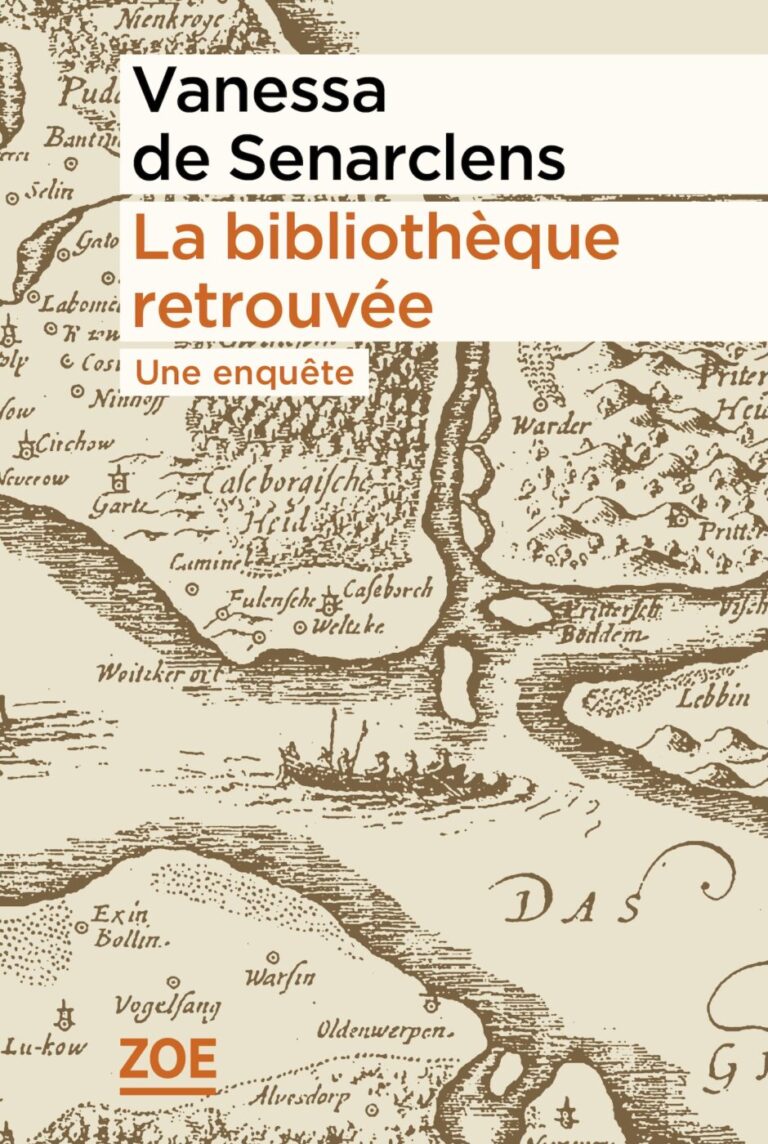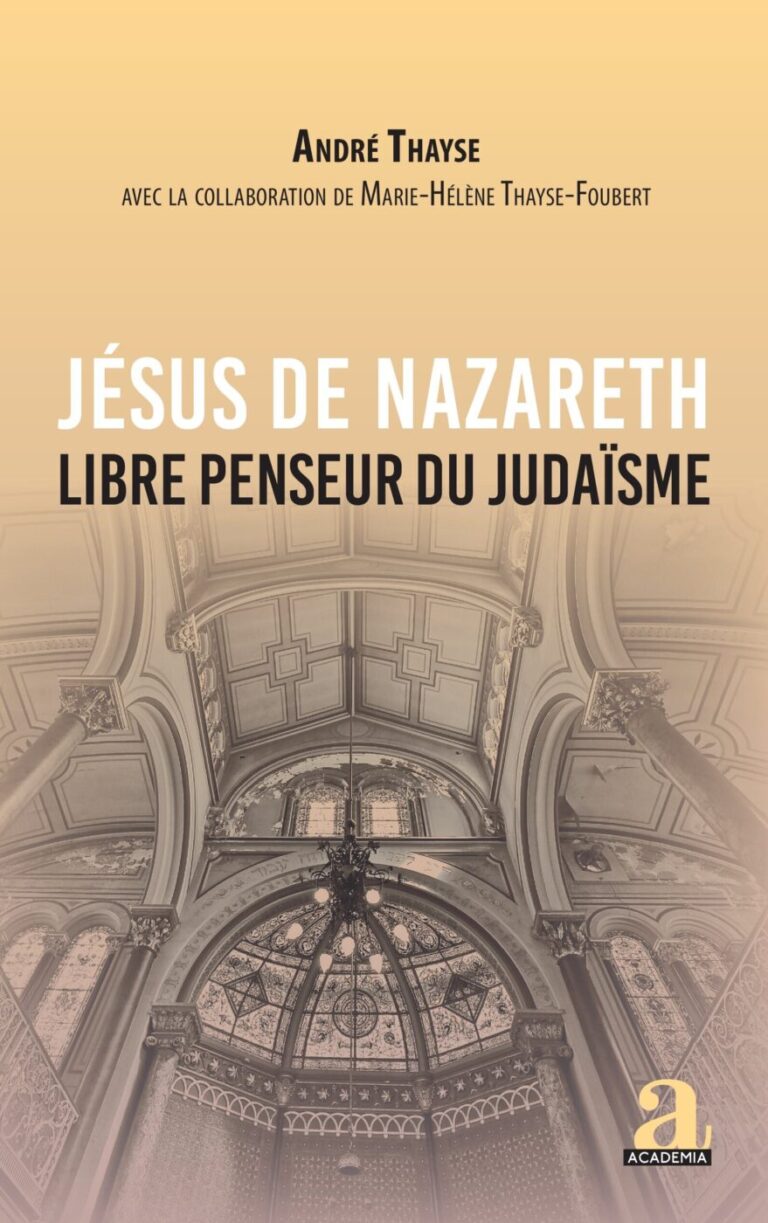Violaine Lison,
Lequel de nous portera l’autre ?, Esperluète Éditions, 17/10/2025, 208 pages, 22€
Découvrez notre Podcast
Lorsque Violaine Lison reçoit, en mars 2014, cinq carnets de tranchées écrits pendant la Première Guerre mondiale, elle ignore encore qu’une rencontre capitale vient de se nouer. Ces cahiers, copiés par Paul Nackart, ami et compagnon d’armes, retracent quatre années de guerre vécues par Léonce Delaunoy, brancardier de l’Armée belge tombé en octobre 1918. Plus de dix ans durant, l’autrice déchiffre, compare, enquête, recueille objets et témoignages, reconstitue une existence fragmentée par la mitraille et le temps.
Lequel de nous portera l’autre ? déploie ainsi un récit où se mêlent voix du passé et regard contemporain, où chaque objet retrouvé devient foyer narratif, où l’écriture fait dialoguer mémoire intime et histoire collective. L’ouvrage inscrit Violaine Lison dans le courant du récit d’enquête littéraire, au croisement de la biographie sensible, de l’essai sur la mémoire, et de la méditation poétique sur les traces.
Une archéologie des voix et des silences
Violaine Lison construit son récit à partir d’une découverte troublante : les carnets reçus portent la signature de Paul Nackart, mais les mots, les silences, les élans appartiennent à Léonce Delaunoy. Le copiste a retranscrit l’auteur, mais en élaguant certains passages, en adoucissant les révoltes, en gommant les attachements les plus ardents. L’autrice reconstitue alors une trame complexe : la voix de Léonce (brancardier, séminariste, fils de fermiers d’Ostiches), celle de Paul (ami fidèle, futur abbé, gardien sélectif de la mémoire), la sienne propre (lectrice, enquêtrice, passeuse), et les échos des familles Delaunoy et Schiltz qui ont conservé dans des boîtes de cigares, de chocolats ou de dragées les reliques du disparu. Pour rendre visible ce travail de réécriture et de censure, Violaine Lison opère un choix typographique marquant : lorsqu’elle reproduit les carnets, le texte tel que Paul l’a recopié apparaît en noir, tandis qu’en rouge, entre crochets, elle insère les fragments supprimés qu’elle a retrouvés dans les carnets autographes de Léonce. Ce dispositif visuel densifie la lecture, fait affleurer les zones d’ombre, révèle ce que la mémoire officielle ou familiale a voulu taire. Le livre orchestre ainsi une mise en scène du réel où l’archive ne se lit jamais seule, mais toujours en résonance avec les gestes qui l’ont sauvée, les lieux qu’elle évoque, les corps qu’elle a traversés.
Léonce Delaunoy : brancardier, poète, révolté
Le portrait qui se dessine magnifie la complexité d’un jeune homme pris dans l’étau de la guerre. Léonce Delaunoy entre au front en août 1914 comme brancardier, statut qui lui interdit de porter les armes mais l’oblige à porter les blessés, à accompagner les mourants, à côtoyer la mort sous toutes ses formes. Ses carnets articulent descriptions précises des combats et méditations sur la nature : les oiseaux (merles, vanneaux, corbeaux), les saisons, les champs de coquelicots deviennent autant de refuges sensibles face à l’absurdité du carnage. Violaine Lison révèle un écrivain doué d’une langue riche, métaphorique, parfois violente, toujours attentive au vivant. Léonce observe les paysages de l’Yser avec l’œil du paysan et du poète : il nomme les plantes, identifie les oiseaux, peint les lumières changeantes des plaines flamandes. Mais il déploie aussi une parole politique acérée, dénonçant les “
grands marionnettistes”, les officiers indifférents, la logique sacrificielle qui broie les soldats. Paul Nackart a censuré une part de cette révolte, sans doute par pudeur ou par souci de respectabilité d’après-guerre. En confrontant carnets autographes et versions recopiées, Violaine Lison restitue cette dimension critique et fait de Léonce un témoin lucide autant qu’un être sensible. Elle n’occulte jamais la brutalité matérielle de cette guerre : les corps démembrés, les corbeaux festoyant sur les cadavres, les soldats riant devant des dépouilles, la jouissance trouble de tuer décrite par Léonce lui-même. Ces pages donnent au livre une charge physique, une âpreté qui empêche toute idéalisation de l’expérience combattante.
Herman Schiltz : l’amitié comme point d’ancrage
Au cœur du récit se tient la rencontre entre Léonce et Herman Schiltz, jeune soldat anversois de trois ans son cadet. Leur amitié devient rapidement le centre émotionnel de l’existence de Léonce. Violaine Lison suit cette relation intense : nuits partagées dans les tranchées, promenades dans les dunes, moments de tendresse dans les ruines de Ramskapelle, séjours au Havre où la famille Schiltz accueille Léonce comme un fils. Les carnets révèlent une intensité amoureuse qui traverse les catégories : fraternité, amitié, amour, tout se mêle dans une langue qui dit les baisers, les étreintes, les regards, les larmes. Lorsque Herman est blessé et contraint de quitter le front, Léonce bascule dans un chagrin profond qui bouleverse son rapport à la vie et à Dieu. L’autrice fait affleurer cette douleur en révélant les passages que Paul avait effacés, montrant comment l’absence de l’ami provoque chez Léonce une crise existentielle et spirituelle d’une violence rare. Elle rend sensible la puissance de ces attachements masculins dans l’univers militaire, sans les réduire ni les figer, mais en les accueillant comme lieux d’invention de soi et de résistance à la déshumanisation.
Objets-mémoire et construction du récit
Violaine Lison structure son livre autour d’objets qui deviennent les points d’appui de sa narration. Chaque chapitre s’ouvre sur une relique : le mouchoir kaki envoyé à Herman quelques jours avant la fin, le couteau de poche gravé de toponymes flamands, les trois boutons de capote revenus du front, la rose séchée sous enveloppe cachetée, les boîtes à cigares ou à dragées contenant lettres, cheveux, branches de buis. Ces objets concentrent le temps, incarnent la présence du disparu, déclenchent l’écriture. Ils témoignent aussi des gestes de conservation : les sœurs de Léonce, notamment Marie, ont glissé ces fragments dans des enveloppes, des boîtes, les ont transmis aux générations suivantes. Le livre alterne ainsi citations longues des carnets, reproductions photographiques des objets et des pages manuscrites, commentaires de l’autrice qui reconstitue, interroge, imagine. Cette construction par montage, où se succèdent archives et hypothèses, témoignages et méditations, donne au récit son rythme propre, entre enquête patiente et sidération poétique. Violaine Lison inscrit son propre geste d’écriture dans cette chaîne de transmission : elle touche, photographie, déchiffre, et finalement réécrit. Son enquête la mène dans les archives en ligne, au cimetière d’Ostiches, à la chapelle de Notre-Dame du Buisson, chez les descendants Delaunoy et Schiltz. Elle reconstitue la géographie sensible des Collines wallonnes et des plaines de l’Yser, fait résonner les lieux avec les mots de Léonce, construit une cartographie où le passé affleure dans le présent.
Spiritualité, doute et redéfinition de Dieu
La dimension spirituelle traverse tout l’ouvrage. Léonce, séminariste destiné à la prêtrise, interroge sans cesse sa foi. Violaine Lison montre comment il redéfinit Dieu à partir du vivant : “
le Dieu de la plante qui sort de la graine, du sol humide, de la neige, du brouillard“, plutôt que le Dieu abstrait de la théologie. Cette spiritualité incarnée articule prière, attention aux saisons, fraternité avec les oiseaux et les arbres. Léonce prie la Vierge du Buisson, porte un chapelet, mais doute aussi, s’indigne, crie vers le ciel quand la guerre dévaste tout. Violaine Lison ne fige jamais cette quête en récit édifiant : elle en fait un cheminement mouvant, traversé de colères et d’apaisements, de révoltes et de résignations. Elle éclaire ainsi la complexité d’une génération de jeunes catholiques confrontés à l’absurdité du carnage, obligés de repenser leur rapport au sacré face à la mort de masse et à l’indifférence des états-majors.
Porter l’autre : mémoire, transmission, écriture
Le titre du livre pose une question lancinante : lequel des deux amis portera l’autre ? Léonce et Paul se la posaient durant la guerre, sachant qu’un brancardier peut à tout moment devenir le blessé qu’on transporte. Mais le portage déborde cette dimension littérale : il désigne aussi la transmission mémorielle, le geste de recopier les carnets, de conserver les objets, d’écrire le livre. Violaine Lison révèle des gestes familiaux bouleversants autour de la dépouille de Léonce, des décisions prises dans l’urgence du deuil pour ramener le fils dans le verger d’enfance. L’autrice prolonge ce portage en faisant revivre Léonce par l’écriture, en restituant sa voix, en faisant dialoguer les traces. Elle construit ainsi un récit où la mémoire individuelle et collective se nouent, où les morts parlent encore, où les vivants portent les disparus en les lisant, en les racontant, en les aimant à nouveau.
Lequel de nous portera l’autre ? propose une approche singulière de la Grande Guerre en articulant enquête sensible, poétique des objets et réflexion sur les formes de l’amour et de la fraternité. Violaine Lison offre un livre d’une rare densité, qui honore la complexité de Léonce Delaunoy sans jamais le figer en héros, qui rend hommage aux gestes de conservation des familles, qui interroge notre propre rapport aux archives et aux traces. En faisant du mouchoir-enveloppe le symbole même du geste de portage – objet qui contenait les carnets, refuge d’amour envoyé à Herman, matière même de la transmission –, l’autrice achève un parcours où porter l’autre signifie le faire accéder à une forme de présence renouvelée, jusqu’à nous.
Avec ce récit polyphonique d’une beauté sidérante, Violaine Lison fait entendre la voix d’un poète de vingt-cinq ans comme si elle traversait le siècle pour venir battre à nos tempes, et démontre que la littérature demeure le plus puissant des brancards pour porter les morts vers la lumière des vivants.