Pascal Ruter, Retour de lombarde, 24/09/2025, 256 pages, Hachette, 19,90 €
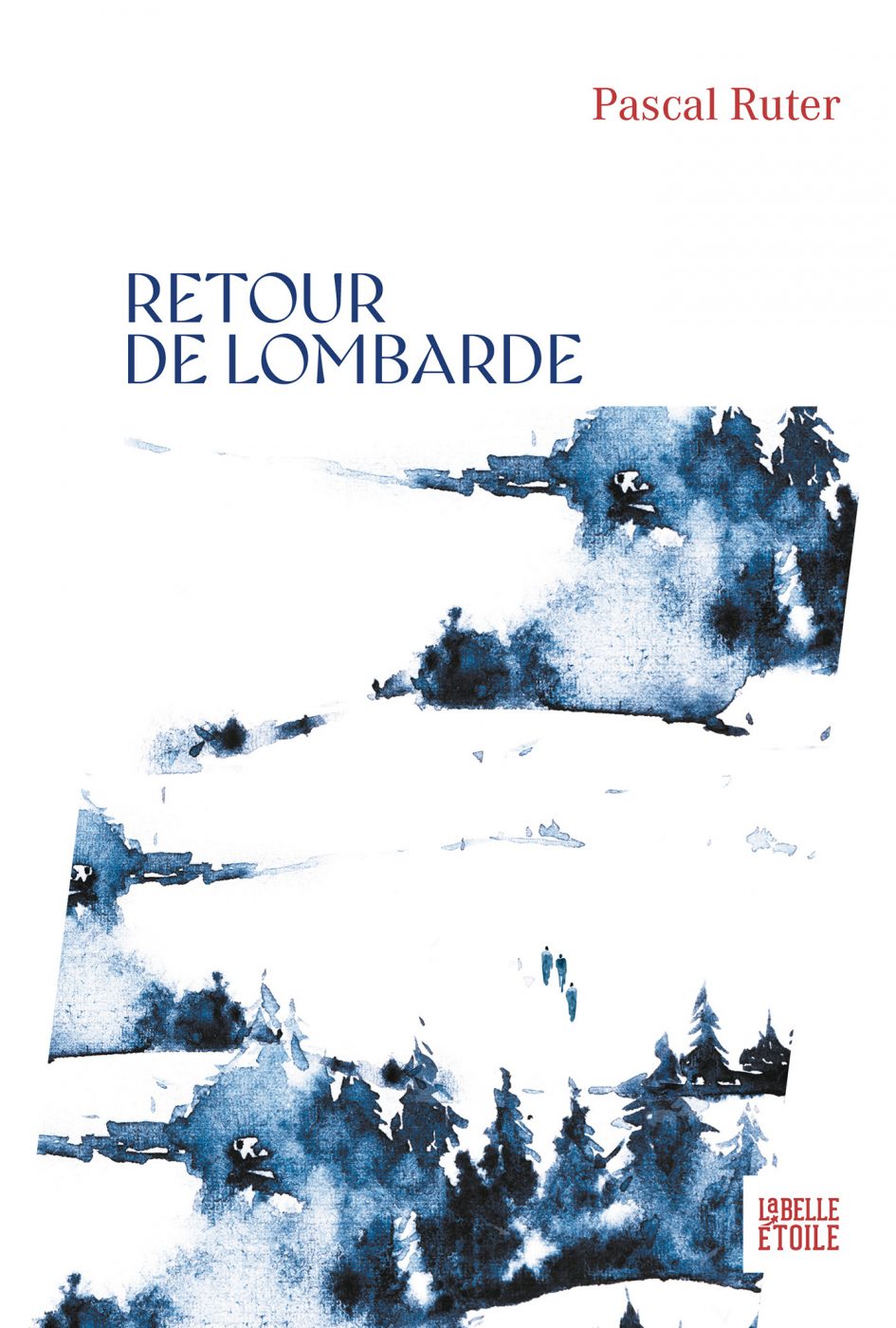
Découvrez notre Podcast sur cet ouvrage
Pascal Ruter, avec Retour de Lombarde, orchestre une terrible ascension vers les abîmes, un drame où le sacrifice, la filiation, la loyauté et la mémoire s’entrelacent dans le souffle glacial de la culpabilité, de la clandestinité morale, de l’exil et d’une justice réinventée. Au cœur d’une tempête de neige apocalyptique, trois figures ébranlées – un policier acculé par le désespoir, un jeune homme condamné par la justice et un ancien champion déchu hanté par ses fantômes – se hissent vers l’épave d’un avion écrasé. Ce qu’ils cherchent dans la carlingue éventrée, ce qu’ils fuient en eux-mêmes et ce qu’ils scelleront dans le blanc infini de la montagne, reconfigurera à jamais le paysage de leurs existences. Une fable aussi ténébreuse que lumineuse, où chaque pas dans la poudreuse se fait cheminement intérieur, chaque souffle une interrogation morale.
Trois destins brisés par l’absence, liés par la montagne
Le roman déploie d’emblée une atmosphère suffocante, nous plongeant sans préambule dans l’antichambre d’une tragédie. La narration s’ouvre sur le corps et l’esprit meurtris de l’inspecteur Klébert, veillant son fils Lucas dans une chambre d’hôpital surchauffée. La fièvre qui consume le père est le miroir de celle qui étreint l’enfant. Le temps est compté, et déjà, un pacte faustien est scellé. De ce point de non-retour naît une quête éperdue, celle d’un père prêt à sacrifier l’intégrité de sa vie pour préserver celle de son fils. Cette tension originelle forme la clé de voûte du récit, car elle convoque les deux autres figures de cette trinité fraternelle et fragile. Klébert, Yanis et Matéo, réunis par le hasard d’un drame céleste, sont avant tout liés par une commune expérience du manque : Klébert est privé d’un avenir pour son fils ; Yanis, jeune délinquant assigné à résidence, d’un passé dont il puisse s’honorer ; et Matéo, ancien prodige du ski consumé par la violence, du deuil apaisé d’un père légendaire disparu dans cette même montagne. De cette triple béance, le roman tisse les premiers fils d’une réflexion sur l’injustice fondamentale, la paternité orpheline et le vertige de la rédemption.
Quand la montagne devient théâtre du jugement intérieur
L’ascension vers le lieu du crash magnifie l’architecture d’un grand roman d’aventures, où la nature se fait protagoniste. La Lombarde, ce vent polaire et dévastateur, enveloppe les personnages et le lecteur dans un huis clos à ciel ouvert. Le froid mord, le brouillard efface les repères, et la montagne devient le théâtre physique et moral de leurs affrontements. Pascal Ruter inscrit le mouvement des corps dans la topographie de l’âme : la progression est lente et chaque dialogue, arraché à la morsure du vent, sonne comme une confession. La fameuse mallette, objet de toutes les convoitises, devient le réceptacle matériel de la transgression du père et catalyseur des vérités qui éclatent. Les échanges, denses et épurés, révèlent les fractures et les loyautés mouvantes. Le suspense qui en découle transcende la simple péripétie pour atteindre une dimension existentielle : survivront-ils à la tempête autant qu’à leurs propres démons ? Dans cet espace vertical, la montagne se fait territoire de catharsis. Pour Klébert, elle est le lieu de la dernière transgression ; pour Matéo, un pèlerinage sur les traces d’une avalanche ancienne qui a scellé son destin. La montagne devient ainsi ce révélateur implacable où la condition humaine, dans sa nudité la plus absolue, se confronte à elle-même.
L’après drame comme purgatoire : la grande réussite narrative de Pascal Ruter
Pourtant, cette ascension haletante constitue moins un aboutissement qu’un point de bascule. Une fois l’acte transgressif commis, la narration s’ouvre à ses conséquences différées et explore le temps long de la reconstruction. C’est ici que le roman déploie sa pleine maturité psychologique. L’adrénaline de la survie cède la place au poids du silence et au mensonge post-traumatique qui devient le véritable ciment des relations. C’est dans cette deuxième partie, tout en nuances et en ellipses, qu’émerge la figure tutélaire et blessée de Nadia, la sœur de Yanis. Elle incarne la permanence du réel face à l’exceptionnel du drame, et sa quête de vérité devient le cœur battant du récit. En portant sur ses épaules la charge du soupçon et de la mémoire familiale, elle donne au roman sa résonance la plus poignante, questionnant le droit au secret et la possibilité du pardon. Son personnage, loin d’être un simple adjuvant, agit comme le miroir moral où se reflètent les conséquences des actes des hommes. La géographie elle-même se transforme : la verticalité minérale des Alpes laisse place aux collines douces mais âpres de l’Ardèche. Ce village, havre de paix apparent, devient un purgatoire où le passé refuse de mourir, où les fantômes de la Lombarde continuent de souffler sur les braises d’une culpabilité partagée.
La conclusion du roman, ouverte et vibrante d’humanité, prolonge ces questionnements. Du cycle blanc de la neige à une paix possible, le récit se déploie vers une forme de résilience. Les combats menés par les personnages de Valentine Goby ou la quête de réparation morale qui traverse l’œuvre de Sorj Chalandon trouvent ici un écho singulier. Car en in fine, Retour de Lombarde nous raconte comment, au cœur du chaos, trois hommes trouvent le chemin, sinon d’une absolution, du moins d’une vérité partagée qui leur permet de redescendre. Pascal Ruter signe une œuvre dense et inoubliable, qui ébranle nos certitudes morales et nous rappelle que les plus hautes montagnes sont celles que l’on gravit à l’intérieur de soi, bien après que la tempête s’est apaisée.
















