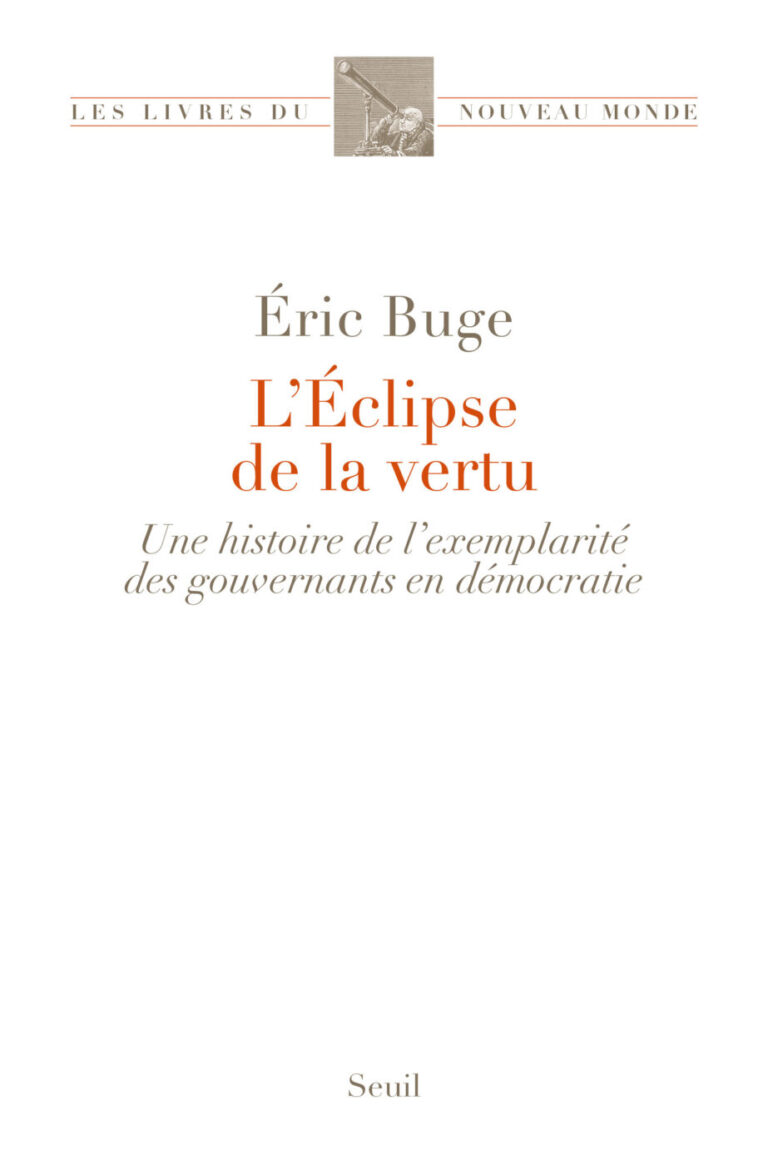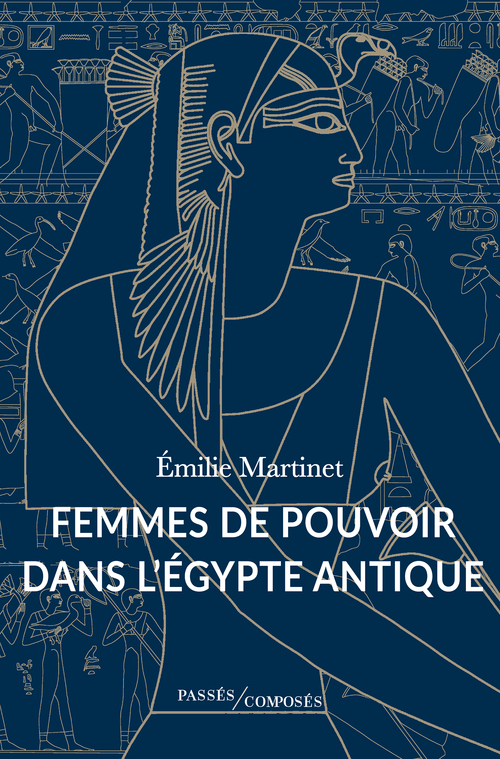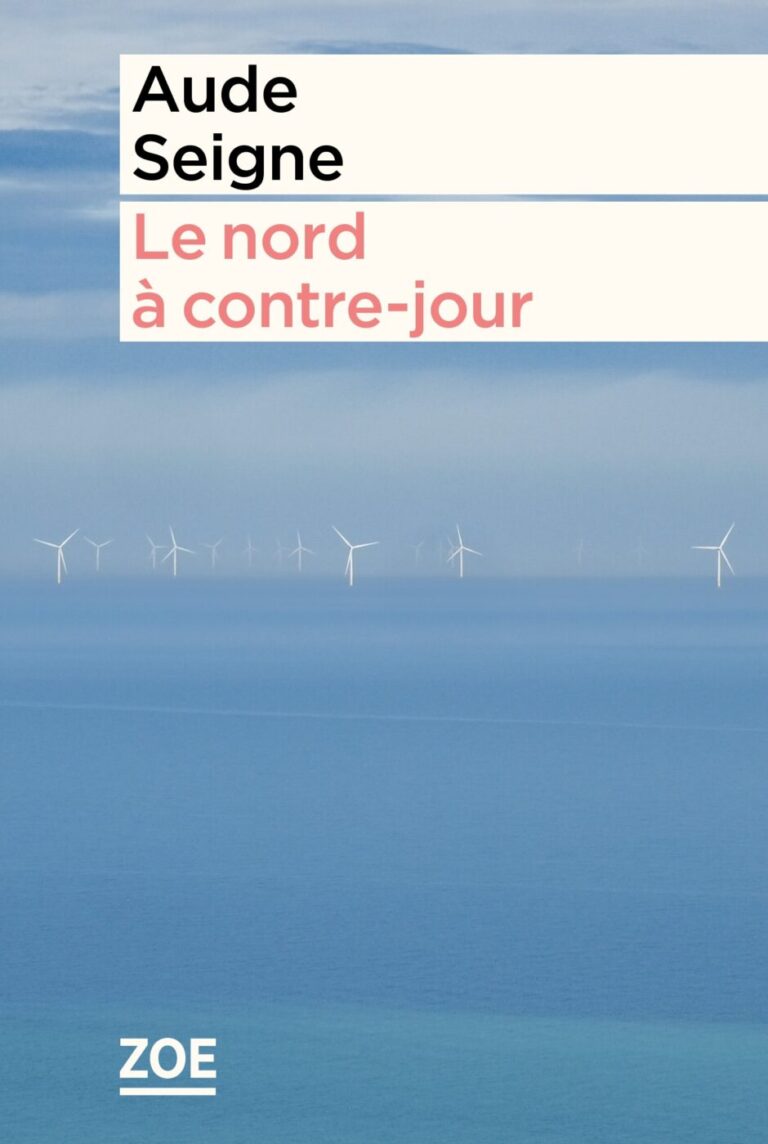Patrice Guirao, Trois noyaux d’abricot, Au vent des îles, 11/04/2025, 240 pages, 16€.
Plus que de simples rebuts devenus trésors ludiques, les trois noyaux d’abricot incarnent la quintessence d’une enfance en sursis au cœur du chaos algérien. Monnaie d’échange précieuse et cœur battant de rituels enfantins complexes, ces modestes “pignols” symbolisent la résistance de l’imaginaire et la tentative désespérée de mettre de l’ordre face à la brutalité du monde adulte. Ils sont le noyau dur d’une mémoire en construction, vestige tangible d’un paradis perdu avant même l’exil.
Dans la douceur amère des noyaux d’abricot : enfance et fracas colonial
Il y a des entrées en littérature qui vous saisissent par la nuque, vous plongent sans ménagement dans une densité olfactive et émotionnelle dont on ne ressort pas indemne. L’ouverture de Trois noyaux d’abricot de Patrice Guirao appartient à cette catégorie rare des commencements qui portent en eux la totalité du drame à venir, tout en préservant la délicatesse d’un regard unique : celui de Sauveur, enfant naviguant à vue dans les remous d’une Algérie française finissante. Le roman s’inaugure par une scène d’une force saisissante, celle de la veillée funèbre du grand-père, Pépé. Sauveur, du haut de ses cinq ans à peine fêtés, est sommé d’accomplir le rituel de l’adieu, d’embrasser une dernière fois ce visage aimé, désormais figé et étrangement odorant. « Il pue », lâche l’enfant avec une franchise désarmante, déclenchant une calbote de sa Tata Paulette pour lui inculquer le respect dû aux morts. Mais l’odeur tenace n’est pas celle de la décomposition ordinaire, exacerbée par la chaleur que les blocs de glace peinent à contenir ; c’est l’ail, ces gousses glissées dans la bouche du défunt selon une coutume ancestrale visant à masquer l’inéluctable travail du temps sur la chair. Dès ces premières pages, Patrice Guirao installe une atmosphère où le sacré côtoie le trivial, où la violence symbolique et physique (la gifle, la mort, l’odeur) est perçue à travers le prisme déformant et pourtant si lucide de l’enfance. Le geste imposé, l’incompréhension face aux codes adultes, la confrontation brutale à la matérialité de la mort et aux tentatives dérisoires de la conjurer par le rite : tout est déjà là, dans cette texture olfactive de l’ail qui, pour Sauveur, deviendra une empreinte mnésique indélébile, « comme un chewing-gum collé à ma mémoire ». La cellule familiale se dessine aussitôt, vibrante de tensions sourdes : la Maman qui pleure dans la cuisine, les oncles qui chuchotent avec véhémence le mot « Partir », sésame angoissant d’un avenir incertain, tandis que d’autres s’y refusent, ancrés dans une terre qui se dérobe pourtant sous leurs pieds. Sauveur, lui, sismographe sensible de ce chaos intime et collectif, enregistre les secousses sans toujours en déchiffrer l’épicentre, tissant sa propre carte du monde entre les figures tutélaires et les silences pesants.
Le temps des secrets et des sortilèges
Au fil du récit, le motif de la mort ne cesse de scander le temps, moins comme une finitude abrupte que comme un seuil poreux vers un ailleurs mystérieux, régi par des lois qui échappent à la rationalité adulte mais que l’imaginaire enfantin apprivoise à sa manière. La question lancinante de la moustache de Pépé – continuera-t-elle à pousser post-mortem ? – condense cette interrogation métaphysique naïve et profonde. Mémé, figure matriarcale rassurante et dépositaire des savoirs occultes, offre une réponse empreinte de réalisme magique : Pépé n’est pas vraiment mort, il vit désormais dans le cœur de Sauveur, et tant qu’il y demeurera, « elles continueront à pousser, ses moustaches ». C’est à l’enfant qu’il incombera, le moment venu, de les couper. Cette transmission symbolique installe la mémoire comme un territoire vivant, organique, dont l’entretien devient une responsabilité intime. Le roman excelle à dépeindre cet univers où les frontières entre le visible et l’invisible sont fluctuantes, où chaque recoin recèle un potentiel de mystère. Les portes interdites de la maison de Sidi Chami ouvrent sur des jardins où la réalité se teinte de fantastique : celui de M. Andréo, réputé potager mais recelant aux yeux de Sauveur des « tomates magiques orange », un « arbre à rubis » et des « pépites d’or », ingrédients probables des potions de Maljite, la sorcière domestique sourde et muette aux « incantations diaboliques ». M. Andréo lui-même, figure taciturne et travailleuse, s’adonne à des rituels dominicaux barbares – l’étêtage des canards dont il note scrupuleusement l’agonie – que l’enfant interprète comme des pactes passés avec des forces obscures pour protéger la maisonnée. Ces scènes, décrites avec force et précision à travers le regard de l’enfant qui ne juge pas mais observe et intègre, illustrent magnifiquement comment le trauma ambiant (la violence coloniale latente, la peur diffuse) se métabolise en un folklore personnel, peuplé de monstres (Jacquot, le monstre vert tapi derrière la porte) et de protecteurs ambigus. La superstition, les croyances populaires, le mélange syncrétique de pratiques catholiques et de rituels vernaculaires irriguent le quotidien, offrant des grilles de lecture alternatives à un monde dont la cohérence échappe.
Murmures de guerre et poétique de l’ordinaire
Omniprésente en filigrane, la guerre d’Algérie n’est jamais nommée explicitement dans sa dimension politique ou historique par le jeune narrateur, mais elle imprègne chaque interstice du réel. Elle est le fond sonore des discussions avortées des adultes, la cause des départs précipités ou empêchés, la raison pour laquelle l’école ferme, pour laquelle on manque de glace pour conserver les morts, pour laquelle des soldats patrouillent et des fusillades éclatent. Sauveur perçoit le conflit à travers ses manifestations les plus concrètes et sensorielles : la peur dans les yeux de sa mère, la tension de son père, les « youyous » stridents des Mauresques répondant aux bruits de casseroles des partisans de « l’Algérie française », créant une « guerre du bruit » terrifiante dans la nuit. La mort violente de Marin, poignardé et revenu agoniser à la maison en tenant ses entrailles, constitue une autre scène primitive d’une crudité insoutenable, gravant dans la rétine de l’enfant l’horreur absolue et l’incompréhensible résistance du corps. Plus tard, l’embuscade fatale de la tante Carmen et de Denise sur la route de Mascara, ou encore l’assassinat de M. Torez, le voisin, par une balle perdue, puis la mort tragique des Bergerot ou celle, abjecte, de Mimoun, lapidé sous les yeux des enfants de l’école, confirment cette banalisation de la violence extrême. La guerre s’infiltre dans le quotidien le plus intime, contaminant les jeux d’enfants – jouer aux « gendarmes et aux voleurs » devient problématique lorsque les « voleurs » sont assimilés à ceux qui ont tué Adrien Bergerot – et redéfinissant les relations sociales. L’écriture de Patrice Guirao parvient à rendre compte de ce climat de terreur diffuse et de désagrégation sans jamais tomber dans le didactisme ou le pathos. La force du roman réside dans cette capacité à incarner le drame historique dans les détails du vécu enfantin : les pignols (noyaux d’abricot) précieusement collectés pour des parties âprement disputées deviennent un trésor dérisoire face à la perte imminente ; les séances de dénoyautage des cerises avec Mémé, prétextes à des récits fondateurs où se mêlent Barbe-Bleue et épopées familiales, constituent des bulles de douceur menacées ; les règles complexes des jeux (calicot, pitchak, osselets) offrent un semblant d’ordre face au chaos grandissant. La langue elle-même, truffée d’expressions locales (“calbote”, “bourriquot“) et d’une syntaxe qui mime parfois les approximations enfantines, tout en conservant une grande tenue littéraire, contribue à cette authenticité poignante. La naïveté de Sauveur n’est jamais feinte ; elle est le révélateur involontaire de l’absurdité et de la tragédie que les adultes tentent de masquer ou de rationaliser.
L’écho persistant de la mémoire et l’universalité de l’adieu
Au-delà du contexte spécifique de la fin de l’Algérie française, Trois noyaux d’abricot touche à des questionnements universels sur la mémoire, la transmission et la construction de soi face à la perte. Le récit de Sauveur, fragmenté, sensoriel, pétri de malentendus et d’intuitions fulgurantes, illustre comment l’expérience traumatique s’inscrit dans le corps et l’esprit, bien avant que les mots ne puissent la cerner complètement. La thématique postcoloniale est abordée non pas frontalement, mais à travers les fissures du quotidien, les non-dits familiaux, les préjugés inconscients et les relations complexes entre les communautés (“les Arabes”, “les Mauresques”, les figures tutélaires comme M. Andréo ou M. Belaoui, les amis d’enfance aux noms arabes dont Sauveur ignore l’altérité initiale). Le roman interroge subtilement la manière dont l’Histoire s’invite dans l’intimité, fracture les identités et contraint à des départs qui sont autant d’arrachements. L’exil, bien que se profilant seulement à la fin pour Sauveur, est déjà à l’œuvre dans la dissolution du monde connu, dans la perte des repères et des êtres chers (Pépé, tonton Joseph, Tintin le chien, les amis, bientôt la terre natale elle-même). L’universalité du roman tient aussi à sa capacité à magnifier le détail trivial, à lui conférer une portée symbolique intense. Les trois noyaux d’abricot du titre, objets centraux des jeux d’enfants, deviennent emblématiques de cette enfance à la fois âpre et précieuse, de ce besoin vital de jeu et de rite pour conjurer l’angoisse, de cette monnaie d’échange dans un monde où tout semble sur le point de disparaître. La moustache de Pépé, les confitures de Mémé, les superstitions de Tata Léocadie, les odeurs (l’ail, la lavande du coiffeur, le vomi dans la cale du bateau), les textures, les couleurs : tout concourt à créer une expérience de lecture immersive, où le lecteur partage la perception à hauteur d’enfant de Sauveur. Le roman s’achève sur une note poignante, laissant Sauveur confronté à un nouvel acte de violence absurde que l’incipit de chaque chapitre dévoile, et à la solitude glacée d’un hall d’école en métropole. L’âge de raison coïncide douloureusement avec l’entrée dans l’âge de la mémoire, ce territoire où les fantômes familiaux et historiques ne cesseront de le hanter. La fin, ouverte, souligne l’incertitude du devenir mais ancre définitivement le personnage – et le lecteur avec lui – dans la conscience aiguë que le passé n’est jamais mort, qu’il est le terreau même sur lequel, tant bien que mal, il faudra continuer à grandir. Patrice Guirao signe ici une œuvre sensible et puissante, qui confirme, s’il en était besoin, que les récits d’enfance sont souvent les sismographes les plus aigus des grandes convulsions de l’Histoire.