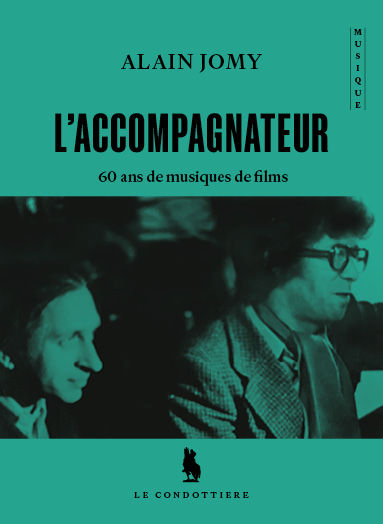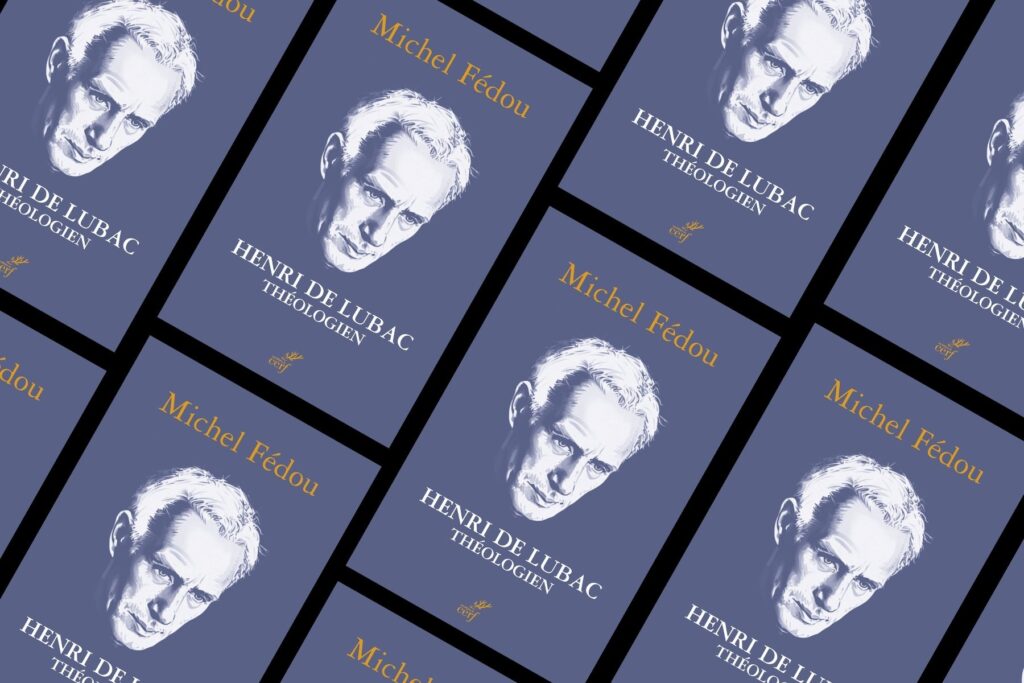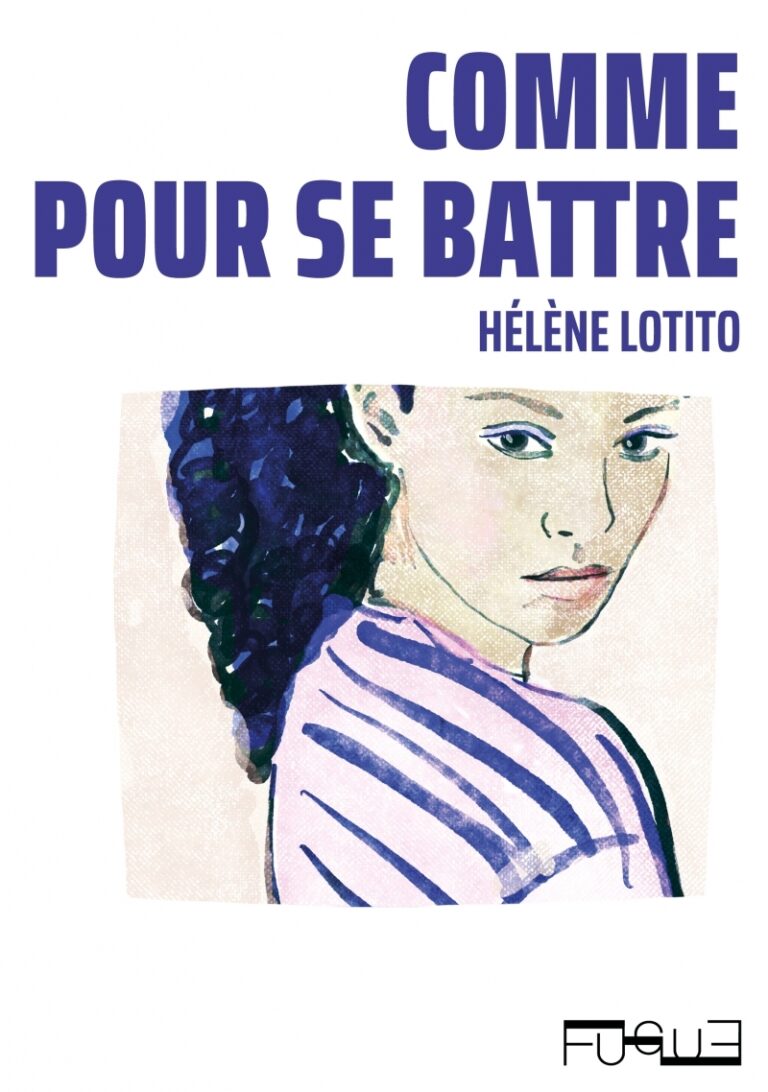Timothy Tackett, Jours de gloire et de tristesse, traduit de l’anglais (américain) par Serge Chassagne, Albin Michel, 26/02/2025, 256 pages, 22,90 €
Il est des livres qui ambitionnent de peindre la fresque d’une époque ; d’autres, plus rares, nous invitent à en sentir le pouls, à en palper la texture. Jours de gloire et de tristesse de Timothy Tackett appartient à cette seconde famille, celle des œuvres qui inventent une archéologie du sensible pour exhumer les fantômes du passé. En se glissant dans le sillage scripturaire d’un homme, Adrien Colson, avocat parisien arpentant sa vie et son siècle, l’historien américain déploie une manière de percevoir la Révolution française qui ancre le fracas de l’événement dans l’épaisseur d’une conscience ordinaire. Il s’agit là d’une exploration de la Révolution depuis le seuil, la croisée de fenêtre, la rumeur saisie au vol dans l’escalier d’un immeuble de la rue des Arcis. Une histoire murmurée plus que proclamée.
Ce geste historiographique s’inscrit avec une cohérence subtile dans le parcours de son auteur, l’historien américain Timothy Tackett, professeur émérite de l’Université de Californie, et l’une des figures majeures des études révolutionnaires contemporaines. Son œuvre entière retrace un lent et patient resserrement de la focale. De l’analyse prosopographique qui animait Par la volonté du peuple, où il cartographiait la conscience collective des députés de 1789, à l’étude de l’événement-choc dans Le roi s’enfuit, qui scrutait les ondes sismiques de la fuite à Varennes, jusqu’à la genèse des émotions politiques dans Anatomie de la Terreur, Timothy Tackett a toujours forgé une histoire qui privilégie la contingence, la psychologie et l’expérience vécue pour comprendre comment les hommes deviennent révolutionnaires. Jours de gloire et de tristesse apparaît ainsi comme l’aboutissement de cette quête : la micro-histoire devient l’instrument ultime pour saisir, à l’échelle la plus intime, les soubresauts d’une société en pleine métamorphose. L’historien façonne une histoire où les grandes forces sociales se réfractent dans le prisme d’une vie, celle d’un homme que rien ne destinait à devenir notre contemporain.
La matière première du livre, ce millier de lettres échangées par Adrien Colson avec son ami de province, Roch Lemaigre, structure un récit d’une formidable densité littéraire. La plume de Timothy Tackett épouse le rythme épistolaire de sa source, son souffle anxieux, ses élans d’enthousiasme. Elle ravive les routines du quotidien – les soucis financiers, les observations météorologiques, les petits services rendus – pour mieux mettre en relief leur transfiguration sous le choc des événements. Le style, tout en précision évocatrice, explore la porosité entre le banal et l’extraordinaire, le privé et le politique. Il en résulte une narration à hauteur d’homme, une caméra sensible portée à l’épaule d’un témoin qui, comme ses contemporains, avance à tâtons dans un monde dont les repères s’effondrent. L’auteur nous fait partager la plus fondamentale des expériences révolutionnaires : celle de vivre un futur totalement ouvert, vibrant de toutes les promesses et hanté par toutes les menaces.
C’est cette oscillation perpétuelle, inscrite dans le titre même, que le livre explore avec une acuité particulière. Les jours de gloire sont ceux de l’exaltation collective : l’ivresse de fraternité lors de la Fête de la Fédération, la joie patriotique qui accompagne la création de la garde nationale, ou cet optimisme fiévreux de 1789, quand Adrien Colson sent advenir une ère inouïe : “La France, écrivait-il, est à la veille du sort le plus heureux ou le plus malheureux qui puisse jamais arriver”. Les jours de tristesse, à l’inverse, disent la peur viscérale qui étreint Paris. Le livre offre une anthropologie saisissante de la rumeur comme force politique. Il met en lumière comment le complot, qu’il soit aristocratique ou frumentaire, devient la grille de lecture d’un monde opaque, une manière de donner un visage à l’angoisse et sens à l’incompréhensible. La peur, démontre Timothy Tackett, est une matrice d’engagement, un puissant moteur de la radicalisation politique, éclairant d’une lumière crue les mécanismes intemporels de la désinformation.
À travers le regard d’Adrien Colson, le Paris révolutionnaire prend corps comme une entité vivante, une topographie sensible et sonore. La rue des Arcis, ce quartier populaire et dense de la rive droite, devient l’épicentre d’où se diffuse le souffle de l’époque. On y entend les clameurs, le son du tocsin, le pas des gardes nationaux, les annonces criées par les hérauts royaux. L’ouvrage ravive le tissu social de la capitale, ces sociabilités de voisinage où les nouvelles s’échangent dans la boutique du fabricant de chandelles, M. Ladoubé, le propriétaire de Colson. L’avocat lui-même incarne une position sociale intermédiaire fascinante : fils de tanneur, au service de la noblesse d’épée, mais vivant au milieu des artisans, il est une membrane sensible qui enregistre les tensions et les aspirations des différentes strates de la société.
La trajectoire d’Adrien Colson permet également d’éclairer sous un jour neuf la mutation profonde de la culture religieuse. Tackett montre comment ce catholique dévot, d’abord hostile aux réformes, finit par embrasser l’idée d’une Église régénérée, primitive et patriotique. Le soutien qu’il accorde à la Constitution civile du clergé révèle la possibilité d’une synthèse entre la foi et l’idéal révolutionnaire. En retour, son désarroi face à la vague de déchristianisation de l’an II offre une clé de lecture puissante pour comprendre la fracture qui s’opère alors au sein du peuple parisien. Ce récit est aussi une méditation sur la violence. L’approbation initiale de l’avocat face aux lynchages de l’été 1789, puis sa répulsion horrifiée devant les massacres de Septembre, nous plongent au cœur des dilemmes moraux d’un homme confronté à la brutalité de la politique.
Jours de gloire et de tristesse résonne d’une portée qui dépasse son seul objet. En restituant la Révolution comme une expérience totale – intellectuelle, affective, sensorielle –, le livre pose des questions universelles sur la manière dont l’individu se façonne au contact de l’événement. Comment se politise-t-on ? Comment la peur et l’espoir transforment-ils une vision du monde ? En choisissant un “Parisien ordinaire”, Timothy Tackett nous révèle peut-être la plus profonde vérité de la Révolution : l’extraordinaire peut surgir de n’importe où, de la plume d’un homme sans importance, dont la voix, portée par un miracle archivistique, vient nous rappeler que l’histoire s’écrit toujours, d’abord, à la première personne. Et que chaque grande transformation collective est avant tout une somme d’intimes révolutions.