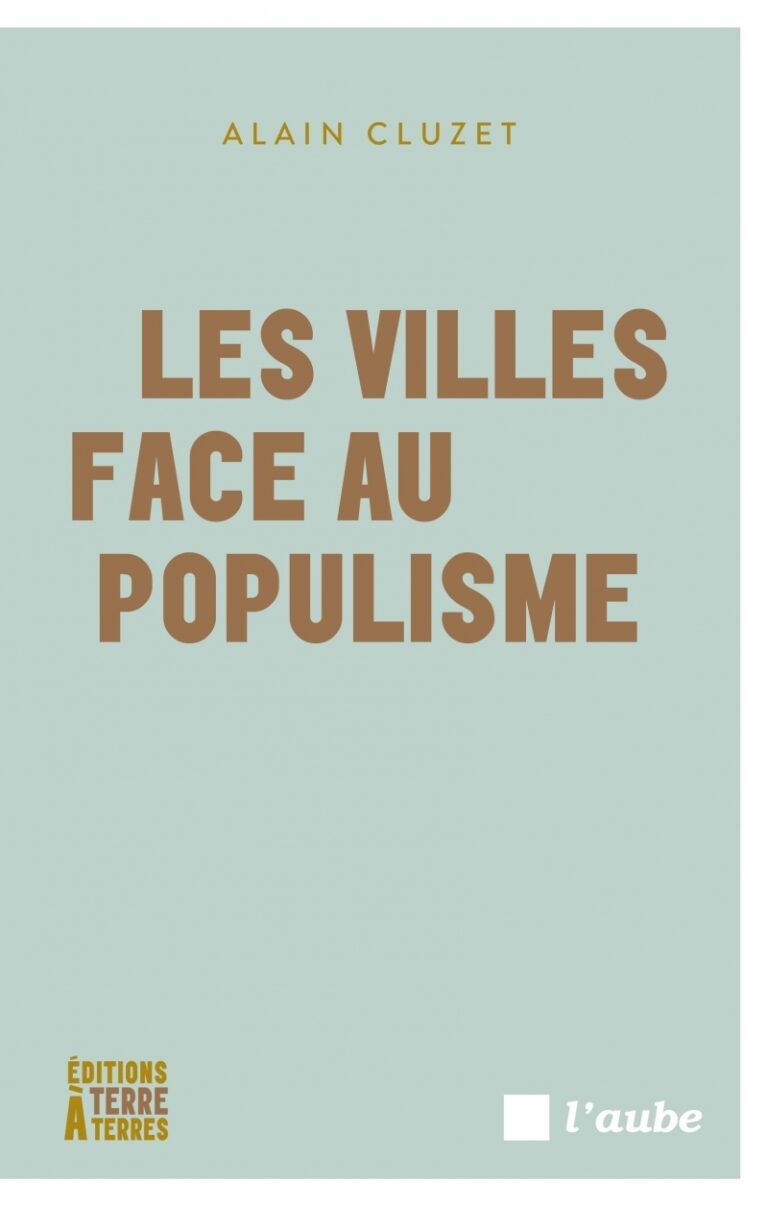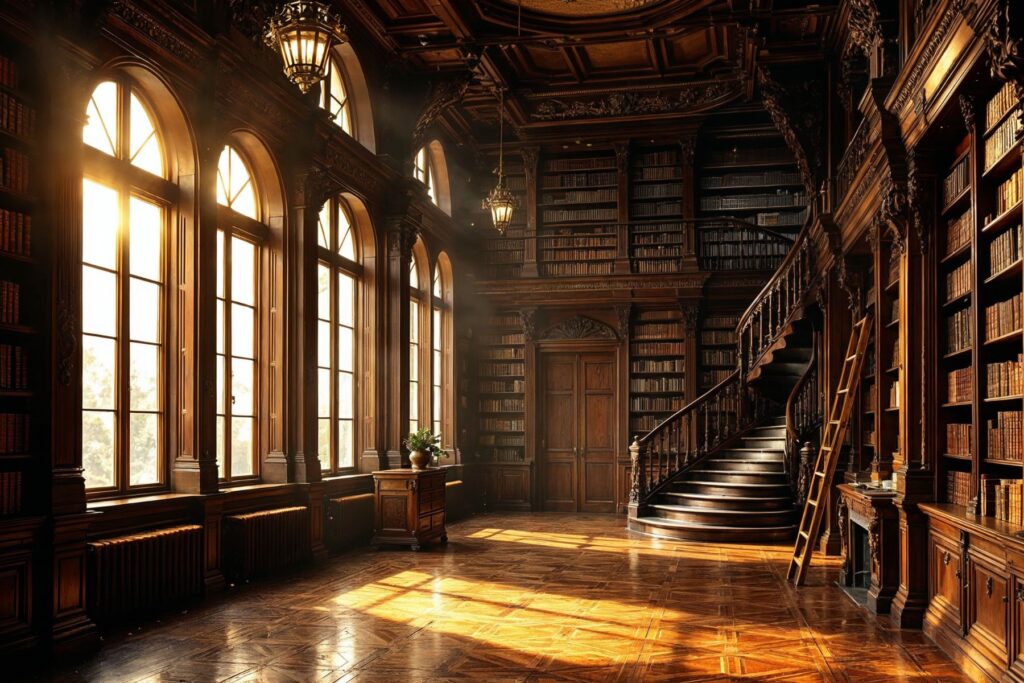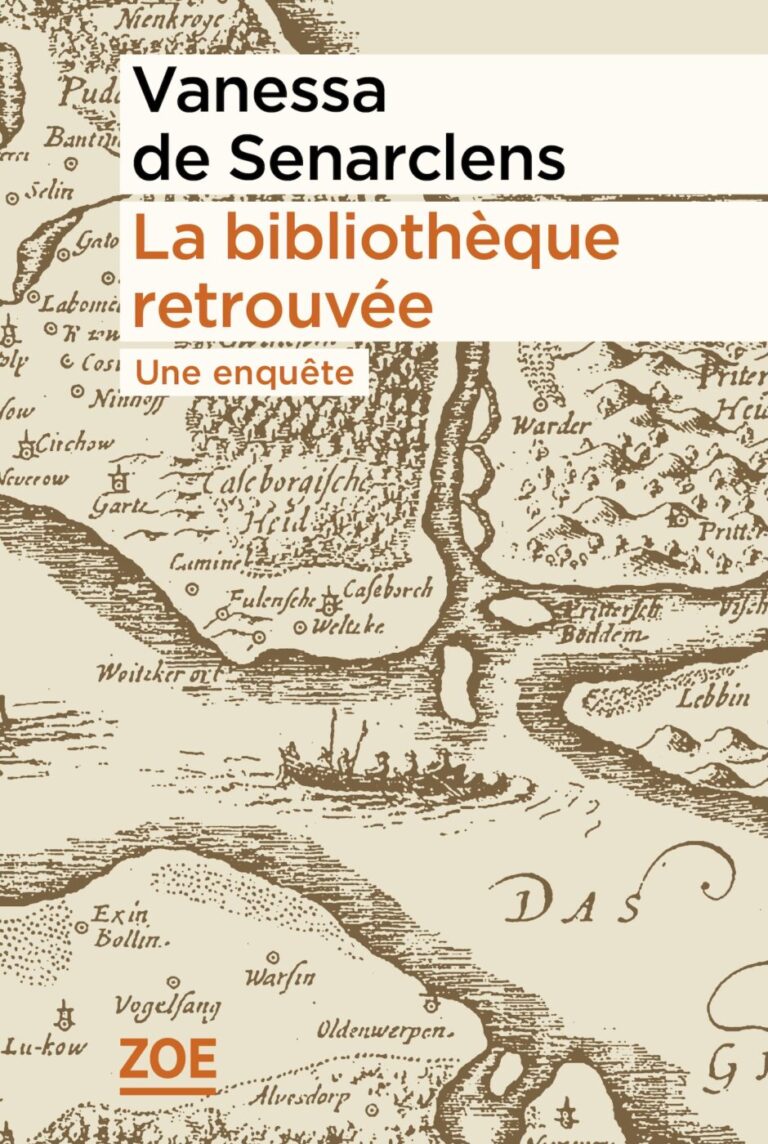Ezio Sinigaglia, Les Aventures érotiques de Warum et Saint-Aram, traduit de l’italien par Paolo Bellomo et Cécile Raulet, Emmanuelle Collas, 10/01/2025, 465 pages, 28€
Ezio Sinigaglia, architecte patient des labyrinthes intérieurs et orfèvre d’une prose où chaque mot pèse son poids de silence et de désir, nous plonge avec Les aventures érotiques de Warum & Saint-Aram au cœur d’une énigme relationnelle. Dans l’atmosphère confinée et observatrice d’une maison de campagne peuplée d’amis, se déploie le lien unique, intense et paradoxal, entre le narrateur, Warum, esprit analytique et cœur captif, et l’insaisissable Fifí, figure solaire marquée par l’ambivalence du “fifty-fifty”. Partageant une intimité de chaque instant, jusqu’au lit commun, leur relation vibre d’une tension érotique où l’accomplissement physique reste une promesse suspendue, une absence vertigineuse autour de laquelle le récit tisse sa toile subtile. Ezio Sinigaglia nous invite moins à une chronique amoureuse qu’à une exploration radicale des géographies du désir, là où le langage tente de cerner l’incomplétude et où l’érotisme le plus puissant affleure peut-être, justement, dans ce qui est retenu.
Le code fifty-fifty
Le roman nous introduit in medias res dans l’orbe d’un duo dont la dynamique singulière constitue le cœur vibrant du récit : le narrateur, Aram, intellectuel trentenaire dont l’acuité analytique n’a d’égale que la vulnérabilité amoureuse, surnommé Warum (le questionneur) par son ami ; et cet ami lui-même, Fifí (Stefano), figure solaire, séductrice et fondamentalement ambivalente, marquée par Aram du sceau indélébile du “Fifty-fifty”. Leur cohabitation, dans la vaste demeure campagnarde de l’ami compositeur Stocky – personnage lui-même complexe, observateur fasciné et vecteur involontaire de tension –, est le théâtre d’une intimité paradoxale. Ils partagent une chambre, un lit, une proximité de chaque instant, tissant depuis plus de trois ans un lien d’une densité intellectuelle et émotionnelle extrême. Pourtant, cette contiguïté charnelle demeure un seuil inviolé, une tension érotique maintenue dans un équilibre précaire. Fifí incarne cette oscillation : « Beaucoup de choses en lui sont fifty-fifty. D’où, justement, Fifí. Sobriquet-présage. […] Il répondait oui et non, oui et non, à presque tout. Moitié-moitié ». L’attirance de Warum pour Fifí est totale, exclusive – une “hérésie monofifite”, comme il la nomme avec une lucidité teintée d’autodérision –, mais elle bute contre cette insaisissable dualité qui est l’essence même de Fifí.
Le ton adopté par le narrateur est d’emblée complexe, mêlant l’analyse des micro-mouvements affectifs à l’élan lyrique du désir, la tendresse à l’ironie mordante. Chaque geste de Fifí est scruté, interprété, chaque silence chargé de significations potentielles. La langue du narrateur devient un instrument d’auscultation, tentant de cerner les contours fuyants de l’autre et, par là même, de son propre désir. C’est une chronique de l’inaccomplissement, mais une chronique vibrante, où la suspension de l’acte physique ouvre un espace infini à la spéculation, au fantasme, à l’élaboration langagière.
L’incomplétude comme espace érotique
La tension qui aimante et repousse tour à tour Warum et Fifí constitue le véritable carburant narratif. Ezio Sinigaglia module cette dynamique avec une précision rythmique remarquable, son écriture épousant les flux et reflux du désir, les atermoiements, les silences lourds et les soudaines accélérations du cœur. Les dialogues, qu’ils soient directs, rapportés ou fantasmés par le narrateur, forment un ballet subtil où chaque mot pèse, chaque inflexion trahit ou dissimule. C’est ici que se déploie pleinement l’érotisme langagier, concept clé pour pénétrer l’univers du roman. Faute de pouvoir se toucher physiquement de la manière conventionnelle, Warum et Fifí investissent le langage d’une charge érotique intense. Les sobriquets inventés par Warum (Fifí, Fefano, Phephen…), détestés ou acceptés par Fifí selon les pourcentages fluctuants de son humeur, les devinettes échangées, les conversations nocturnes murmurées dans l’intimité confinée – que ce soit sous la tente exiguë du Conero lors de vacances fondatrices ou dans la mansarde chez Stocky –, tout cela constitue une forme de contact, une tentative de fusion par les mots, mais qui bute inlassablement sur l’altérité irréductible de l’autre, sur l’impossibilité d’une transparence totale. Le langage, dès lors, est à la fois le lieu de l’union rêvée et le symptôme de sa propre limite, la métaphore d’une fusion désirée mais structurellement impossible.
Les figures secondaires qui peuplent cet univers clos agissent comme autant de miroirs déformants ou de catalyseurs. Stocky/Merlot, le compositeur ami, n’est pas un simple témoin passif ; son regard insistant, sa fascination teintée de “malsain” pour le couple atypique que forment Warum et Fifí, et sa musique qui semble parfois offrir une exégèse cryptique de leurs relations, en font un tiers essentiel, celui par qui le scandale (ou le soupçon) arrive, celui qui renvoie au duo l’image de son étrangeté. Les figures des anciennes amantes de Warum – la rationnelle et clairvoyante Dalloway, qui diagnostique avec une froide précision la nature double de Fifí et l’impasse affective dans laquelle s’engage Warum ; la dévouée et solaire Ramsay, figure d’un amour peut-être plus simple et accompli, mais quittée ; ou encore le jeune et tendre Aladin, sacrifié lui aussi à “l‘hérésie monofifite” – dessinent les contours des possibles refusés, soulignant la radicalité et peut-être l’aveuglement du choix exclusif de Warum. L’irruption tardive mais significative de Chofí (l’ancien chauffeur Allumette), double troublant et fantomatique de Fifí venu du passé militaire du narrateur, introduit une complexité nouvelle, un écho inattendu qui vient perturber la dyade centrale et interroger la singularité prétendue de la relation avec Fifí.
Au cœur du récit se trouve aussi la tentative, ou la nostalgie, d’une forme d’amour pur, une utopie relationnelle qui chercherait à s’affranchir des conventions sociales et des injonctions à la consommation. Le séjour au Conero, relaté en flash-back, apparaît comme l’acmé de cette tentative : sept nuits passées dans une promiscuité charnelle suffocante mais chaste, un huis clos où l’intimité culmine dans la parole et le “Chérir” – ce verbe inventé par Fifí, oscillant entre tendresse et retenue. C’est une forme d’éden précaire, une parenthèse hors du temps et des normes, peut-être l’incarnation d’une adolescence affective prolongée où les jeux de pouvoir subtils (qui domine la conversation, qui cède au sommeil ?) et les rites inventés (comme la “lutte” nocturne, ersatz ludique et ambigu de l’acte sexuel) structurent la relation à défaut d’une résolution conventionnelle. Les différentes géographies sentimentales du roman – l’espace clos et observé de la maison de Stocky, l’urbanité nocturne et complice des débuts, le refuge estival et utopique du Conero, la poudrière isolée du passé militaire – fonctionnent comme autant de théâtres où se rejouent, avec des éclairages différents, les variations de cette quête de synchronie impossible.
Une esthétique du manque
Au-delà de sa singularité narrative, Les aventures érotiques de Warum & Saint-Aram entre en résonance profonde avec certaines interrogations contemporaines. La fluidité constitutive de Fifí, son refus des catégorisations simples, l’exploration par le narrateur d’une forme de désir qui transcende les schémas habituels et valorise la tension sur la résolution, tout cela dialogue avec les débats actuels sur la plasticité des identités et des attirances, sur le rejet des normes binaires et des parcours amoureux prédéfinis. Sans être un manifeste explicite, le roman explore avec une subtilité déconcertante la possibilité d’une relation “autre”, fondée sur une complicité intellectuelle et une fascination mutuelle qui ne nécessitent pas, ou pas encore, la validation par l’acte sexuel conventionnel.
C’est sans doute dans sa gestion magistrale du non-dit et de l’inaccompli que réside la force la plus troublante du texte. Le roman se construit sur une esthétique du manque, où ce qui est retenu, suggéré, esquivé, possède une charge érotique et significative bien plus intense que ce qui est explicitement montré ou vécu. La non-consommation physique n’est pas une simple péripétie, mais le cœur même du dispositif narratif et philosophique. Elle crée un vide fertile, un espace de résonance où le désir peut s’amplifier, se réfléchir, se complexifier à travers le prisme du langage et de l’imagination. La langue devient ce corps fantasmatique, lieu d’une jouissance perpétuellement différée, vibrante de potentialités. Cet érotisme suspendu, qui privilégie l’attente sur l’assouvissement, la tension sur la détente, confère au roman sa texture unique, à la fois légère et dense, ludique et mélancolique.
Le corps lui-même est traité moins comme un objet de désir direct que comme un champ de métaphores, un sismographe des états intérieurs. La description minutieuse et souvent poétique de Fifí par Warum – ses yeux comparés à une “moule en négatif“, sa peau “de plus en plus dorée” qui interagit avec les saisons, sa “rougeur […] d’eau, pas de feu” – contribue à forger une présence charnelle intense mais toujours légèrement idéalisée, filtrée par la subjectivité amoureuse. Inversement, le corps de Warum est le lieu où s’inscrivent physiquement les effets de cette tension : l’insomnie, la nécessité de “rire de tout, afin de pouvoir survivre”, le désir contenu qui lui pèse.
L’œuvre d’Ezio Sinigaglia propose une méditation subtile sur la nature même du désir, appréhendé dans sa dimension fondamentalement paradoxale : une force qui tend vers l’autre, vers la fusion, mais qui ne peut exister et s’intensifier que dans la reconnaissance de l’écart, de l’incomplétude native. C’est un roman qui invite moins à trouver des réponses qu’à habiter la question, à éprouver la richesse ambiguë des liens qui se tissent dans la suspension. Une lecture qui, par sa finesse psychologique, son élégance stylistique et l’originalité de son propos, laisse une empreinte durable, une invitation à reconsidérer les géographies intimes et les langages secrets de nos propres désirs.