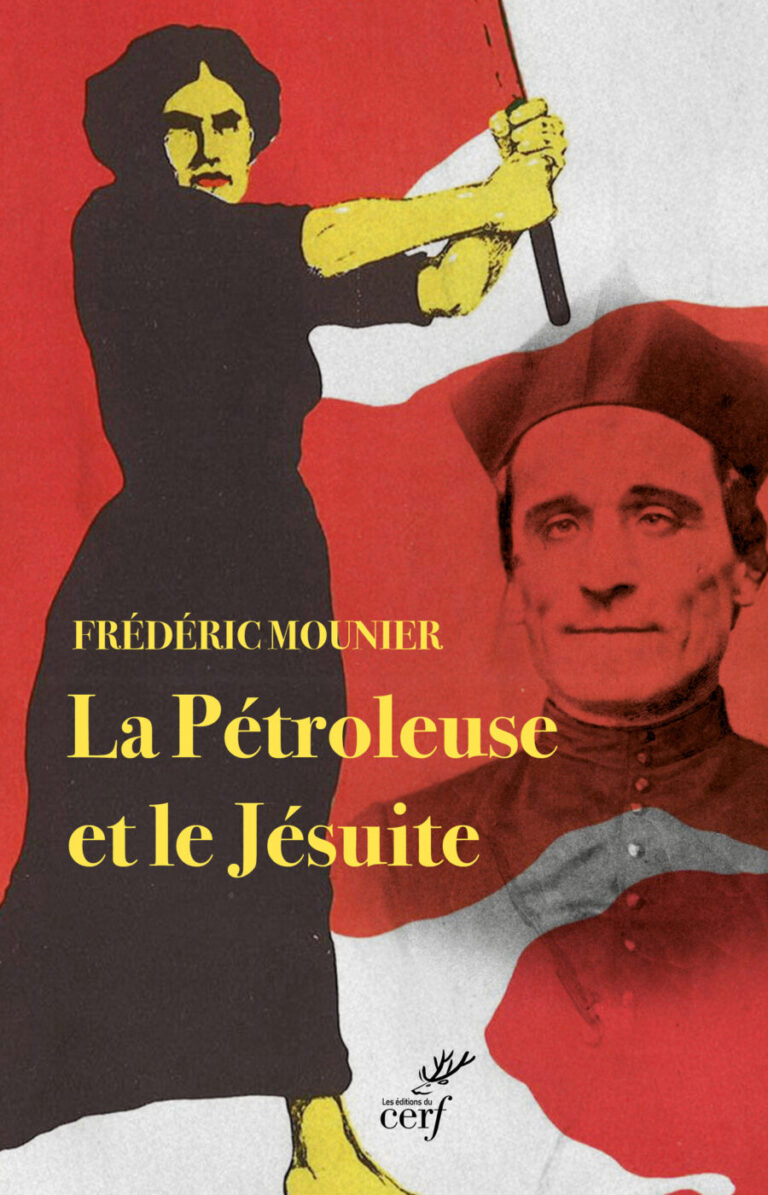Alexandre Maujean, Le goût de la solitude, Mercure de France, 13/03/2025, 128 pages, 9,50 €
Lire Le goût de la solitude, c’est accepter une traversée — un cheminement narratif guidé par les textes mais aussi par une progression thématique fluide. Alexandre Maujean compose une partition en quatre mouvements : nature, isolement, exil intérieur, résistance. Cette lecture suivra donc ce fil narratif, en l’éclairant par les résonances que chaque texte fait vibrer, aujourd’hui encore, dans nos corps solitaires.
Ce que la solitude nous fait entendre
L’anthologie qu’Alexandre Maujean nous propose s’ouvre sur une interrogation qui hante la conscience occidentale, une aporie existentielle que son introduction formule avec une clarté désarmante : ce recueil, dit-il, aurait pu s’intituler Le Dégoût de la solitude. Ce premier constat, en apparence simple, déploie la dialectique fondatrice qui innerve l’ensemble de l’ouvrage. La solitude, ce mot unique pour désigner, en langue française, ce que les Anglo-Saxons distinguent par loneliness et aloneness, est tout à la fois le poison et le remède, l’enfer de l’esseulement et le paradis de la retraite choisie. C’est la mise en garde biblique – « Il n’est pas bon que l’homme soit seul » – face à la sentence implacable de Schopenhauer : « On n’a d’autres choix dans ce monde qu’entre la solitude et la vulgarité ». Ce balancement, cette tension irrésolue, constitue la véritable porte d’entrée de ce volume, qui ne cherche pas à trancher mais à explorer les nuances infinies de cette expérience humaine fondamentale. Alexandre Maujean, en orchestrateur avisé, nous fait d’abord pénétrer dans le refuge premier, la matrice originelle de la retraite : la nature. Chez Jean-Jacques Rousseau, l’île Saint-Pierre n’est pas qu’une retraite géographique, mais la conquête d’un territoire où le moi peut enfin coïncider avec lui-même, où le monde extérieur se réduit à une circonférence bienveillante et choisie. Rousseau, se sentant peut-être unique dans son aspiration — « Je ne puis croire être le seul qui ait un goût si naturel » —, y trouve un asile contre la société corruptrice, une solitude qui n’est pas retranchement mais expansion de l’être au contact de l’élémentaire. Avec Robert Louis Stevenson, l’expérience devient plus âpre, plus charnelle. Sa nuit à la belle étoile dans le Gévaudan est une immersion totale, un abandon du corps aux éléments où le sommeil lui-même est une négociation avec le vent et la pluie. Blotti « profondément au chaud de ma peau de mouton », il découvre une forme de solitude qui confine à la communion primale, une régression heureuse loin des affres de la conscience civilisée. Plus près de nous, Paolo Rumiz, depuis son phare anonyme, transforme le retrait en poste d’observation. Sa solitude n’est pas une fuite du monde, mais une manière de le capter différemment, de percevoir, dans le silence de son île, le vacarme du Maghreb, des Balkans, de l’Histoire en marche. La solitude devient ici un instrument acoustique, un sismographe de l’âme qui enregistre les soubresauts d’une humanité dont il s’est physiquement éloigné pour mieux en sentir le pouls.
Seul au monde, seul en soi
De cette première exploration des espaces naturels comme théâtres de la solitude, le recueil glisse subtilement vers des territoires plus intérieurs, là où l’isolement n’est plus une évasion mais une condition subie, un enfermement qui peut être physique autant que mental. Le passage du « Retour à la nature » à « L’Isolement » marque une descente dans les cercles d’une solitude plus sombre, où le récit devient le seul fil d’Ariane pour ne pas sombrer. Daniel Defoe nous livre, avec Robinson Crusoé, l’archétype de l’exil involontaire. Son île du désespoir est d’abord le lieu d’un dénuement absolu, avant de se muer en un espace de réinvention de soi par le travail, la discipline et la foi. La solitude, ici, est une épreuve initiatique, une traversée du vide métaphysique qui trouve sa résolution dans un dialogue retrouvé, non avec les hommes, mais avec une transcendance incarnée par la lecture de la Bible : « Jamais, jamais, je ne te délaisserai ». L’île devient un monastère, la survie une ascèse. Chez Victor Hugo, l’isolement est plus brutalement psychologique. Le condamné à mort, dont on ne connaît ni le nom ni le crime, est emmuré vivant dans l’obsession de sa propre fin. La cellule du cachot n’est que la matérialisation d’une prison mentale : « Je n’ai plus qu’une pensée, qu’une conviction, qu’une certitude : condamné à mort ! ». Sa solitude est un dialogue stérile avec l’inéluctable, une conversation assourdissante où la conscience ne fait que répéter son propre anéantissement. Georges Rodenbach, dans Bruges-la-Morte, pousse cette logique jusqu’à son terme en faisant de la géographie urbaine le miroir direct de l’âme endeuillée. La ville entière devient une métaphore de la solitude du veuf Hugues Viane ; ses canaux sont les artères froides d’un corps sans vie, ses quais le tombeau d’un amour perdu. « À l’épouse morte devait correspondre une ville morte », écrit-il, scellant ainsi l’union tragique entre le paysage extérieur et le désert intérieur.
Cette exploration de l’isolement trouve ensuite son incarnation la plus viscérale dans le corps lui-même, ce premier territoire de notre solitude. L’anthologie révèle comment le corps devient le réceptacle, la scène ou l’instrument de cette confrontation à soi. Chez Kafka, dans Le Procès, la solitude est paradoxalement une expérience de la foule. Joseph K. est seul parce qu’il est scruté, jugé, cerné par un système absurde dont il ne comprend ni les codes ni les intentions. Son corps est pris dans une chorégraphie hostile, une persécution muette qui l’isole au milieu des autres. Sa révolte solitaire face au tribunal – « vous êtes tous des fonctionnaires, vous êtes la clique de corrompus que j’ai attaquée » – n’est que l’éclat désespéré d’un homme dont l’intégrité physique et morale est déjà violée. À l’extrême opposé, l’Oblomov de Gontcharov fait de l’inertie de son corps une forme de résistance passive. Son divan est un royaume, son inaction un manifeste contre l’agitation vaine du monde. Sa solitude n’est pas une souffrance mais un art de vivre, une paresse élevée au rang de philosophie. Enfin, Philip Roth, dans une veine truculente et subversive, fait du corps adolescent d’Alexander Portnoy le théâtre d’une solitude obsessionnelle et libératrice. Enfermé dans la salle de bains pour « expédier mon foutre soit dans la cuvette des cabinets soit au milieu des affaires sales dans le panier à linge », il découvre l’espace secret où le corps peut s’affranchir des interdits familiaux et sociaux. Sa solitude est une frénésie charnelle, un rituel à la fois grotesque et nécessaire pour construire une identité à l’abri du regard des autres.
Refuser le monde pour en faire advenir un autre
En nous guidant à travers ces textes, Alexandre Maujean tisse une toile de résonances qui nous parle de notre propre aliénation contemporaine. Comment ne pas voir dans le monologue du narrateur de Maupassant, arpentant les Champs-Élysées en se sachant irrémédiablement seul au milieu de la foule – « nous sommes éternellement seuls, et tous nos efforts, tous nos actes ne tendent qu’à fuir cette solitude » –, une préfiguration de notre existence hyper-connectée mais atomisée ? Les figures de l’exil intérieur qui peuplent la troisième partie de l’ouvrage offrent des clés pour comprendre et peut-être même combattre ce sentiment. La solitude n’est plus seulement un état, elle devient une posture, une promesse de réinvention. Pour Marguerite Duras, l’écriture est indissociable d’un retrait physique et mental. La maison de Neauphle-le-Château est l’espace sanctuarisé où la création peut advenir. Sa solitude est une condition de possibilité, une discipline consentie qui lui permet de faire naître ses livres : « C’est dans une maison qu’on est seul. […] Et que c’est seulement dans cette maison que je suis seule. Pour écrire. » La solitude, pour Duras, n’est pas vide ; elle est peuplée par les voix à venir. Pour Virginia Woolf, cette condition devient un enjeu politique et économique. La « chambre à soi » qu’elle réclame est l’espace matériel et symbolique nécessaire à l’émancipation créatrice des femmes. La solitude est ici un droit à conquérir sur une société patriarcale qui a historiquement confiné les femmes à l’espace domestique et à la dépendance. Si Shakespeare a eu une sœur, elle n’a rien écrit, car il lui manquait les conditions de cette solitude productive : « si nous possédons cinq cents livres de rente et un lieu à nous », alors la poétesse pourra naître.
L’anthologie s’achève sur une note de résistance, montrant comment le retrait peut être un acte de défiance. Que ce soit Molière fuyant l’hypocrisie des hommes, Hugo proscrit défiant la tyrannie, ou Kafka objectant à l’absurdité du système, la solitude devient le dernier rempart de l’intégrité. Georges Perec, dans Un homme qui dort, pousse cette logique à son paroxysme. Son personnage, en choisissant l’indifférence et le silence, accomplit un acte de retrait radical, un refus silencieux de participer au jeu social. C’est peut-être la forme la plus pure et la plus troublante de solitude : non pas celle de l’écrivain qui se retire pour créer, mais celle de l’homme qui se retire pour cesser d’être. Le goût de la solitude n’est donc pas un traité, encore moins une compilation exhaustive. C’est une invitation à écouter la polyphonie d’une expérience qui nous constitue tous. Alexandre Maujean ne donne aucune réponse, mais il agence les questions avec une intelligence qui nous pousse à trouver, dans le silence de notre lecture, notre propre cheminement. L’ouvrage refermé, demeure cette sensation tenace que la solitude, si elle est le lieu de notre plus grande vulnérabilité, est aussi celui de notre puissance la plus secrète, l’espace où, peut-être, nous pouvons enfin nous entendre penser.