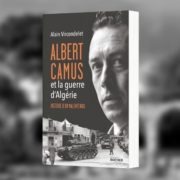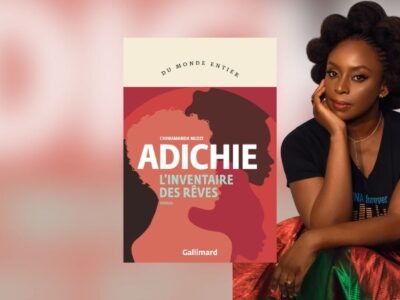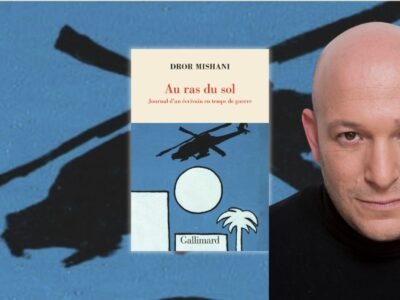Roman culinaire dédié à l’Iran, “Une soupe à la grenade” raconte l’histoire de trois sœurs réfugiées, Marjan, Bahran et Layla, qui ont fui un pays gouverné par les ayatollahs pour ouvrir un restaurant, le Babylon Café, dans une petite bourgade du comté de Mayo. De caractères différents, les trois jeunes femmes vont devoir s’adapter à leur nouvelle vie, et affronter l’hostilité de Tom Mac Guire, le patron du pub, qui convoitait le local qu’elles occupent pour y installer une boîte de nuit disco. Le livre, peu à peu, dévoile les raisons qui les ont forcées à émigrer.
L’auteure, une Iranienne exilée, a connu un grand succès avec ce livre en Irlande, en 2004, avant d’être retrouvée morte 19 ans plus tard dans des circonstances mystérieuses à l’âge de 37 ans. A-t-elle été victime du même type de menaces que celles qui pèsent sur ses héroïnes, et sa célébrité a-t-elle contribué à sa disparition ? Le roman porte une part d’autobiographie, même si Marsha Mehran était enfant quand ses parents se sont installés en Argentine, où ils ont ouvert un restaurant, puis, chassés par la dictature, aux États-Unis, et enfin en Australie, où la jeune femme étudie le piano. À vingt ans, elle rentre aux États-Unis, s’éprend d’un barman d’origine irlandaise, séjourne dans plusieurs pays avant de se fixer à New York, sa ville de prédilection. Mais en dépit de son statut de femme mariée, elle se voit obligée de partir en Irlande, son permis de séjour lui étant retiré. Elle y apparaît comme une étrangère. En raison de son physique particulier, on la prend souvent pour une Chinoise ou une Japonaise. Comme elle, Layla tire sa séduction de lointaines origines extrême-orientales, au point que l’on pourrait penser à un autoportrait :
Bien sûr, on ne pouvait nier sa beauté, la régularité de ses traits de porcelaine, la légère inclinaison de ses yeux en amande qui brillaient comme deux demi-lunes sur son visage céleste. Contrairement à ses sœurs aînées, qui arboraient des boucles brunes et rétives, les cheveux de Layla étaient longs et d’un noir d’encre. Qu’elle les attache ou les laisse pendre, qu’elle leur applique de la mousse ou du gel, rien ne parvenait à les détourner de leur droiture obstinée. Ils étaient sans conteste la résurgence d’un ancien chromosome extrême oriental niché au plus profond d’elle-même.
Le portrait, par ailleurs, pourrait recourir à certains codes de la poésie persane. Dans le livre, bon nombre des personnages, y compris les gitans, sont roux, ce qui permet à l’auteure de marquer la différence, même si la rousseur, en Irlande, pourrait faire figure de cliché. Une autre note de légèreté est apportée par la description des habitants du village, dont la plupart correspondent à des stéréotypes, Estelle, la chaleureuse veuve italienne, qui a son jardin d’herbes aromatiques, avec une prédilection pour la lavande et le romarin, Dervla et d’autres commères de village, Tom Mac Guire, le patron de pub malhonnête, Tom junior, la petite brute, le père Mahoney, ce curé gourmand dont la première vocation a été le théâtre, avant une conversion aussi subite que forcée, Malachy, le jeune premier, etc. Les jeunes Iraniennes, en revanche, sont enveloppées d’une part de mystère. Mais personne n’est totalement mauvais et certains habitants trouvent une rédemption. Un lien unit les exilées à d’autres exclus, les Tinkers, ces gitans irlandais. L’intervention de l’un d’eux, ancien boxeur, permet à Layla d’échapper aux griffes d’un Tom junior un peu trop entreprenant. L’autrice, qui a souffert de sa position d’étrangère, plaide en faveur d’une société multiculturelle. Certains personnages, d’ailleurs, connaissent des histoires d’amour avec des étrangers. Le père biologique de l’amoureux de Layla n’est pas Tom Mac Guire, mais un pêcheur espagnol, et Fiona Athey, la coiffeuse qui voulait être actrice, a vu ses rêves s’envoler car “une romance illicite avec Gerhard, un marionnettiste allemand, l’avait clouée au lit avec une grossesse difficile dont allait surgir le fléau de son existence, sa fille Emer, aujourd’hui âgée de dix-sept ans”.
Dans un premier temps le livre présente l’aspect d’un roman culinaire exaltant la sensualité de la cuisine orientale avec ses parfums, ses saveurs. La préface retranscrit, à ce sujet, les propos de l’écrivaine :
Cuisiner, c’est une façon parfaite d’exprimer son amour, dit-elle. Quand vous préparez un plat, vous n’êtes pas seulement en train de combler une faim physique, mais un désir plus profond, le désir d’un foyer, d’un endroit sûr où l’on peut se reposer. Dans mon enfance, tous les repas étaient servis sur un tissu brodé qu’on appelle le sofreh. Assis en tailleur le long des bords, les membres de la famille pouvaient toucher leurs racines de la façon la plus fondamentale.
Marjan, l’héroïne, se souvient d’un été brûlant où les siens se racontaient des histoires autour du fameux “sofreh”, un souvenir directement puisé dans ceux de l’écrivaine, au cours d’un repas similaire sur un toit terrasse de Buenos Aires, au cours duquel sa mère racontait des contes issus des “Mille et une nuits”. Il y a donc un lien très fort entre la cuisine et l’exil. Le décor et les senteurs du Babylon Café recréent un Iran perdu, fantasmatique, de convivialité et de douceur, loin de la barbarie instaurée par les régimes successifs, celui du foyer familial. Chaque chapitre se clôt sur une recette, soupe de lentilles rouges, baklavas, dolmas, dough, abgoosht, etc., dont la présentation fait saliver le lecteur. On y croise “les fragrances de la cardamome et de l’eau de rose, celles du riz basmati, de l’estragon et de la sarriette”, parfums quotidiens pour Marjan, qu’elle suppose aussi familiers que “les arômes de café soluble ou de jus de viande rôtie l’étaient dans la plupart des cuisines occidentales” La grenade, qui entre dans le titre, y occupe une grande place, mais pas celle, mortifère, de Perséphone, plutôt celle, orientée vers la vie, des contes persans. Marjan cultive elle-même ses herbes aromatiques.
Guidée par les douces mains de Baba Pirooz, le vieux jardinier barbu qui s’occupait des terrains de sa maison d’enfance, la jeune Marjan avait cultivé des plants touffus de marjolaine et d’angélique dorée sur des buttes de terre sombre. Le sol tirait son humidité de la fonte des neiges de montagne qui coulait depuis l’Elbourz voisin jusqu’aux banlieues aisées de Téhéran avant de jaillir dans la grande fontaine octogonale des Aminpour. Au centre du jardin, le basson était carrelé de mosaïques esfahani aux tons turquoise et verts.
C’est ce paradis perdu qu’elle tente de recréer à Londres, puis dans l’arrière-cour de son restaurant de Ballina croagh, un village perdu du comté de Mayo (le nom est constitué par celui de deux localités différentes que l’auteure a assemblées) où l’on trouve des pubs, des boutiques d’objets religieux, et des échoppes de pull d’Aran. Le père Mahoney est leur premier client. Chaque fois, le livre décrit la préparation minutieuse des plats et leur signification.
Mais si l’Irlande représentée obéit à certains clichés, l’Iran, en revanche, apparaît de façon inquiétante au détour des analepses. À l’euphorie de la révolution étudiante luttant contre le Shah succède la déception, puis l’horreur, avec la prise de pouvoir des ayatollahs. En définitive, les trois orphelines n’ont pas d’autre choix que la fuite. Mais une menace continue à peser sur elle. Layla, la plus petite (elle avait sept ans à l’époque), se souvient de tout.
Elle se rappelait les sirènes. Les haut-parleurs rugissants montés sur des jeeps de l’armée qui déboulaient sans prévenir pour annoncer le couvre-feu et patrouillaient dans les rues bordées de fleurs des banlieues résidentielles aux teintes pastel, et les maisons remplies de dough autant que de Coca-Cola.
Le contraste entre le climat belliqueux et l’atmosphère paisible de quartiers évoquant la douceur, par les coloris et la végétation, renforce la sensation de menace, qui se précise dans la suite du texte :
Peu après, les voiles étaient arrivés. C’était drôle qu’elle se souvienne de les avoir entendus avant de les voir, les teintes funèbres de cette tente pour femme qui allait par la suite devenir si courante, même dans les banlieues plus aisées du nord de la capitale. Tchador, tchador. Trois mètres carrés de laine rêche stratégiquement drapés et fixés en claquant des dents, qui ne révélaient rien au-dessus des yeux qui clignaient, rien au-dessous des nez qui coulaient. Tchador, tchador.
“Ces corbeaux en tissu” ont tellement terrifié les jeunes filles que la vision des religieuses irlandaises ravive le traumatisme de l’une d’elles. L’engagement de Bahar, qui s’achève sur un mariage désastreux, l’arrestation de Marjan et les souvenirs traumatiques de Layla renvoient à une époque dépourvue d’humanité. Le plus terrible reste l’image sanglante dont la plus jeune ne peut se départir : “Layla jeta un coup d’œil à la rue qui menait au bazar, puis fixa le flot de sang qui coulait encore comme un ruisseau de larmes sur le boulevard recouvert de feuilles mortes.” La description continue, précise, détaillée, saisissante.
Les souffrances de l’exil sont aussi évoquées, dans cet ouvrage dont l’aspect parfois caricatural ne masque pas la profondeur. L’écrivaine a toutefois voulu, en dépit de la douleur qui affleure, insuffler un sentiment de joie, qui exprime, dit la préface, “une gaieté et une vitalité caractéristiques des Iraniens et de la culture perse elle-même”. Ce sont les Babyloniens qui ont inventé le terme paradis pour évoquer les jardins, et le livre fait aussi bien référence à ceux, suspendus, de Babylone, qu’à celui que Marjan tente de recréer. Elle s’efforce de faire “quasiment goûter ou humer l’une des contributions majeures de l’Iran au monde : sa cuisine délicate et parfumée.” La littérature, constitue “son unique terre d’asile”. Livre chaleureux et bienveillant, plein d’humour, en dépit de la gravité de son sujet, “Une soupe à la grenade” célèbre la sensualité, le bonheur et le pouvoir réconciliateur de la cuisine, facteur d’unité. Aux pizzas du Delmonico succèdent les plats de Marjan, qui réjouissent les papilles irlandaises et constituent un puissant facteur d’intégration. La gourmandise est omniprésente. On suit les aventures de ces trois jeunes femmes attachantes, en s’imprégnant de la culture perse et sa sensualité, transmise par les écrivains, les poètes et les cuisiniers, que n’a pas réussi à éradiquer la république islamique.
Marion POIRSON-DECHONNE
articles@marenostrum.pm
Mehran, Marsha, “Une soupe à la grenade”, roman traduit de l’anglais par Santiago Artozqui, Philippe Picquier,”Littérature grand format”, 19/08/2021, 1 vol. (297 p.), 21€
Retrouvez cet ouvrage chez votre LIBRAIRE ou sur le site de L’ÉDITEUR
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.