Georges Navel, Passages, Éditions L’Échappée, 14/02/2025, 304 pages, 22 €
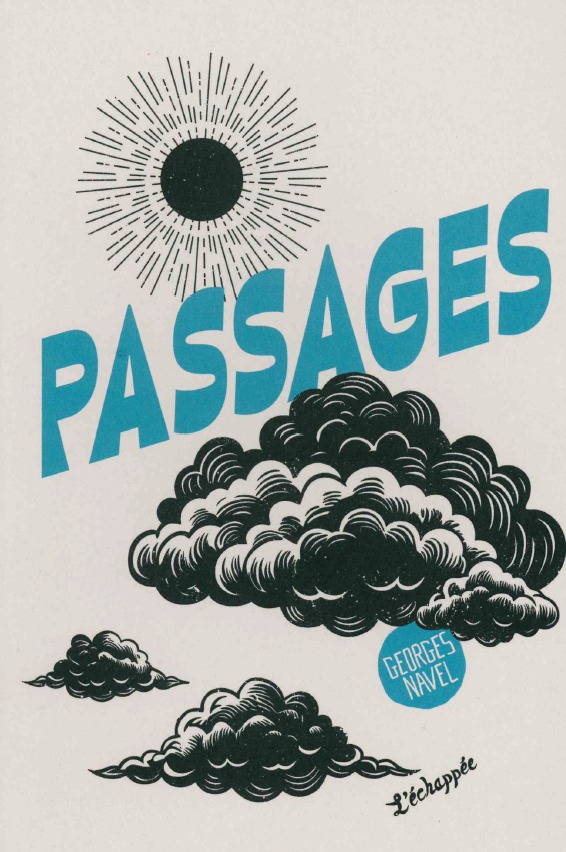
Il faut une obstination tendre, une forme d’engagement éditorial devenu rare, pour continuer de creuser le sillon des marges, pour exhumer des textes dont la beauté rugueuse nous rappelle ce que fut naguère la « grande » la littérature. Les éditions L’Échappée, dont nous avions déjà salué ici même le travail méticuleux sur les Juifs de Belleville, la parole incandescente d’Hannah Arendt, ou l’extraordinaire Paris Opium, persistent et signent. Avec la réédition bienvenue de Passages de Georges Navel, ultime ouvrage paru de son vivant en 1991, c’est une pièce maîtresse de son œuvre, et peut-être la plus intime, qui nous est rendue. Cette entreprise prend d’autant plus de sens qu’elle est enrichie d’une préface éclairante signée Roméo Bondon. Revenir à Passages, c’est donc accepter de se laisser guider par une voix singulière, celle d’un homme dont l’existence entière fut une traversée, entre usine et grand air, silence et insurrection, travail manuel et lent surgissement de l’écriture.
Maidières, ou le tissu sensible du monde
Le premier mouvement de Passages nous plonge dans la prime enfance, à Maidières, ce hameau lorrain où le monde s’offre comme une matière brute, dense, pétrie de sensations pures. Georges Navel nous restitue le tissu sensible de ces années fondatrices avec une acuité remarquable. L’écriture épouse les perceptions enfantines, capte les odeurs mêlées de la terre et de l’étable (« odeurs de soufre, de gaz phosphorique, de fumées des hauts fourneaux » ou, plus loin, celles, contrastées, du « schuh-crème pour cirer ses bottes » et du « suint de mouton »), les jeux de lumière dans la grande chambre familiale, le fracas des trains sur la voie ferrée voisine, le poids des saisons sur les gestes et les corps. C’est une phénoménologie du quotidien qui se déploie, où chaque détail – la texture d’une robe, le son d’une cloche, le goût d’une mirabelle – devient le vecteur d’une connaissance intime, presque tellurique, du réel. L’univers enfantin de Georges Navel est celui d’une immersion, d’une participation intense à un monde dont il apprend, par capillarité sensorielle, les rythmes, les dangers et les beautés simples. L’écriture ne cherche pas l’analyse psychologique, mais la restitution d’une présence au monde, pleine, immédiate, où le corps de l’enfant est la caisse de résonance de toutes les vibrations alentour.
Autour de cette perception première gravitent des figures tutélaires, dont Georges Navel esquisse les portraits avec une tendresse dénuée de sentimentalisme. La constellation familiale est le creuset des premières émotions et des premières interrogations sur l’ordre social. Il y a d’abord la mère, personnage central, silencieux, dont la piété et le labeur acharné (« le temps de refaire les lits de saupoudrer d’insecticide les recoins des matelas et de la boiserie ») constituent l’axe stable d’un monde fragile. Elle est le lien originel, la matrice d’une sensibilité au concret, au geste juste. Le père, ouvrier des Forges de Pont-à-Mousson, incarne, lui, la condition prolétarienne dans ses contradictions : patriote résigné, pétri de maximes et de défiance (« sa réputation de fainéantise lui interdisait de telles ambitions dans un pays où les gens n’estimaient que les hommes capables de trimer durement »), dont la rudesse masque une affection maladroite. Ses silences, sa fatigue, les marques du travail sur son corps sont observés par l’enfant avec une lucidité précoce. Les sœurs ouvrent des perspectives sur un monde extérieur – celui de l’usine, des amitiés féminines, des espoirs déçus (« Délaissée par un dragon, une jeune fille s’était jetée dans la Moselle »). Et puis il y a les figures masculines fortes, comme le frère Lucien, passeur d’idées libertaires, ou le beau-frère Camille, ajusteur à l’usine, incarnation d’une fierté ouvrière et d’une sociabilité chaleureuse (« Il m’avait vu grandir, j’étais son poussin, son petit frère, je l’adorais »). Ces personnages, saisis dans leur quotidien, leurs gestes répétitifs, leurs paroles rares, composent la trame humaine à partir de laquelle Navel questionnera, plus tard, les déterminismes sociaux et la possibilité d’une émancipation.
C’est aussi à Maidières que l’Histoire, avec sa violence sourde, fait irruption dans le paysage enfantin. La Première Guerre mondiale n’est pas un événement lointain, abstrait, mais une présence tangible : les soldats qui défilent sous les fenêtres (« les petits soldats sous nos fenêtres, les cavaliers coiffés du casque de cuivre à crinière »), le départ des frères, l’angoisse maternelle, la rumeur des combats tout proches. La description par Bondon de la photographie de 1915 – Georges, dix ans, poing sur la hanche, pantalon trop court, à la veille de rejoindre l’Algérie pour fuir la guerre – condense cette première confrontation au tragique. Georges Navel note avec précision le décalage entre l’excitation enfantine face au spectacle militaire (« Plus les dragons étaient nombreux, plus ma joie était vive ») et la réalité brutale du conflit qui se prépare. De même, l’usine, d’abord perçue à travers la figure paternelle, devient peu à peu le symbole d’un enfermement, d’une condition subie. Les premières lectures, les discussions politiques surprises, les bribes de conscience sociale qui émergent (« Sauf la sauvegarde du territoire national, ils n’avaient ni biens, ni propriété à défendre ») plantent les germes d’une révolte future, d’une lucidité douloureuse qui nourrira toute l’œuvre à venir.
Corps meurtris, consciences en éveil
Passages ne fait pas que restituer le monde sensible de l’enfance. Le livre déroule le fil d’une existence marquée par le travail physique, la précarité et une quête inlassable de sens et de liberté. Des divers métiers exercés par Georges Navel – terrassier, ouvrier agricole, ajusteur, correcteur d’imprimerie – émerge une connaissance intime, charnelle, de la condition ouvrière. L’écriture excelle à dire la fatigue des corps (« Pousseur de wagonnets, il avait cheminé toute la journée à travers l’usine […] durement peiné »), la douleur rentrée, l’aliénation sourde qui naît des gestes répétitifs, de la soumission aux cadences et aux hiérarchies. Que ce soit dans la description des « ogres » de l’usine, ces « mâles à longues moustaches, des hommes forts qui sentaient la sueur de fonderie », ou dans l’évocation de l’atmosphère pesante de l’atelier de peinture où il travaille plus tard à Lyon, Georges Navel parvient à saisir, par notations précises, la pesanteur d’un destin collectif. Mais cette immersion dans le monde du travail n’est jamais misérabiliste. Elle est toujours tempérée par une observation aiguë de la complexité humaine, des formes de résistance discrète, de solidarité fraternelle qui peuvent éclore même dans les contextes les plus rudes.
Cette expérience du travail et de la condition ouvrière nourrit une conscience politique précoce, aiguisée par les rencontres et les lectures. La fréquentation des milieux libertaires lyonnais, l’influence du frère Lucien, puis, plus tard, la découverte des grands textes anarchistes (Proudhon, Bakounine, Kropotkine mentionnés dans Passages) façonnent une pensée critique, rétive à tous les embrigadements. Georges Navel n’est pas un théoricien, mais un homme qui pense à partir de son expérience vécue. Sa critique des institutions – l’armée, l’usine, l’école, l’Église – est toujours ancrée dans le réel, dans l’observation des effets concrets de ces structures sur les vies individuelles. Son parcours est marqué par une tension constante entre le besoin viscéral de liberté individuelle, la tentation de la fuite (« le désir d’aller au loin pour respirer l’air du large », comme l’écrit Roméo Bondon dans la remarquable préface, et la fidélité, malgré les déceptions, à une classe, à une communauté de destin. Le trimardeur, figure emblématique de l’errance et de la précarité, devient chez Navel l’incarnation d’une forme de sagesse marginale, d’une intelligence du réel acquise « sous les ongles ».
Ce refus de l’embrigadement trouve son expression la plus forte dans l’épisode, longuement raconté dans Passages, de son engagement dans les colonnes anarchistes durant la guerre d’Espagne. Georges Navel décrit avec une lucidité parfois cruelle l’enthousiasme initial (« J’avais le sentiment […] d’être là au cœur même de l’Histoire »), puis la désillusion face au chaos organisationnel, à l’impréparation, à l’écartèlement entre l’idéal libertaire et la nécessité d’une discipline combattante (« Désorganisation générale, aucune liaison entre les divers groupes, […] rivalités et dissentiments »). Son récit, qui n’est pas sans évoquer L’Hommage à la Catalogne d’Orwell, se distingue par une attention constante aux détails matériels, aux sensations physiques – la faim, la soif, la fatigue, la maladie qui le terrasse finalement –, comme si le corps, une fois de plus, devenait le lieu où s’éprouve la vérité, fût-elle douloureuse, d’une expérience historique. Cet épisode espagnol, moment paroxystique d’engagement et de désillusion, marque une étape décisive dans le parcours de Georges Navel, le confirmant dans sa méfiance envers les abstractions idéologiques et son attachement à une forme de vérité ancrée dans le vécu.
C’est peut-être de cette tension entre engagement et retrait, expérience collective et quête solitaire, que naît la nécessité de l’écriture. Roméo Bondon souligne le rôle déterminant de Bernard Groethuysen et Alix Guillain dans l’émergence de l’écrivain Navel. Passages témoigne de cette lente métamorphose, de cette « alchimie de l’attention » par laquelle le travailleur manuel, celui qui maniait la pelle, le pic, ou plus tard les caractères d’imprimerie, devient celui qui observe, note, et finalement transmute le réel en matière littéraire. L’écriture de Georges Navel n’est pas une évasion, mais une manière d’intensifier sa présence au monde. Il le dit lui-même dans un passage cité par Roméo Bondon : « Je me suis dit que j’allais devenir attentif à ce que je faisais. Je voulais trouver un accord dans le réel. Le maniement de l’attention intérieure retournée sur l’outil, sur la pelle, sur la pioche, m’a permis de découvrir un merveilleux moyen d’illumination ». Cette « illumination » n’a rien de mystique au sens traditionnel ; elle naît d’une attention extrême portée au détail, au geste le plus humble, à la texture même du quotidien. L’écriture devient alors une forme de travail, patient, rigoureux, visant non pas à embellir le réel, mais à en révéler la densité cachée, la poésie involontaire. Le choix du « mot le plus humble », cette volonté de considérer l’écriture comme une « sténographie », témoigne d’une éthique autant que d’une esthétique : rester au plus près des choses, refuser l’emphase, laisser parler le réel dans sa nudité, sa vérité parfois rugueuse.
La résonance tendre des vies minuscules
Que nous dit Passages aujourd’hui, dans une époque souvent amnésique du passé ouvrier et volontiers séduite par les récits lisses ? La force du livre tient sans doute à sa capacité à rendre visible ce qui demeure souvent dans l’ombre : le travail dans sa dimension physique, répétitive, parfois aliénante, mais aussi les formes de dignité, de résistance et de sociabilité qui s’y inventent. À l’heure où le travail tend à se dématérialiser pour certains, à se précariser davantage pour d’autres, la voix de Georges Navel résonne avec une actualité particulière. Elle nous rappelle la centralité de l’expérience laborieuse dans la construction des identités individuelles et collectives. En cela, Navel s’inscrit, à sa manière singulière, dans cette lignée d’écrivains – de Zola à Joseph Ponthus, en passant par les auteurs prolétariens ou ceux, plus récents, du « retour de classe » comme Annie Ernaux ou Didier Eribon – qui s’attachent à donner forme et voix à ceux que l’histoire littéraire a longtemps tenus à l’écart. Mais Passages n’est pas un document social ; c’est une œuvre littéraire à part entière, portée par une écriture d’une grande précision sensible.
Au-delà de sa dimension historique et sociale, le livre touche par son universalité. La quête de Georges Navel – trouver sa juste place dans le monde, concilier aspiration à la liberté et nécessité du lien collectif, donner un sens à l’existence par le travail et l’attention – est une quête intemporelle. Passages est le récit d’une formation, celle d’une conscience qui s’éveille au contact du réel, des autres, de l’Histoire. Il y a, dans le regard que l’auteur porte sur le monde, même dans ses aspects les plus sombres, une forme de tendresse têtue, une capacité à saisir la beauté fragile des choses simples, la lumière dans les existences les plus humbles. C’est peut-être là que réside la portée la plus profonde du livre : dans cette manière d’habiter le monde avec présence, lucidité, et une forme de gratitude discrète pour le simple fait d’exister, malgré les épreuves, malgré la fatigue des jours.
En refermant Passages, le lecteur n’emporte pas avec lui des certitudes, mais plutôt une série d’interrogations, d’échos, de résonances. Georges Navel ne cherche pas à imposer une vision du monde, mais à partager une expérience, une traversée. Le titre même, dans sa polysémie – passages géographiques, passages du temps, passages d’un état à un autre, passages entre l’ombre et la lumière –, invite à une lecture plurielle, ouverte. L’écriture fragmentaire, faite de notations brèves, de souvenirs épars, de réflexions suspendues, laisse des blancs, des silences, où la pensée du lecteur peut venir se loger, tisser ses propres correspondances. Comment faire de sa vie, même la plus ordinaire, une matière de connaissance et de poésie ? Comment rester fidèle à soi-même et aux autres dans un monde marqué par l’injustice et la violence ? Comment trouver la lumière « sous les ongles », dans le labeur et l’attention aux choses humbles ? Passages ne donne pas de réponses définitives, mais ouvre des chemins, suggère des pistes, nous laissant, comme Navel lui-même, attentifs aux signes fragiles du monde, à l’écoute des voix ténues qui continuent de murmurer à travers le temps.

















