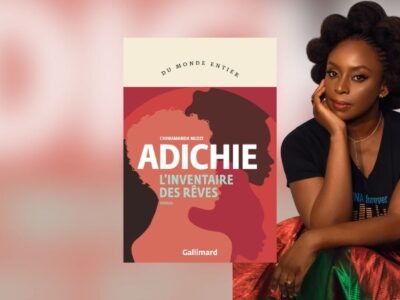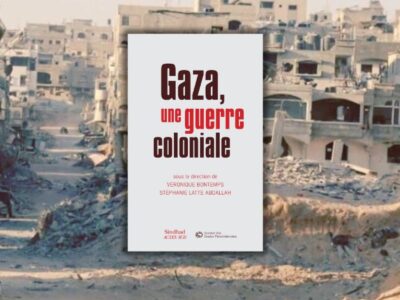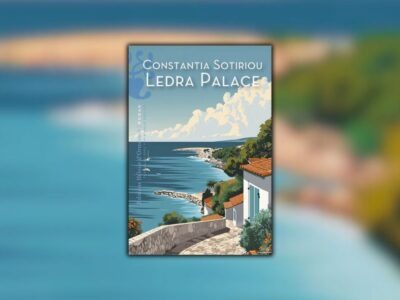Jabbour al Douaihy, Il y avait du poison dans l’air, roman traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie Dujols, Actes Sud, 03/01/2024, 1 vol. (185 p.), 21,50€
De la fin des années 1950 à la destructrice et meurtrière explosion qui, le 4 août 2020, se produisit dans le port de Beyrouth, Il y avait du poison dans l’air conte l’itinéraire d’un homme tourmenté dans un Liban en permanence sous tension, que les combats entre communautés couvent ou qu’ils soient effectifs.
En mettant en mots les déménagements successifs et les engagements éphémères ponctuant le parcours de vie du narrateur dans un pays à l’instabilité chronique, Jabbour Douaihy cerne avec justesse et sensibilité la mélancolie profonde d’une personnalité très singulière dont le compagnonnage des livres sera finalement la seule presque certitude, la fidélité ultime.
Des déménagements successifs
Suite à une ordonnance d’expropriation, tout jeune adolescent, le narrateur et sa famille (ses parents et une tante hémiplégique) durent quitter “leur bourgade” libanaise. Empochant “les compensations qui se révélèrent généreuses”, le père décida de s’installer dans un quartier de Tripoli où résidaient “les siens”, les chrétiens maronites. Il avait pris soin de choisir une maison suffisamment protégée du quartier sud (le quartier musulman), “celui d’où pouvait venir le danger si les choses se gâtaient”. La famille l’occupa tant qu’il n’y eut pas de morts, tant qu’il y avait juste “du poison dans l’air”.
En 1975 (début officiel de la Guerre du Liban) “quand des obus tombèrent du ciel”, la famille comprit que, désormais, le danger n’était plus seulement “horizontal” nourrit pas des tirs de snipers mais qu’il était aussi “vertical”. Les Maronites ayant l’habitude de trouver de la quiétude à la montagne, le père opta pour un village situé sur les hauteurs de Tripoli. Mais, au premier automne, l’enfermement contraint dans la maison et l’ennui afférent décidèrent la famille à reprendre la route ; les tirs et les obus persistant sur Tripoli, le choix fut fait de descendre vers Beyrouth.
Jusqu’en 1990 (fin officielle de la Guerre du Liban) et, au-delà, jusqu’en 2020, alors que la guérilla urbaine entre milices confessionnelles et que les effets délétères des interventions armées de la Syrie et d’Israël rythmaient la vie des Beyrouthins et Beyrouthines, les privant d’espoir, le narrateur déménagea à plusieurs reprises ; non pas à cause des combats qui faisaient partie intégrante du quotidien mais en raison d’événements familiaux et personnels.
À la mort de la tante tant aimée qui avait légué à son neveu une somme d’argent considérable, la famille quitta l’appartement au 4e étage d’un immeuble sans cachet d’où, « lorsque le vent venait du nord, les cinq appels à la prière leur parvenaient de la mosquée Abou Bakr al-Siddiq ». Elle alla à l’ouest de la capitale où le narrateur devenu riche jeta son dévolu sur une bâtisse classée, mais sa destruction par incendie obligea la famille à déménager une nouvelle fois.
Alors adulte, le narrateur enchaîna les adresses beyrouthines : seul à l’hôtel avec le projet d’écrire, dans l’appartement qu’il partagea brièvement avec la “professeure de philosophie” qu’il épousa, en prison, en colocation avec son neveu noir, le fils de sa tante maternelle revenue d’Afrique après avoir fui, encore adolescente, son village natal en compagnie d’un homme marié. Enfin, à peine âgé de 40 ans, soucieux d’un retour aux origines, le narrateur s’établit dans un village de montagne dont il fit le lieu de sa réclusion définitive.
Des engagements éphémères
Dans le domaine amoureux comme dans celui de la politique, les engagements éphémères du narrateur furent incontestablement façonnés par la quête de liberté qui a parcouru une grande partie de la planète au cours des décennies 1960 et 1970. Toutefois, profondément solitaire, il leur donna un caractère toujours décalé, quasi dilettante.
Notamment, lors de l’été 1975, dans le village de montagne où sa famille s’était réfugiée, le narrateur, alors âgé de 19 ans, connut sa première liaison amoureuse avec une jeune femme Beyrouthine en vacances qui l’initia à la sexualité en “voulant toujours mener la barque”. La lettre que chaque jour il devait apporter à celle-ci comme préalable à leurs ébats, constitua sa véritable première expérience d’écriture. Cette lettre journalière, rédigée avec facilité, contenait “une substance lumineuse qui s’éteignit” lorsque, soudainement, la jeune femme disparut. De cette brève mais fougueuse liaison, il garda la sensation de l’avoir inventée “à partir de fragments de lectures”.
Comme ce fut le cas pour cette première relation amoureuse, lors des suivantes le narrateur ne chercha pas à connaître des éléments de l’histoire de sa partenaire. Cet empêchement d’être pleinement présent à l’existence de l’autre sera fatal à son mariage éclair avec sa collègue professeure de philosophie. Il le sera jusqu’à « commettre la plus grosse bêtise de sa vie » qui le conduisit en prison. Cette femme, il “l’avait préférée de source inconnue, venue de nulle part”.
De même, alors que ces études universitaires en lettres ne satisfaisaient pas sa curiosité et n’alimentaient pas sa réflexion critique, il se rendit à Aman en Jordanie afin de rejoindre les Fédayin. Son premier contact avec le terrain n’ayant pas été convaincant, on le congédia après l’avoir remercié pour sa solidarité : “il faut dire qu’en ce temps-là, les demandes d’enrôlement excédaient de loin les besoins de la lutte armée palestinienne”.
De retour à Beyrouth, il devint membre d’un groupuscule d’activistes – l’Organisation des Trotskistes Arabes –. À la cafétéria de l’université, il se plut à faire l’éducation politique des étudiants de première année, leur spécifiant que les disparités flagrantes de richesses dans le pays ne tarderaient pas à générer des conflits sociaux qui entraîneraient la chute du pouvoir en place. Et, “naturellement ce n’est pas ce qui se produisit, c’est tout autre chose qui surgit du flacon magique de la ville…”
Une mélancolie profonde
La vie du narrateur fut scandée par des phases de mélancolie profonde. Il s’agissait “de tourments intimes qui survenaient sans crier gare, comme s’il avait en lui une fiole à chagrin qui se remplissait goutte à goutte jusqu’au moment où elle finissait par déborder”. Lors de ces phases, il se mettait à distance du monde et de ceux et celles qui l’habitaient. Seules de longues marches solitaires le tenaient debout ; quant aux livres, ils étaient les compagnons précieux de son retrait irréfrénable du réel, jusqu’à finalement l’en sortir.
À l’adolescence, il perçut que sa mélancolie avait peut-être un lien avec les craintes permanentes que sa mère nourrissait par rapport à tout ce qui le concernait, que ce soit ce qui le menaçait, comme d’éventuelles rencontres avec des personnes malveillantes, ou ce qui lui plaisait, comme son engouement pour les livres. Il entrevit que sa mère portait un fardeau, qu’irrépressiblement elle lui instillait : celui de la folie dont la famille Sabbâgh – sa famille – était possiblement le creuset “avec sa liste de gens excentriques, voire mentalement dérangés” et dont le voisinage ne se privait pas d’égrener les noms, précisant le profil atypique de chacun.
Opérant tel un héritage pour le pire que le narrateur avait tenté de dompter en vain, ces excentricités ou ces dérangements mentaux peuvent peut-être permettre de comprendre son engagement éphémère en tant que saboteur amateur : que ce soit à son insu, en entreposant par solidarité à son domicile les bâtons de dynamites de l’Organisation des Trotskystes Arabes qui, en explosant au cours d’un incendie, le détruisit ; que ce soit de façon délibérée, quand, pour venger son ami Kurde, mort en mer, alors qu’il migrait vers l’Angleterre, usant d’un fusil à lunette, il visa un camion-citerne qui s’enflamma, provocant un carambolage monstre et meurtrier sur la route de la Bekaa. C’est après cet accès de violence inconsidérée que le narrateur décida de sa réclusion qu’il voulut irrémédiable : ne souhaitant plus vivre à Beyrouth, il partit vers l’est montagneux avec l’argent hérité de sa tante en espèces, ses vêtements et ses chers livres…
Non sans une légèreté souvent empreinte d’une ironie moqueuse rendant d’autant plus juste le propos développé par Jabbour Douaihy, Il y avait du poison dans l’air relate deux parcours funèbres conjoints : celui d’un Liban exsangue dont, aujourd’hui, la grande majorité des habitantes et habitants, floués et désabusés, ne savent quoi attendre d’un pays qui n’en est plus un à bien des égards ; celui d’un Libanais singulier, tour à tour ouvert puis fermé aux autres, bravant la vie à contre-courant, jusqu’à décider d’en finir, mais à sa manière distincte et distante, dans le fracas de l’explosion mortifère du 4 août 2020.
Chroniqueuse : Eliane Le Dantec
eliane.le-dantec@orange.fr
NOS PARTENAIRES
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.