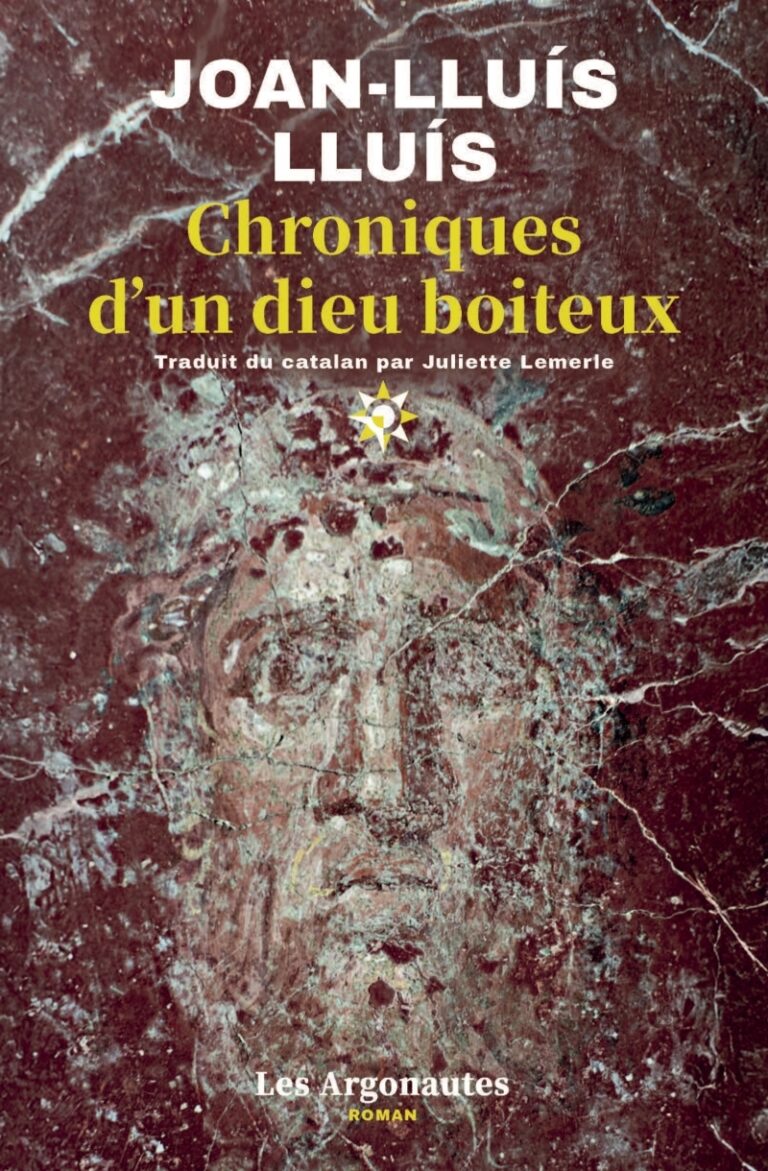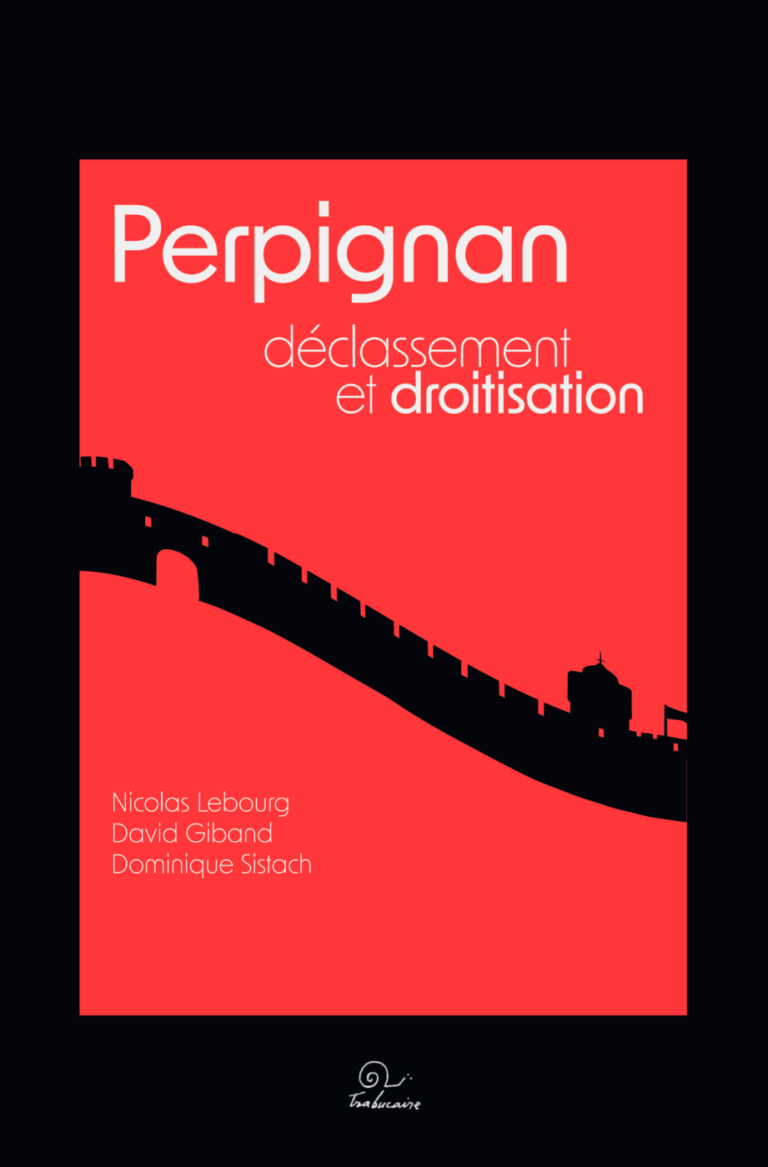Olivier Bordaçarre, La disparition d’Hervé Snout, Denoël, 17/01/2024, 1 vol. (361 p.), 21€.
Le dîner est prêt. Le bœuf bourguignon longuement mitonné fume dans la marmite. La bouteille de médoc a été débouchée. Dans le réfrigérateur, le bavarois aux fruits rouges surmonté de deux bougies, un quatre et un cinq, attend l’arrivée de celui dont on fête l’anniversaire. Mais le temps passe et Hervé Snout ne rentre pas. Les messages que son épouse Odile d’abord agacée puis inquiète lui laissent demeurent sans réponse. Les jumeaux, Eddy et Tara, âgés de quatorze ans trépignent autour de la table dressée. Eddy surtout, qui lorgne avec avidité le bœuf en sauce baignant au milieu des pommes de terre et des carottes. Odile se résout à le servir. Sa sœur Tara, qui a décidé de devenir végétarienne, est beaucoup moins enthousiaste et touche à peine à son assiette. Les minutes défilent. Les adolescents finissent par regagner leur chambre. Hervé Snout ne rentrera pas ce soir. Ni le lendemain, ni les jours suivants. Les gendarmes pourtant ne semblent pas trop inquiets. Des milliers de personnes se volatilisent délibérément chaque année. “On ne retrouve jamais leur trace parce qu’elles ne le souhaitent pas et c’est leur droit le plus strict. A quoi ressemblerait une société où la fuite serait interdite ?”
Dissection d’une famille ordinaire
Cette disparition inexplicable sert de point de départ à une impitoyable dissection de ce qui, d’un point de vue extérieur, pourrait apparaître comme l’archétype de la famille modèle. Olivier Bordaçarre décrit avec une précision quasi chirurgicale le quotidien des différents protagonistes. On pense bien sûr à Perec, moins celui de la Disparition auquel le titre fait penser, que l’auteur des Choses ou de La Vie mode d’emploi. Le confort procuré par les meubles aux lignes contemporaines et les nombreux appareils électroménagers, s’il symbolise sans doute possible la réussite sociale d’un ménage de la classe moyenne, fait paradoxalement de cette maison un lieu aseptisé et mortifère. Le bonheur n’est que de façade et ces intérieurs de catalogue masquent difficilement l’insatisfaction profonde de ceux qui y vivent. Dès que l’on gratte un peu, le vernis s’écaille. Le père, directeur d’abattoir, ne parvient plus à trouver du sens à ce qu’il fait : “Hervé Snout ne questionne pas le fait de gérer de la viande morte, c’est une affaire entendue. Il est submergé par une angoisse existentielle puissante. Quelle trace laissera-t-il ?”. La mère, Odile, trompe son ennui en peignant des copies de toiles impressionnistes et s’offre de temps à un autre un petit frisson sur la table d’auscultation du Docteur Blach qui est devenu son amant. Eddy, le fils, afin de s’attirer la reconnaissance paternelle, s’enferre dans les pires clichés de la virilité triomphante et toxique. Quant à Tara, la fille, elle est sans doute la plus lucide, estimant que ses parents, dans leur rêve de petit confort bourgeois ont “tout transformé en choses, les bêtes et les humains”.
Plongée dans l’horreur
L’origine du mystère de la disparition d’Hervé Snout se trouve peut-être dans l’abattoir que ce dernier dirige d’une poigne de fer. Dans cet établissement aussi mortifère que son pavillon-tout-confort, une autre forme de violence se joue. Violence mécanisée, ritualisée décrite avec un réalisme saisissant. La violence ne s’exerce par seulement sur les animaux que l’on abat à la chaîne mais également entre les employés qui se déshumanisent peu à peu. Le sordide quotidien d’un abattoir a rarement été aussi bien montré depuis Tristan Egolf et son magistral Seigneur des Porcheries.
La disparition d’Hervé Snout est un livre qui hantera longtemps ses lecteurs. Sa noirceur, son pessimisme assumé, ont paradoxalement quelque chose de salutaire dans un paysage littéraire contemporain où surabondent les romances feel-good et les avalanches de bons sentiments. Les romans n’ont pas uniquement vocation à entretenir les lecteurs dans leurs illusions rassurantes. La littérature sert aussi à montrer ce que l’on refuse de voir. Ce devrait même être là sa vocation première et Olivier Bordaçarre le prouve avec brio.