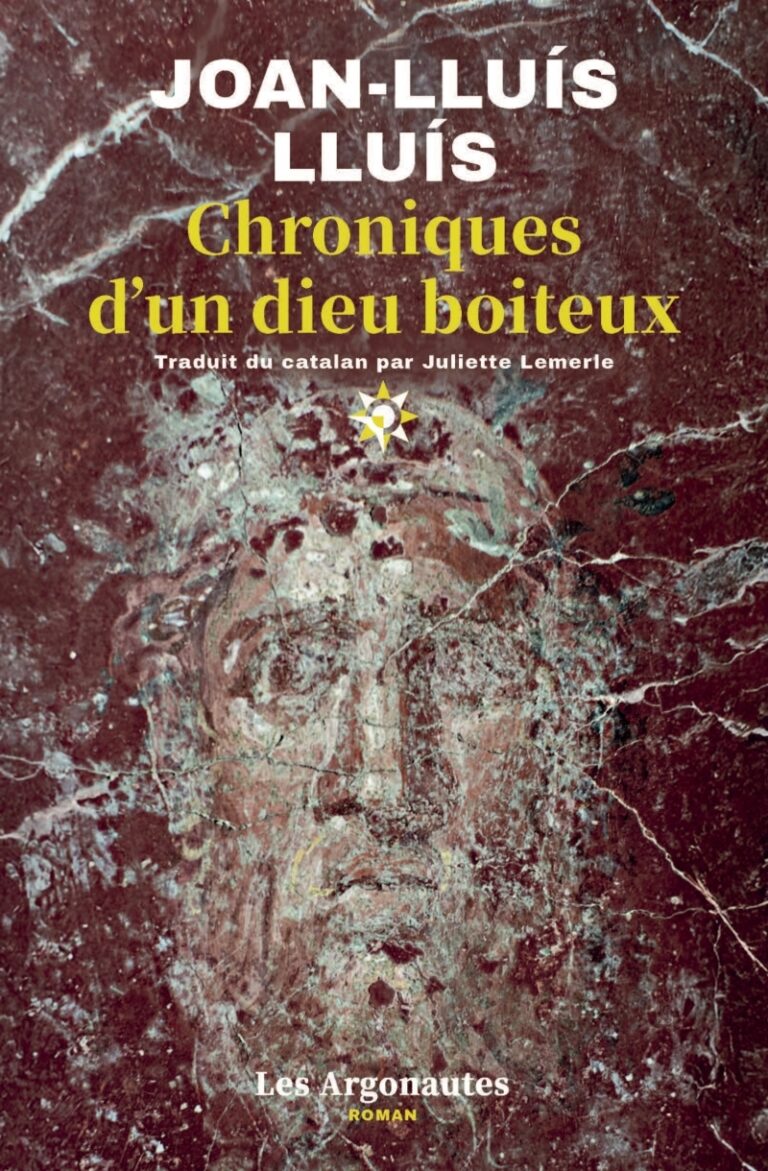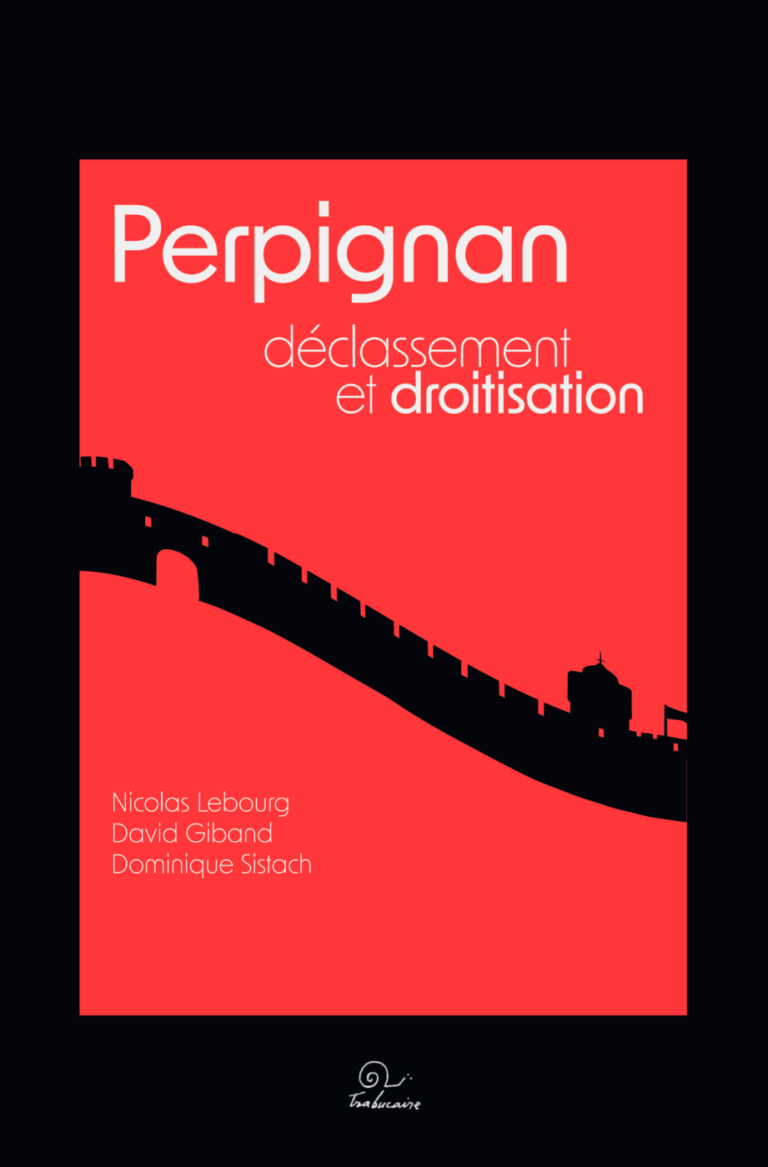David Clerson, Mon fils ne revint que sept jours, Héliotrope, 24/01/2025, 126 pages, 15€
Découvrez notre Podcast
Il est des livres qui, à la manière d’un sous‑bois après la pluie, exhalent une atmosphère si singulière qu’elle imprègne durablement le lecteur. Mon fils ne revint que sept jours de David Clerson appartient à cette catégorie d’œuvres organiques. Il raconte une histoire aussi simple qu’abyssale : dans un chalet isolé de Mauricie, une mère voit revenir son fils, disparu depuis plus de dix ans. Cette réapparition ouvre alors une brèche de sept jours dans le temps, un interlude suspendu où le réel, les souvenirs et le paysage fusionnent dans une prose hallucinée. David Clerson orchestre un huis clos à ciel ouvert, explorant les cycles de la vie, de la mémoire et de la décomposition avec une justesse troublante.
Un retour en forme de fantôme
Le roman s’ancre dans un cadre narratif épuré. Une biologiste à la retraite, passant ses étés seule, voit sa solitude rompue par l’arrivée de Mathias, son fils. Cet homme, qu’elle a connu adolescent et qu’elle retrouve épaissi, vieilli, est un fantôme bien vivant. Son errance de dix ans, de l’Ouest canadien au Mexique, l’a transformé. Les lettres qu’il envoyait sporadiquement cartographiaient déjà un esprit à la dérive, une psyché en proie à une contamination galopante où le monde intérieur déborde sur l’extérieur. Son retour ne vient pas clore ce chapitre ; il en incarne la phase terminale. Le récit se déploie autour de leurs marches vers la tourbière, ce lieu emblématique de leur passé commun, qui devient le théâtre de ses confessions délirantes et de l’amour inconditionnel et inquiet de sa mère. La tension fondamentale du livre réside dans cette dualité : le corps du fils est là, mais son esprit appartient déjà à un ailleurs, un monde marécageux où tout pourrit.
L’écriture comme un mycélium
Le style de David Clerson irrigue la narration d’une vie propre, organique. L’auteur déploie une langue qui mime les processus qu’elle décrit. Des phrases‑échos se répètent, créant une litanie obsédante qui reflète la pensée cyclique du fils. L’idée que son cerveau se liquéfie et que « des champignons lui pousseraient dans la tête » revient comme un leitmotiv. Ces boucles verbales créent un effet d’envoûtement, plongeant le lecteur dans le même état de fascination et d’effroi que la narratrice.
Le roman tout entier repose sur un réseau de métaphores botaniques et mycologiques. La forêt devient le miroir des âmes ; la tourbière, avec sa sphaigne qui étouffe un ancien lac, devient l’allégorie parfaite de la mémoire familiale : une strate de vie qui se construit sur les vestiges des morts, une conservation par l’acidité et la décomposition. La narratrice, spécialiste des champignons, regarde son fils et ses propres souvenirs avec un œil de biologiste. Elle observe la porosité entre l’humain et le non‑humain, entre la putréfaction du bois mort et les délires de Mathias. La prose, visuelle et sensorielle, capte le vrombissement des moustiques, l’odeur de l’humus, la texture d’une peau moite. Le fils répète qu’il a « la tête qui explose ! » et, par la force de l’écriture, le lecteur sent son propre esprit s’emplir du poids de cette nature à la fois magnifique et dévorante.
Résonances d’un monde contaminé
Derrière ce drame intime, Mon fils ne revint que sept jours déploie une portée symbolique puissante et éminemment contemporaine. La thématique de la contamination est centrale. Elle est d’abord psychologique : le souvenir du père, lui aussi disparu près de cette même tourbière, semble avoir infecté l’esprit du fils, comme une spore libérée dans un corps. Le cerveau de Mathias devient le premier territoire d’une apocalypse intime qui se propage ensuite à sa perception du réel. Cette vision d’une réalité contaminée résonne étrangement avec nos angoisses écologiques, cette impression diffuse que le monde se dérègle et que les frontières entre le sain et le malade s’effacent.
Le livre interroge aussi notre rapport à la ruralité. Il met en scène une nature souveraine, presque mythique, menacée par l’expansion humaine, symbolisée par les nouveaux chalets, les bateaux à moteur, le bruit qui empiète sur le silence. La solitude de la mère, au départ choisie et apaisante, devient le réceptacle de la tragédie. David Clerson magnifie la forêt comme un espace de transmission archaïque. La connaissance des plantes, le chemin vers la tourbière, les secrets du paysage constituent un héritage bien plus profond que le chalet lui-même. C’est un savoir des cycles, du vivant qui se nourrit de l’inerte, une sagesse que la mère tente de léguer à ses petits‑enfants, comme un dernier rempart face à un monde qui oublie ses racines.
Vers l’œil de la tourbière
Mon fils ne revint que sept jours est un roman d’une densité et d’une cohérence remarquables. David Clerson y explore la matière même du deuil et de la mémoire, montrant comment les êtres, tout comme les paysages, sont façonnés par leurs fantômes. La structure en sept jours, rappelant un cycle à la fois biblique et biologique, rythme parfaitement la montée en tension vers une issue pressentie. Sans jamais nommer frontalement la maladie ou la folie, le texte sonde le mystère d’un être qui revient pour parachever sa propre disparition. Que reste‑t‑il après le départ d’un fils qui, tel un corps momifié dans la tourbe, était déjà un vestige de lui‑même ? Peut-être seulement cela : l’amour indéfectible d’une mère, et le chant assourdissant des rainettes dans la nuit, qui nous rappelle que même après le drame, la vie, sous une forme ou une autre, continue son étrange et implacable cycle.