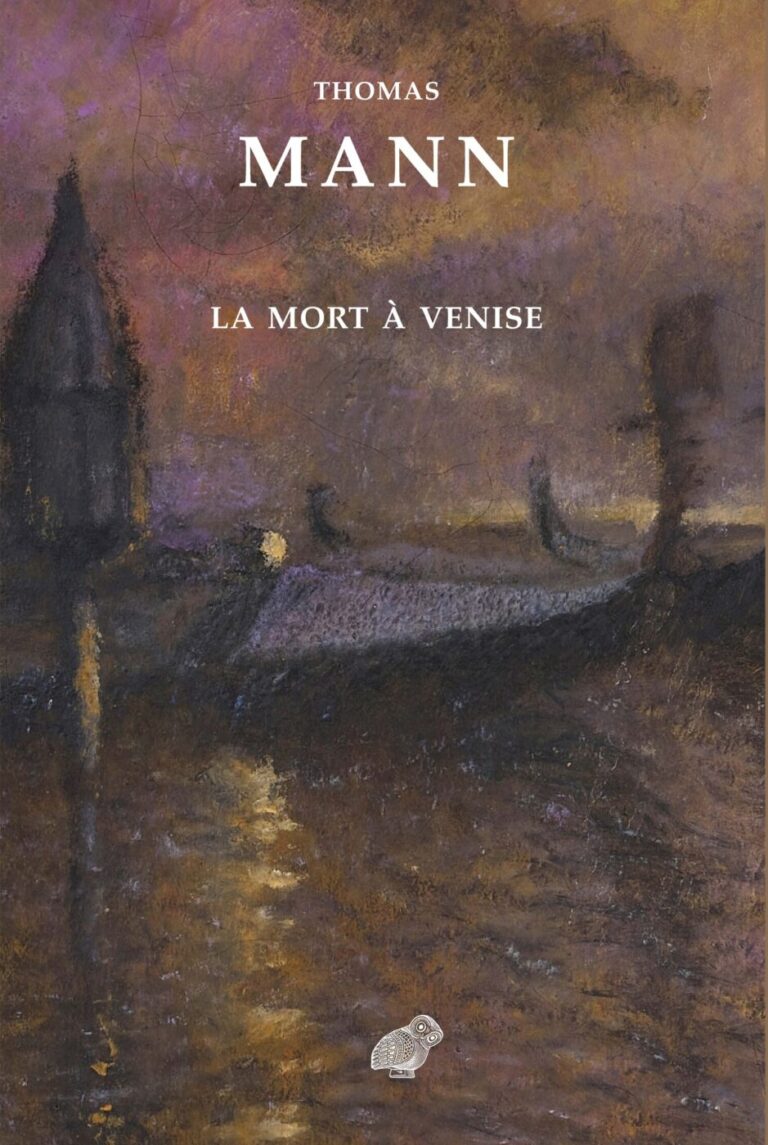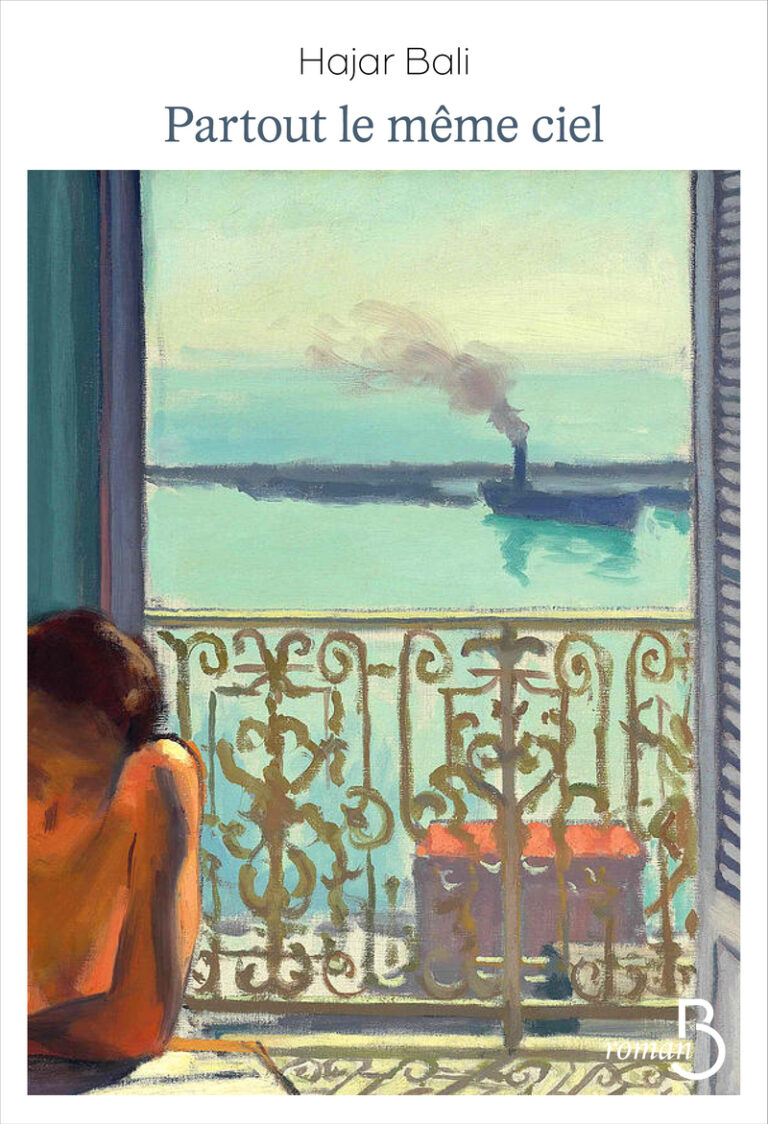Charlotte Gneuss, Les Jeux heureux de l’enfance, traduction de l’allemand par Rose Labourie, Les Argonautes, 09/01/26, 256 pages, 21€
Hiver 1976, à Gittersee, près de Dresde : du sang « noircit l’asphalte », un fil de fer traîne, un manteau entrouvert laisse deviner une main. Ce seuil, brutal, encadre tout le roman. En remontant le fil, Charlotte Gneuss raconte comment Karin, seize ans, bascule d’un été de désir et de mobylette vers une affaire d’État : Paul, son amoureux, se trouve happé par la suspicion de « Republikflucht » (fuite illégale vers la RFA), et l’appareil de sécurité transforme l’adolescence en terrain d’enquête. On convoque Karin, on éclaircit, on classe, on demande des noms, des détails, des loyautés. La jeune fille découvre alors une vérité corrosive : l’amour produit des traces, l’amitié dérape, la famille plie, la parole devient un objet qu’on manipule.
Gittersee en plein soleil, une respiration brève dans un pays qui écoute
L’été impose sa lumière jaune, ses champs de colza, ses chemins de traverse, et Karin y respire enfin. Paul arrive sur sa Schwalbe comme une promesse de mouvement, de peau, d’insouciance. Le mot qui circule entre eux, « aventure », porte une ivresse simple, presque enfantine. Le roman ose la sexualité au plus près, avec ses élans, sa crudité, sa honte parfois, cette manière qu’a le corps adolescent de vouloir tout vivre sans mode d’emploi.
Puis l’air change. Un détail se coince, un silence s’épaissit, un objet à cacher prend soudain une valeur disproportionnée. Dans une clairière, dans un repli du paysage, l’intime se charge d’une densité nouvelle, comme si l’été lui-même laissait entrer un autre régime, plus froid, plus procédurier. Karin sent la menace avant de la comprendre. Le monde, autour d’elle, écoute.
La vie en chemise cartonnée
La rentrée installe la bureaucratie au cœur du quotidien. Deux hommes, Hamm et Wickwalz, viennent, reviennent, posent des questions avec une politesse presque domestique. La table de la cuisine accueille le vocabulaire de la procédure. Wickwalz sort une chemise cartonnée, le nom de Karin s’y trouve, et l’existence prend la forme d’un dossier. Le roman fait sentir la violence spécifique de ce moment : une adolescente reçoit une identité administrative, et cette identité commence à réordonner sa vie.
Wickwalz travaille à la proximité. Il écoute, il console, il propose une aide qui fabrique une dette. Son ton s’enveloppe de chaleur pour mieux installer le rapport de force. Il lâche une phrase qui coupe net l’illusion d’un jeu social inoffensif : « Tu es déjà pratiquement considérée comme un Staatsfeind ». Il répète aussi, comme un refrain d’hypnose, « Réfléchis bien ». Le conditionnement passe par la répétition, par l’air de rien, par la mise en scène de la confiance.
Au même moment, le lycée et la bande d’amis deviennent un théâtre d’épreuves. Les humiliations circulent, l’alcool apparaît, la cruauté collective se forme, et l’amitié avec Marie se met à bouger, refuge un jour, foyer de turbulences le lendemain. Une formule tombe alors, sèche, implacable, et elle suffit à déplacer tout le décor mental : « Republikflucht. Présomption de fuite ». À partir de là, chaque parole risque de servir, chaque silence risque de peser.
L’enfance devient un exercice sous contrôle
L’hiver revient, et avec lui la sensation d’un monde qui se ferme. À la maison, Karin porte davantage : la petite sœur, la fatigue des adultes, l’autorité abrasive d’une grand-mère, l’instabilité d’un père. Cette charge accélère la fin de l’enfance. Dehors, la pression continue, régulière, précise, insidieuse.
Rühle, l’ami de Paul, prend une place lourde dans cette géométrie : figure de violence, de menace, de peur pure, il densifie le triangle Karin – Paul – Rühle sans que le roman cède à l’explication facile. Le système agit alors comme une chimie morale. Il ne se contente pas d’imposer la peur, il installe la confusion, il mélange protection et contrainte, il pousse les loyautés à se contredire, il transforme l’intériorité en pièce annexe du dossier.
Une phrase, prononcée par Rühle, retourne le titre avec une ironie de scalpel : « Eh oui, les jeux heureux de l’enfance ». Le livre tient dans ce retournement. L’enfance devient exercice, apprentissage, test. Et l’on continue à lire parce que la romancière donne à cette bascule une matérialité saisissante, colza, asphalte, chemise cartonnée, mots répétés, gestes surveillés, tout un monde où l’adolescence se vit sous lumière jaune, puis sous néon administratif, jusqu’au froid final du seuil.
Charlotte Gneuss impose une intelligence romanesque rare, attentive aux nerfs du quotidien, à la chimie des loyautés, à cette minute où la phrase privée se met à parler la langue d’un dossier. Elle construit une tension non par l’artifice, mais par la précision, la densité des signes, la justesse psychologique de Karin, exposée sans complaisance et sans mépris. La traduction de Rose Labourie mérite une mention particulière : elle restitue la rugosité, l’obsession des formules, la vibration sensuelle des étés, la froideur clinique des procédures, avec une tenue stylistique qui donne au texte français sa propre évidence. L’ensemble compose un premier roman saisissant, net, durable, qui laisse une trace longtemps après la dernière page.