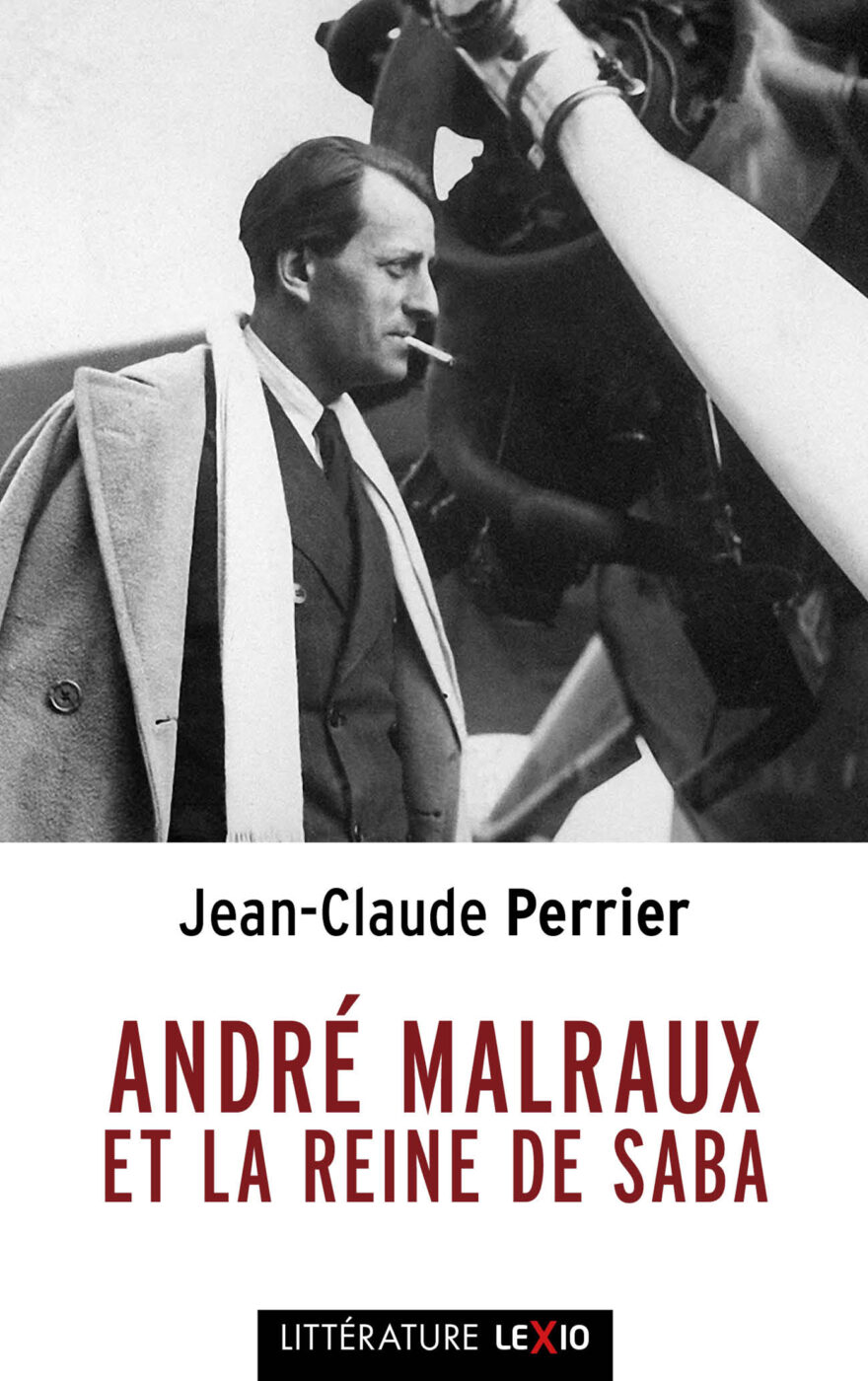Jean-Claude Perrier, André Malraux et la Reine de Saba, Le Cerf, 17/02/2023, 176 pages, 7€
Après nous avoir éblouis avec La Mystification indienne, où Octave Mirbeau inventait l’Orient depuis son cabinet parisien, Jean-Claude Perrier exhume une autre aventure paradoxale : au printemps 1934, tandis que l’Europe vacille au bord du gouffre totalitaire, André Malraux interrompt brutalement ses combats antifascistes pour partir au Yémen. À bord d’un Farman monomoteur, l’écrivain militant se mue en chasseur de mythes, traquant les ruines de la capitale de la Reine de Saba. Entre passé héroïque et présent fracassé, l’auteur tisse une méditation vibrante sur l’aventure géographique, la quête d’absolu et les civilisations englouties.
La tentation de l'Orient légendaire : Malraux et les civilisations disparues
Printemps 1934 : quand l'Europe s'embrase, Malraux s'envole
Jean-Claude Perrier ancre d’emblée son récit dans une double temporalité. D’un côté, le printemps 1934, moment où l’écrivain-militant, alors figure de l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires, délaisse provisoirement les tribunes politiques. De l’autre, notre présent mutilé par le terrorisme islamiste, où Palmyre et les Bouddhas de Bamiyan rejoignent le cortège des merveilles anéanties. Cette mise en miroir structure l’ouvrage entier : l’expédition yéménite de Malraux dialogue sans cesse avec le voyage de l’auteur lui-même dans cette région en 1997, quand le Yémen n’était pas encore ce champ de ruines bombardé que décrit l’épilogue.
L’auteur déploie avec minutie la genèse de cette fascination malrucienne pour les civilisations orientales. Dès sa jeunesse cambodgienne, l’écrivain manifeste cet appétit dévorant pour les vestiges monumentaux des empires disparus : l’art khmer, les traces gréco-bouddhiques d’Afghanistan, les splendeurs de l’Inde qui l’envoûtent. Jean-Claude Perrier montre comment cette passion archéologique, parfois cavalière dans ses méthodes (l’affaire Benteay-Srei plane en filigrane), irrigue toute l’œuvre à venir, du Royaume farfelu à l’Hommage à la Grèce de 1959, de l’appel pour sauver les monuments de Haute Égypte au sublime Roi, je t’attends à Babylone de 1973. La Reine de Saba s’inscrit ainsi dans une constellation obsessionnelle : Malraux collectionne ces toponymes chargés de songes, Ispahan, Samarcande, Trébizonde, Babylone. L’analyse révèle cette appétence comme la recherche d’une permanence artistique qui survivrait aux effondrements politiques, une manière de conjurer le temps par la beauté des vestiges.
André Malraux possédait certainement en mémoire l’extraordinaire découverte de Troie par Heinrich Schliemann en 1870. L’archéologue allemand avait eu l’audace de prendre Homère au pied de la lettre, utilisant l’Iliade comme carte au trésor pour localiser la cité mythique. Jean-Claude Perrier suggère que cette filiation hante le projet yéménite, mais il n’idéalise pas la comparaison : là où Schliemann fouillait méthodiquement pendant des années, Malraux survole en quelques heures, photographiant depuis les airs ce qu’il ne pourra jamais creuser. Le parallèle révèle moins une validation scientifique qu’une posture romantique, celle de l’écrivain qui veut transformer sa propre existence en épopée. Si les textes bibliques et coraniques relatifs à la Reine de Saba recèlent une vérité géographique, Malraux sera celui qui l’aura débusquée, fût-ce au prix d’une interprétation audacieuse des quelques colonnes ocre émergées du sable. L’auteur du livre montre ce glissement : l’écrivain français ne cherche pas tant à prouver qu’à incarner, à vivre le mythe plutôt qu’à le vérifier. Cette ambivalence face à la vérité historique traverse toute l’entreprise, oscillant entre enquête sérieuse et performance littéraire.
Pourtant, le printemps 1934 semble particulièrement inapproprié pour cette échappée romantique. André Malraux vient de plaider pour la libération de Dimitrov, le communiste bulgare accusé d’avoir incendié le Reichstag, il combat le fascisme italien, dénonce les prémices du nazisme hitlérien, alerte sur la déliquescence de la IIIe République après les émeutes du 6 février. Comment justifier cette parenthèse arabisante, cette fuite vers le mirage yéménite, alors que l’Europe s’embrase ? Jean-Claude Perrier n’élude pas le paradoxe : il le creuse, montrant que chez Malraux l’engagement politique et la soif d’absolu mythologique ne s’opposent jamais, mais se nourrissent réciproquement. L’homme refuse de choisir entre le combat immédiat et la légende millénaire, entre la barricade et le temple enfoui.
L'expédition comme aventure journalistique et mise en scène médiatique
L’un des apports majeurs de l’ouvrage réside dans son éclairage sur la dimension médiatique de l’entreprise. Jean-Claude Perrier révèle comment L’Intransigeant, commanditaire principal de l’opération, orchestre un dispositif de communication d’une modernité stupéfiante pour l’époque. Dès le 10 mars 1934, le journal publie le télégramme victorieux avec un titre fracassant : “André Malraux découvre et survole la capitale de la reine de Saba.” Suit une campagne de publicité élaborée, où l’architecte André-Pierre Hardy réalise des reconstitutions graphiques de la cité antique d’après les photos aériennes rapportées, tandis que le quotidien distille les récits au compte-goutte, créant une attente fébrile dans le public.
L’analyse de cette stratégie narrative dévoile une finesse remarquable. André Malraux et Édouard Corniglion-Molinier alternent la prise de parole dans les colonnes du journal, instaurant une polyphonie littéraire où le style épuré, presque sec du militaire aviateur contraste avec les envolées lyriques de l’écrivain. Le livre cite abondamment ces textes, restituant leur saveur d’époque. Corniglion se montre familier, pittoresque, amateur d’anecdotes sur les épagneuls des aviateurs italiens ou les réticences touchantes du mécanicien Maillard (“ce soldat romain”, selon Malraux) à rester au sol pendant le survol risqué. L’écrivain, lui, compose des pages habitées par les mirages, les tempêtes de sable, les sensations vertigineuses du vol, cette “participation des courants et des résistances” qui accrochent le pilote par “plusieurs de ses sens”.
Cette orchestration médiatique culmine dans la polémique archéologique internationale qui suivra. Les spécialistes contestent violemment les prétentions de Malraux, arguant qu’il n’a rien découvert, que Mareb était connue depuis longtemps, que ses photos aériennes ne prouvent rien. Le récit restitue ces débats sans complaisance, reconnaissant le caractère largement fantaisiste des “découvertes” archéologiques, mais soulignant combien cette controverse elle-même servit la publicité du récit. L’aventure géographique se doublait d’une aventure journalistique parfaitement maîtrisée, transformant une équipée hasardeuse en événement littéraire.
Vol au-dessus des ruines : le récit de l'expédition et ses périls
Jean-Claude Perrier restitue l’expédition elle-même avec un sens aigu du rythme et du suspense. Du décollage à Djibouti jusqu’à l’atterrissage de secours à Obock, en passant par les survols périlleux de Sanaa et de Mareb sous les tirs des tribus yéménites, le lecteur éprouve la précarité absolue de l’entreprise. Un Farman monomoteur sans radio, un seul pilote (Corniglion-Molinier) aux commandes durant des heures d’affilée, des réserves d’essence comptées, les tempêtes de sable, les coups de feu des Bédouins armés, les montagnes hostiles où un crash serait fatal, les vibrations inquiétantes de la carlingue. L’auteur sait rendre palpable cette fragilité existentielle, cette conscience permanente que la mort rôde à chaque instant dans le cockpit exigu.
Le moment de la « découverte » de Mareb, quand les trois hommes survolent enfin les ruines hypothétiques de la capitale sabéenne, donne lieu à des pages magnifiques où l’ouvrage laisse André Malraux déployer son lyrisme halluciné. Les colonnes rectangulaires ocre émergent des dunes comme des pylônes fantômes, vestiges énigmatiques d’une civilisation engloutie. L’écrivain veut croire qu’il contemple enfin les traces de Balqis, cette reine qui séduisit Salomon, dont les caravanes transportaient “tous les trésors de Golconde, de Mésopotamie, d’Égypte, du pays de Couch”. Les barrages en terre qui assuraient l’approvisionnement hydraulique de l’oasis antique ne sont plus qu’hypothèses fragiles, trous dans le sable pour d’éventuelles poutres. L’essentiel réside dans cette obstination à chercher, dans cette volonté de faire surgir du désert une incarnation tangible du mythe.
L’analyse souligne combien cette quête archéologique relève davantage de la projection mythologique que de la science rigoureuse. André Malraux ne veut pas vraiment prouver quoi que ce soit : il désire habiter le mythe, s’enivrer de cette possibilité que la légende biblique et coranique possède une incarnation géographique. Le livre rappelle que l’écrivain conservera toute sa vie cette fascination pour Saba, y consacrant vingt-quatre pages dans les Antimémoires, intégrant cet épisode au vaste édifice du Miroir des limbes. L’expédition de 1934 devient ainsi l’un des jalons d’une existence entièrement vouée à la métamorphose du vécu en légende personnelle.
Atterrissage dans un monde en flammes : la méditation contemporaine
Jean-Claude Perrier charge son récit d’une dimension tragiquement actuelle. L’épilogue, où l’auteur relate son propre voyage au Yémen en 1997, instaure un dialogue bouleversant entre deux époques. En 1997, le Yémen restait accessible, les risques limités à d’éventuels enlèvements par des tribus réclamant routes goudronnées ou kalachnikovs neuves, les otages généralement bien traités puis libérés. Aujourd’hui, le pays se déchire entre rebelles houtistes soutenus par l’Iran et forces sunnites armées par l’Arabie saoudite. Les bombardements ravagent le patrimoine architectural, Mareb elle-même subit peut-être la poudre des explosions, et “les avions qui fracassent le ciel ne sont sûrement pas pilotés par des écrivains farfelus en quête d’absolu”.
Cette phrase finale résonne comme un glas. Le livre dresse la longue liste des merveilles anéanties par le fanatisme contemporain : les Bouddhas de Bamiyan dynamités par les talibans, les mausolées de Tombouctou détruits par Aqmi, Palmyre ravagée et pillée par Daech. Ces destructions ne sont pas de simples analogies : elles révèlent une rupture historique profonde. Là où Malraux pouvait encore croire en 1934 que les vestiges du passé survivraient aux convulsions politiques, notre époque assiste à leur effacement programmatique. L’évocation de l’archéologue syrien Khaled al-Assaad, gardien des ruines de Palmyre durant quarante ans avant d’être décapité à 85 ans pour “s’être intéressé aux idoles”, cristallise cette bascule : le savant protégeant la mémoire universelle est devenu une cible. Face à cette barbarie systématique, Jean-Claude Perrier montre que la “possibilité de l’aventure géographique” s’est réduite, non par épuisement des terres inexplorées, mais par la violence qui les rend inaccessibles. Le tourisme de masse, la vulgarisation généralisée sur Internet, les restrictions économiques qui étranglent la presse écrite contribuent également à cette claustration, mais c’est le terrorisme qui frappe au cœur même du projet malrucien : la curiosité pour l’altérité culturelle.
"Envolez-nous" : conjurer la barbarie par le mythe
L’auteur pose alors une question vertigineuse : “le XXIe siècle sera-t-il culturel ou définitivement barbare ?” Cette interrogation, qui reprend et inverse la fameuse formule (apocryphe) attribuée à Malraux, traverse tout l’ouvrage. Jean-Claude Perrier montre que l’expédition de 1934, aussi “farfelue” fût-elle, incarnait une certaine idée de la culture occidentale : celle qui valorise la connaissance des civilisations autres, le respect des vestiges, la curiosité pour les mythes fondateurs de l’humanité. En traquant la Reine de Saba dans le désert yéménite, André Malraux manifestait sa foi en une culture universelle, transcendant les clivages politiques immédiats. Aujourd’hui, cette universalité se fracasse contre la fureur iconoclaste, la guerre civilisationnelle, le désir de table rase. L’ouvrage s’achève sur un appel vibrant : “De grâce, Malraux, envolez-nous.” Jean-Claude Perrier convoque l’écrivain comme une figure tutélaire capable de nous arracher momentanément à nos angoisses contemporaines, défendant l’idée que la culture, même incarnée dans ses manifestations les plus excentriques, demeure une forteresse assiégée mais nécessaire. En exhumant l’équipée yéménite d’André Malraux, il ne célèbre pas seulement une aventure révolue : il interroge notre capacité collective à préserver ce qui nous relie aux civilisations disparues, quand la destruction devient doctrine. L’auteur démontre une fois encore, après sa Mystification indienne, sa capacité exceptionnelle à éclairer les zones d’ombre de l’histoire littéraire tout en interrogeant les failles de notre présent.