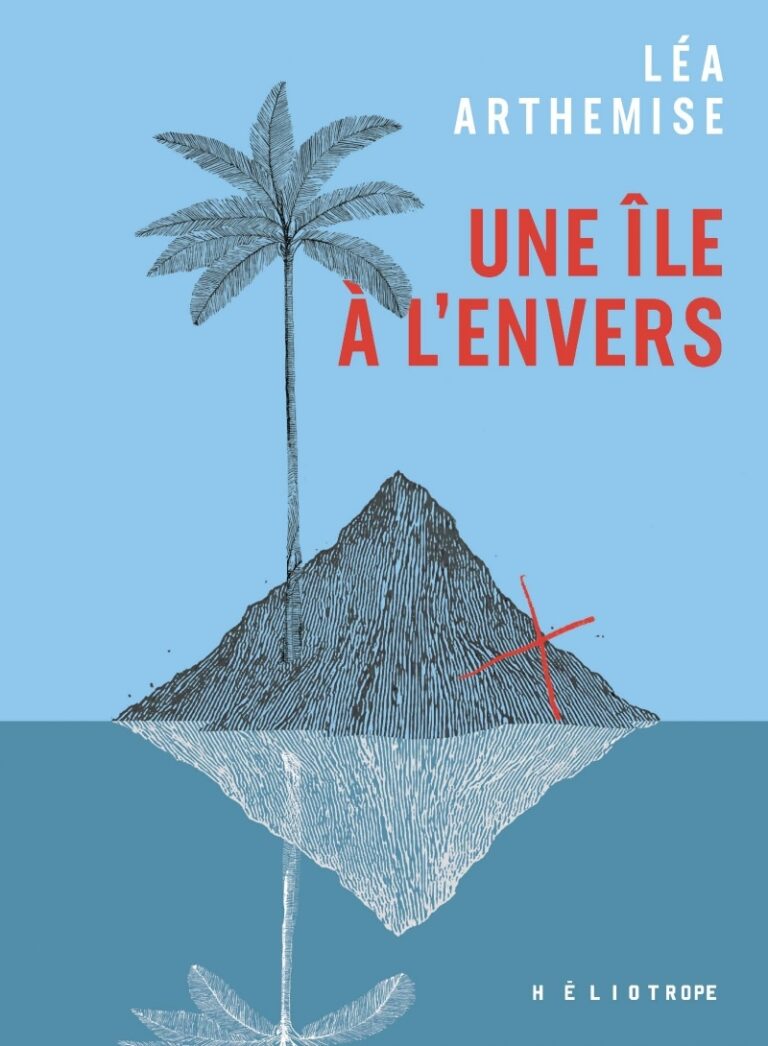Fawaz Hussain, Hier encore j’avais vingt ans, Éditions Zinédi, 15/01/2026, 150 pages, 14,90€
Soixante-dix ans, un matin de début d’été, dans un appartement du quartier des Fougères, porte des Lilas : Faramarz Hajari se réveille à onze heures, ce qui relève du prodige pour un homme que l’insomnie tire ordinairement du lit avant l’aube. Il se dit, d’une voix venue du fond d’un puits : “Joyeux anniversaire, Kurde errant, désormais septuagénaire et vieux schnock !” Tout le livre de Fawaz Hussain tient dans cette apostrophe à soi-même, où la tendresse se déguise en autodérision, où la mélancolie ricane pour ne pas pleurer, et où la colère gronde sous le burlesque.
Gambetta-Mésopotamie, aller-retour sans billet
Fawaz Hussain invente un personnage qui lui ressemble trait pour trait (Kurde de Syrie, arrivé en France il y a cinquante ans, ancien professeur, écrivain) et le promène dans un Paris populaire où chaque commerce, chaque silhouette croisée déclenche un souvenir, une digression, un vertige temporel. Le quartier Gambetta, le boulevard Mortier, le café-restaurant kabyle, La Petite Affaire avec ses produits en bout de course : Fawaz Hussain cartographie un Paris des étrangers qui vieillissent dans des immeubles où les Subsahariens côtoient les Kabyles, les Ukrainiennes, les dealers, les fantômes. La topographie parisienne se superpose à la Mésopotamie de l’enfance, cette ville ocre du nord-est syrien qui “ressemble à une tablette d’argile remplie de cunéiformes, soigneusement tracés par le calame du Tout-Puissant en personne”. Un figuier stérile, trois grenadiers aux grenades fendues, un puits tari : le village natal revient par fragments, avec une précision sensorielle qui doit autant à la mémoire involontaire qu’à la volonté farouche de ne rien laisser s’effacer.
Les rencontres composent une galerie que Fawaz Hussain croque avec un sens du détail comique et poignant à la fois. Le technicien kabyle Mohand porte sur ses épaules voûtées tout le massif du Djurdjura, répare les portables mais disparaît, rappelé par sa mère malade. Un compatriote kurde appelle depuis Lausanne pour vérifier que Faramarz n’est pas mort et confie qu’une soirée au café de Lawê Kewê, le fils de la perdrix, “vaut cent mille lacs de Lausanne”. La caissière ukrainienne de La Petite Affaire vieillit de dix ans en deux jours quand les chars russes entrent en Ukraine.
Le corps exposé, le rêve et la rugosité du monde
Le livre progresse au rythme d’un corps vieillissant que son propriétaire observe avec un humour féroce. Les exercices dans les squares (“je joue de mes deux bras, des deux côtés de ma tête, à la manière d’hélices”), les stocks de conserves accumulés dans la terreur d’une troisième guerre mondiale : Fawaz Hussain transforme les petites manies du septuagénaire en révélateurs d’une angoisse planétaire. Une paire de lunettes écrasées par inadvertance ouvre un chapitre où la myopie devient un filtre impressionniste qui embellit Paris et ses passantes.
Car il y a les passantes, au pluriel. Baudelaire traverse le livre comme un compagnon familier. Fawaz Hussain réécrit “À une passante” en version tragicomique de septuagénaire, et le récit assume crânement sa dimension charnelle : dans le métro nocturne, une inconnue androgyne aux bottes à paillettes exécute un grand écart facial pour dissiper les doutes anatomiques du narrateur médusé, scène extravagante où le désir, l’âge et le ridicule cohabitent sans filet. Cioran, convoqué deux fois, fournit la légende de cette timidité brûlante : “La timidité, source inépuisable de malheurs dans la vie pratique, est la cause directe, voire unique, de toute richesse intérieure”. Fawaz Hussain n’édulcore rien ; ses diatribes sur la littérature contemporaine (romans réduits à “l’inceste, les viols sur mineurs” et au “féminisme agressif”) et les épisodes de contrôle au faciès (un douanier dans un train pour Cologne, un vigile suédois) rappellent que le Kurde errant n’arpente pas un monde apaisé, et que la colère chez lui voisine avec la tendresse.
Un chapitre entier bascule dans le rêve éveillé, où la guerre est finie partout, où Israéliens et Palestiniens cohabitent en paix, où un Génie sorti d’une bouteille de la Seine exauce les vœux du narrateur avec un désinvolte “Hasta la vista, baby !”. Fawaz Hussain manie la fable orientale avec la décontraction d’un conteur de café qui sait que le conte dit plus vrai que le journal.
Retrouver sa fille, sceller le pacte
La grande affaire de ce livre, celle qui irrigue chaque page, c’est la solitude. Fawaz Hussain en explore toutes les textures : solitude du retraité dont le téléphone sonne rarement, solitude de l’écrivain qui écrit en français tout en rêvant en kurde, solitude du père séparé de sa fille depuis quinze ans. Car le chapitre le plus déchirant du récit propulse Faramarz Hajari en Suède, d’abord pour accompagner un frère frappé par la mort de son fils, ensuite pour tenter l’impossible : renouer avec cette enfant qui avait bloqué son numéro à l’adolescence. Un message envoyé depuis un jardin d’Uppsala, la réponse de l’ex-compagne cinq minutes plus tard, une chemise lavée et repassée avec un soin maniaque pour être “l’homme le plus présentable, le plus élégant de Stockholm” : Fawaz Hussain fait tenir dans cette séquence le deuil et la résurrection, le café amer servi dans des gobelets jetables et les roses achetées pour la nouvelle maman. À la cafétéria d’un musée stockholmois, la fille retrouvée porte dans ses bras un petit-fils au “plus beau sourire du monde”, et le narrateur imprime la scène “dans le tréfonds de mon âme” avant de repartir sans se retourner.
Ce fil familial réoriente la portée du pacte final. Une parabole orientale distribue les âges de la vie entre l’homme, l’âne et le chien, et conclut froidement que la fable “ne dit rien des septuagénaires car elle les voit déjà morts, enterrés et parfaitement oubliés”. Fawaz Hussain reprend à García Márquez sa devise : “Le secret d’une bonne vieillesse n’est rien d’autre que la conclusion d’un pacte honorable avec la solitude”. Mais le Kurde errant, lui, signe un pacte moins résigné. Il va chercher Cioran au cimetière du Montparnasse, se trempe sous l’averse d’un square pour communier avec Sohrab Sepehri et sa conviction que “La vie n’est qu’un baptême perpétuel”, et lève la tête vers les martinets, ceux que René Char voyait si “à l’étroit” au sol et dont le ciel sans horizon reste le royaume. Ces oiseaux qui filent à deux cents kilomètres à l’heure reviennent comme un motif obsédant : ils partent toujours et reviennent toujours. Quand ils s’en vont vers l’Afrique, les coquelicots cèdent la place aux chardons.
Fawaz Hussain confie ses feuilles volantes à Éole. Le lecteur les attrape au vol, et il lui restera longtemps dans les mains la chaleur d’une prose qui rit, qui boite, qui se souvient, qui s’emporte, et qui marche encore.