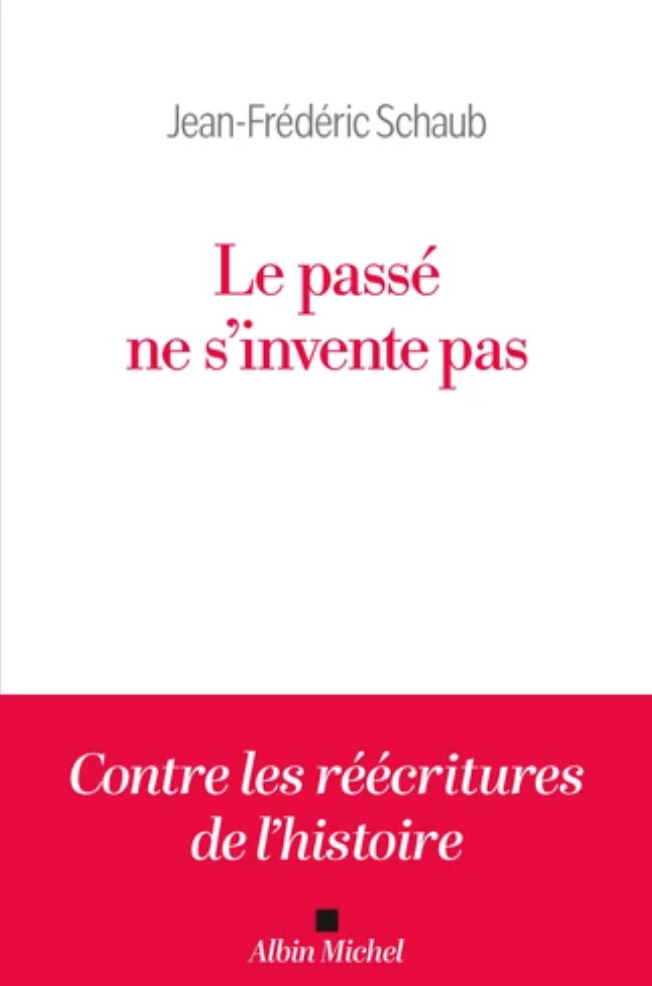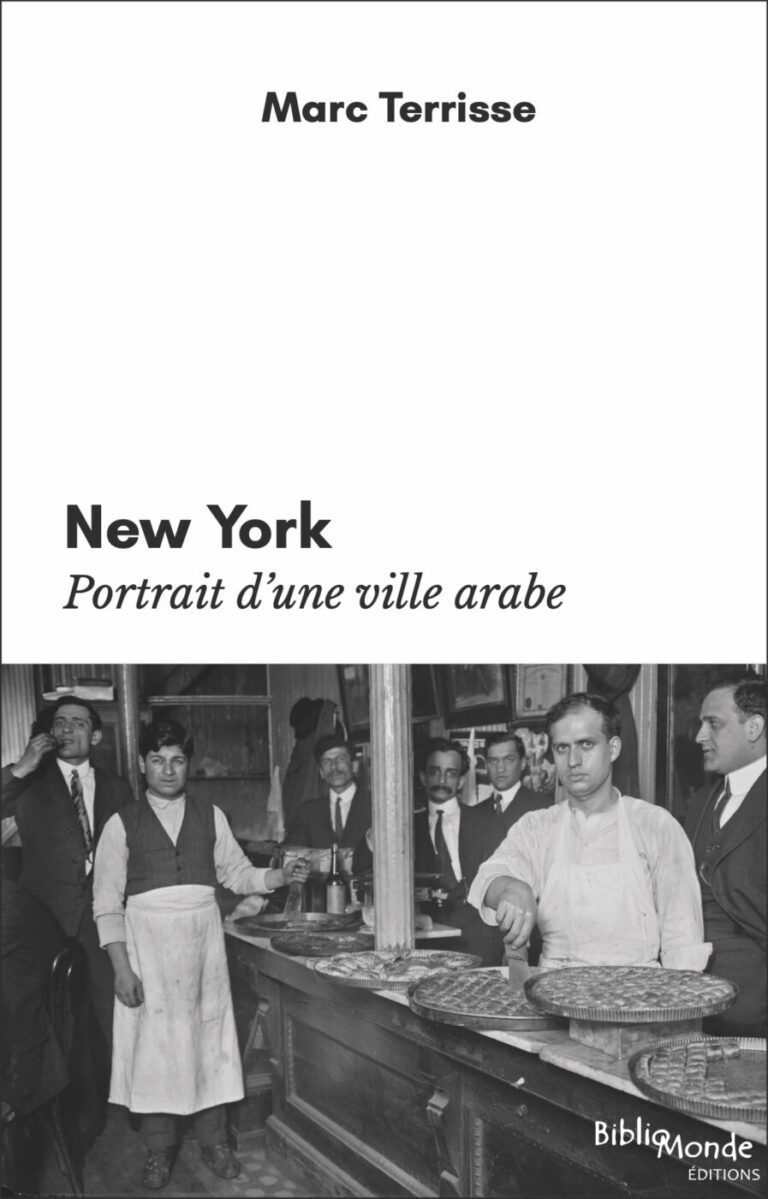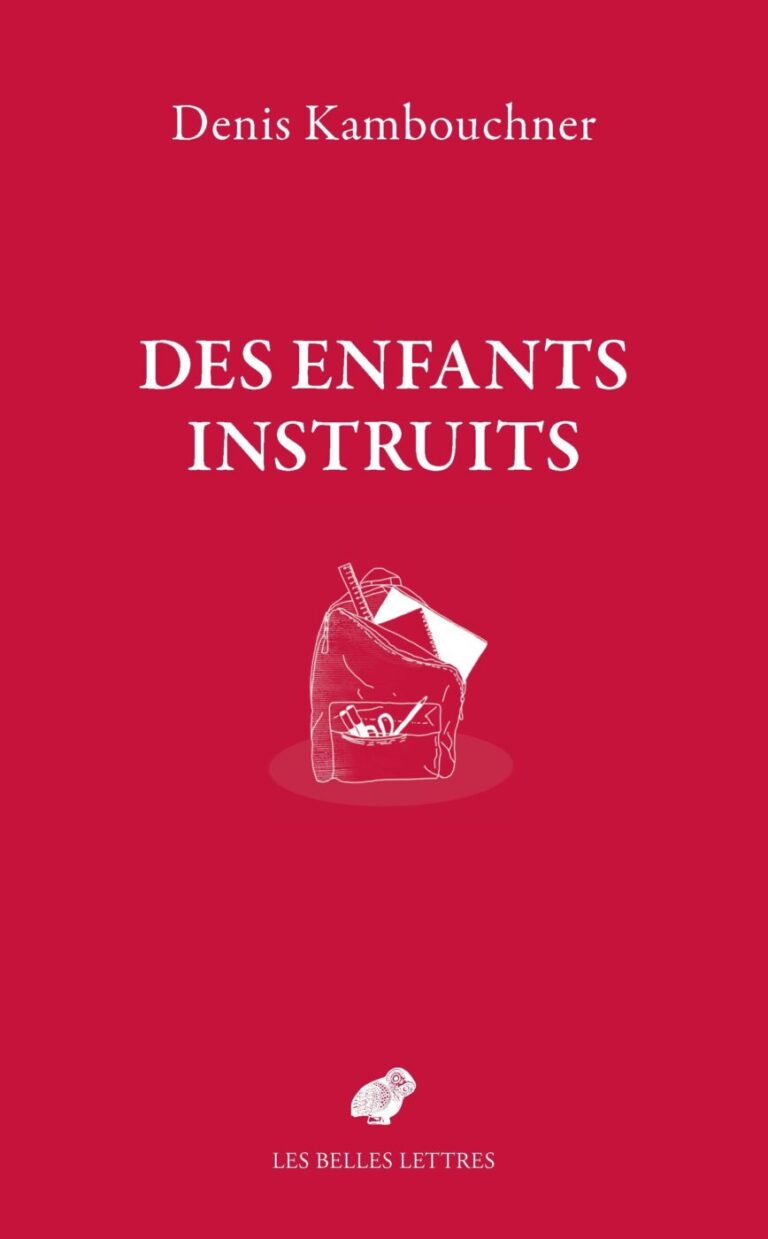Mentionner le prix Nobel de littérature obtenu en 1988 par Naguib Mahfouz, c’est reconnaître l’immense talent de cet écrivain égyptien né en 1911 et mort en 2006.
Ce fils de la petite bourgeoisie cairote a commencé à écrire à la sortie de l’adolescence jusqu’à être contraint à s’arrêter après avoir échappé à une tentative d’assassinat en 1994. Il ne s’était interrompu que pendant une période de trois ans après la révolution qui porta Gamal Abdel Nasser au pouvoir. Il manifestait alors sa profonde déception devant les promesses non tenues en matière de démocratie et de justice sociale.
Fin connaisseur des littératures étrangères, en particulier des textes du XIXe siècle, il a laissé à son pays une œuvre considérable, constituée de plus de cinquante romans et recueils de nouvelles.
Il fut celui dont Tahar Ben Jelloun a pu dire : “Comme Balzac et Zola, comme Tolstoï et Faulkner, Mahfouz a été le témoin de son époque, témoin à l’écoute de son peuple, celui qu’il côtoyait quotidiennement dans sa rue, dans son café.” Et Jacques Chirac, lui rendant hommage : “Il donna une notoriété universelle aux lettres égyptiennes et au vieux Caire de son enfance.”
Ses romans peuvent se classer en trois catégories. Les premiers portaient sur le règne des pharaons et ne rencontrèrent guère le succès. Les suivants se déroulaient dans un contexte contemporain. Enfin à partir des années 1980, ils prirent une inflexion plus philosophique et tendirent à exprimer, par la métaphore, sa critique du pouvoir.
Paru en arabe en 1983, “Le voyage d’Ibn Fattouma” appartient à cette dernière catégorie. Son titre semble calqué sur celui des voyages d’Ibn Battûta, célèbre explorateur et géographe (1304-1368) qui parcourut en 25 ans plus de 120 000 kms, de la Volga à Tombouctou et de Tanger à Quanzhou. Mais “Le voyage d’Ibn Fattouma”, lui, est imaginaire et se déroule dans le temps.
Le lecteur occidental sera enclin à faire le rapprochements avec “Les lettres persanes” de Montesquieu (1721), “Les voyages de Gulliver” de Jonathan Swift (1726) ou “Candide ou l’optimisme de Voltaire” (1759). Trois textes qui, sous une lecture distrayante proposent une satire du pouvoir et de la religion.
Naguib Mahfouz suit son anti-héros, le jeune Qindil Ibn Fattouma dans sa longue quête vers la mythique ville de Dâr al Gabal, cité de toutes les perfections, dont nul n’a de trace ni de témoignage.
Le très jeune homme s’est fait ravir la femme de sa vie. Déçu par sa famille et son pays, malgré les prières de sa mère, il veut partir. Avec, entre autres viatiques, sa foi et les sages enseignements du cheikh Maghâghâ al Gibeilî, il se joint à une caravane. Son intention est de traverser les contrées “païennes” à la recherche de la sagesse : “Je veux savoir et ramener le bon remède dans ma patrie malade” p 17. Son itinéraire le mènera à une étrange traversée du temps…
Dans sa première étape, il découvre une civilisation pastorale et primitive où règnent nudité et sens de la fête. Le peuple y est esclave au profit de quelques seigneurs. On vénère la lune dans de grandes orgies collectives. Qindil y fonde une famille, mais en sera banni pour avoir voulu enseigner les principes de l’Islam à son fils. Sa seconde étape lui révèle un royaume organisé et belliqueux, dont le souverain concentre les pouvoirs y compris religieux. Il se retrouve enfermé dans ses geôles pour avoir osé critiquer le dieu -roi.
Libéré au bout de vingt années de réclusion, il parvient enfin à Dâr al Halba, État laïque et démocratique qui proclame la liberté comme valeur sacrée, mais n’évite pas les conflits armés. Il va y refonder une famille. Toutefois l’envie de voyager le taraude… Il va donc reprendre la route après avoir croisé celle de son amour de jeunesse.
À Dâr Al Amân, il sera autorisé à séjourner dix jours : “Bienvenue au pays de la justice totale !” p 104.
La liberté individuelle y est punie de mort. La description des lieux et les comportements de la population rappellent les années glaçantes des totalitarismes… La dernière contrée traversée semble baignée parfaite plénitude. Les jours s’y écoulent entre méditation et travail accepté, sans recherche de rendement ni de récompense. Mais ce pays pacifique, d’influence soufie (ou bouddhiste ?), est voué à l’envahissement et ses occupants seront asservis. Le seul salut est dans la fuite et, Dâr al Gabal redevient le but de son périple.
Le conte s’achève sur une fin ouverte et une vision remplie de promesses…
Curieusement, vient à l’esprit, même si le rapprochement peut paraître insolite, le film de James Gray “The lost City of Z“, qui sortit de l’oubli profond de la forêt amazonienne l’explorateur anglais Percy Fawcett, disparu en 1920. Il est bien sûr permis de rêver puisque le genre s’y prête… La lecture du texte, avec ses multiples rebondissements, est particulièrement plaisante même si la morale reste sans appel. Aucune société, aussi évoluée soit-elle, n’évite la guerre. Elle l’impose ou la subit. Et la religion paraît mobile de conflits plutôt que vecteur de paix.
En choisissant de localiser l’action dans les méandres du temps, Naguib Mahfouz rend son texte universel.
Et la beauté de son écriture rend hommage à celles de son pays. L’auteur, qui voyagea si peu, sait si bien en parler à travers la superbe traduction de Martine Houssay :
La pénombre s’éclaircit et les prémices de la lumière promise pointèrent à l’horizon, se colorèrent d’un rouge plaisant. Le soleil leva un sourcil, diffusant sa clarté sur le désert infini. La caravane apparut, ligne dansante dans une étendue cosmique à la majesté imposante, sous les flots d’une lumière abondante, dans un flux d’air, une chaleur qui s’annonçait torride, et un paysage immuable, entre sables jaunes et ciel bleu azur.
Christiane SISTAC
articles@marenostrum.pm
Mahfouz, Naguib, “Le voyage d’Ibn Fattouma”, roman traduit de l’arabe (Egypte) par Martine Houssay, Actes Sud, “Sindbad”, 02/06/2021, 1 vol. (135 p.), 16€
Retrouvez cet ouvrage chez votre LIBRAIRE indépendant ou sur le site de L’EDITEUR
Feuilletez les premières pages en suivant ce LIEN