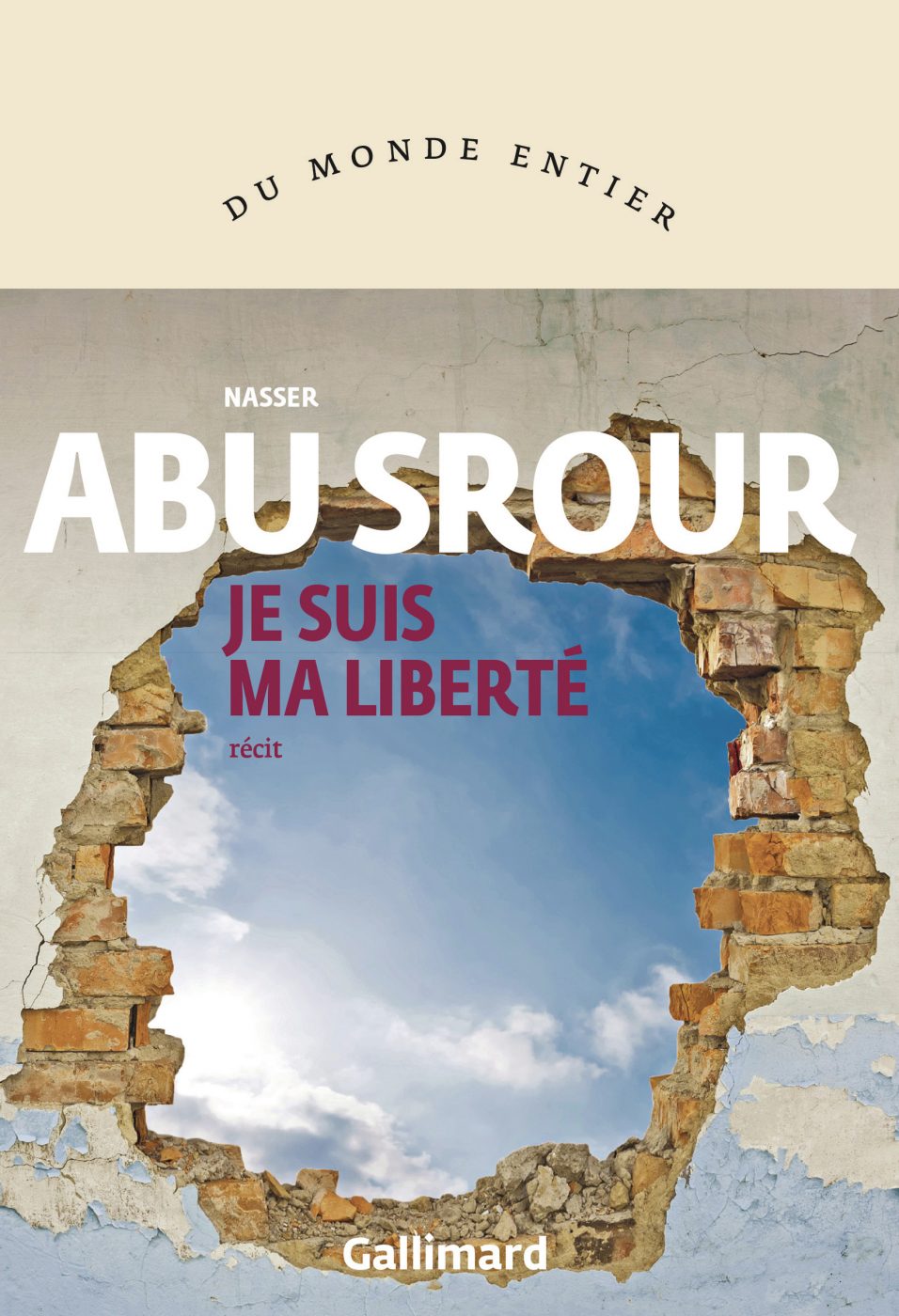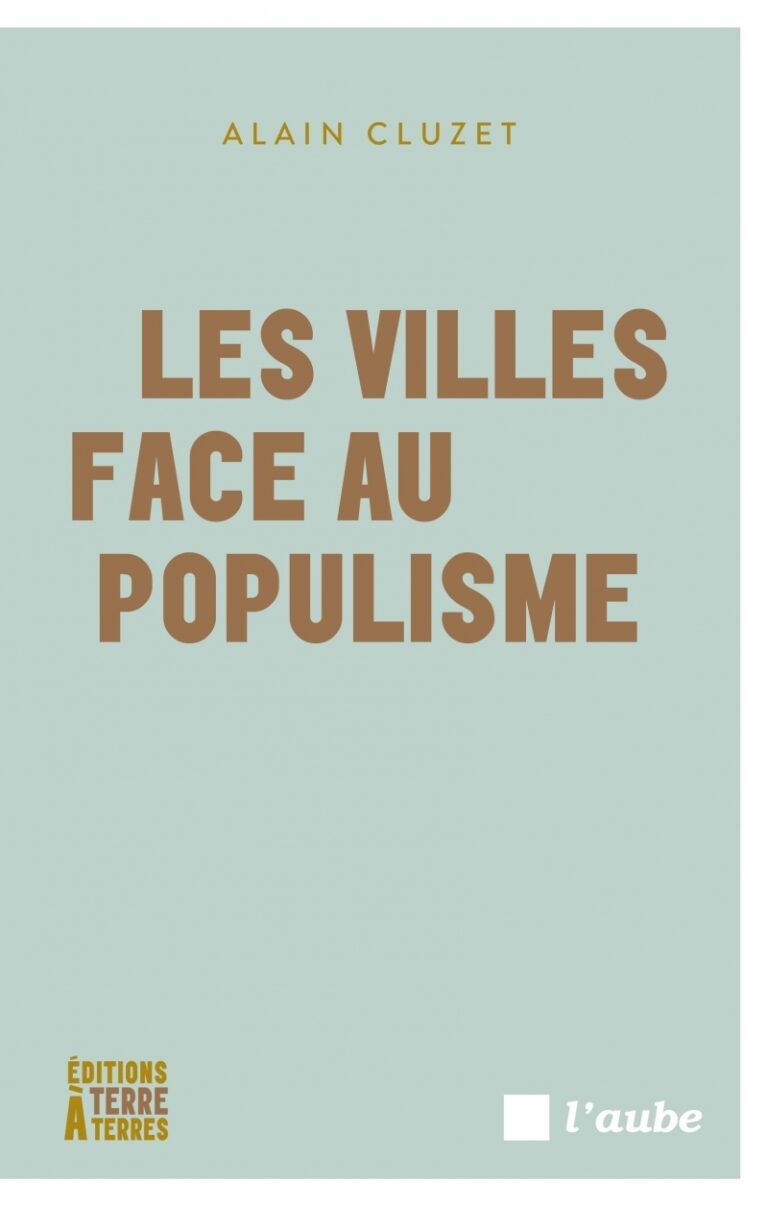Découvrez notre Podcast
Les Éditions Gallimard nous livrent un récit autobiographique de Nasser Abu Srour, prisonnier palestinien condamné à la perpétuité en Israël depuis 1993. Il est emprisonné, et fait de sa détention et de son environnement carcéral le sujet et le matériau même de l’écriture. Il se dégage de cet écrit fort et puissant, et tout aussi poétique, une authenticité. Il ne s’agit pas d’un témoignage “extérieur” mais d’une écriture depuis l’intérieur du mur. Le livre ne se contente pas d’une chronologie linéaire mais mêle narration autobiographique, poésie, méditation philosophique, réflexions politiques.
Le titre français Je suis ma liberté traduit l’original arabe (intitulé Histoire d’un mur : dans le récit, l’auteur fait du mur de sa cellule un interlocuteur, un miroir, une voix. “C’est l’histoire d’un mur qui m’a pris pour témoin de ses paroles et de ses actes” et “Je suis la voix de ce mur”. Il raconte son enfance dans le Camp de réfugiés d’Aïda près de Bethléem, son adolescence, son engagement dans la lutte palestinienne, puis son arrestation à la fin de la première Intifada, son incarcération, ses années de prison.
Le mur devient voix : introspection poétique d’un captif
Le livre est celui d’un auteur qui est enfermé depuis des décennies : la prison à vie, une cellule, des murs, et la solitude sont les lieux de son univers ; ce qui trouble forcément le lecteur rendant au texte une part forte et qui pourrait démobiliser… Le texte joue sur le symbolique et le métaphorique. Le mur devient personnage, témoin, interlocuteur. On passe de la narration à des digressions philosophiques, des poèmes, des réflexions. C’est aussi l’histoire collective du peuple palestinien, de la première Intifada, de l’enfermement, de l’occupation où émergent tour à tour, et parfois de façon interpénétrées la mémoire, la résistance, la désillusion, et l’espérance. Le mur, au niveau symbolique, peut aussi être lu comme celui de l’occupation, de la prison, de l’isolement. Sans doute y a-t-il ici un “double niveau” de lecture. Malgré l’enfermement matériel, l’auteur explore la liberté intérieure : comment on reste humain, digne, et créatif dans la souffrance et dans la privation de liberté matérielle ?
L’écriture comme refuge d’un captif aux pensées sans chaînes
Même si l’histoire se déroule dans un contexte très spécifique (prison israélienne, conflit israélo-palestinien), les thèmes qu’il aborde (la liberté intérieure, la résistance, l’écriture comme acte de survie, l’amour dans l’ombre de l’enfermement) ont une portée universelle. L’auteur nous donne à méditer sur la beauté du combat pour la liberté.
Nasser Abu Srour transforme l’espace carcéral en lieu de réflexion, de résistance intérieure, et d’écriture. Dans la cellule, même l’espace restreint devient vaste via l’imaginaire. Il mêle souvenirs, introspections philosophiques, poèmes, méditations sur la liberté, l’identité, et l’amour. Si la personnification du mur est poétique et originale, elle peut être aussi perçue comme abstraite. Le fait que le mur soit le narrateur, et que la voix soit métaphorique donnent à certains passages un caractère hermétique ou détaché du “réel” concret (prison, interrogatoire, cellule).
Le récit inscrit l’expérience personnelle dans un contexte collectif : l’enfance dans un camp de réfugiés palestinien, l’engagement dans la première Intifada, l’emprisonnement, la relation intime. L’ouvrage évoque inévitablement la question palestinienne, l’occupation israélienne, la prison, le conflit. L’auteur assume sa condition de prisonnier, de Palestinien. Ainsi, le roman est à la fois témoignage politique et introspection humaine. Il ouvre aussi à la réflexion : sur la liberté, sur l’enfermement, sur l’identité, sur la génération de l’Intifada, sur la dignité. Ce roman intervient donc dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Inévitablement, il comporte un positionnement implicite. C’est celui d’un prisonnier palestinien, de la lutte nationale, et d’une “mémoire réfugiée”. Ce n’est donc pas un texte neutre mais engagé.
Enfance, Intifada, prison : une mémoire palestinienne en résistance
Un ouvrage puissant, émouvant et exigeant. L’auteur ne se contente pas de raconter “ce qui s’est passé”. Il interroge, transforme, poétise l’expérience de l’enfermement, et fait émerger la liberté sous un mode qui lui appartient. Une nouvelle façon de dire… L’enfermement matériel devient un lieu de création. Une question est lancinante. Qu’est-ce la liberté quand on est privé de liberté ? L’auteur y répond à travers l’écriture du mur. Elle parle “par le mur”. Ce livre mérite d’être lu lentement, réfléchi, et relu. L’auteur pose des questions profondes sur l’être humain, la dignité, la résistance et la parole. Il aborde la question palestinienne via un témoignage personnel fort.
Un prisonnier palestinien raconte la lutte de tout un peuple
L’écriture comme acte de résistance, comme lieu de dignité. Elle devient la marque du peuple palestinien ; mais pourrait être rapprochée ici d’autres lieux de lutte pour sa liberté. Le mélange des genres, la densité de la réflexion, l’usage métaphorique intense rendent le livre puissant mais aussi parfois ardu. La traductrice, Stéphanie Dujols, l’admet : “Je n’ai jamais traduit un livre aussi ardu… un texte hors-genre”. La partie consacrée à l’histoire d’amour avec l’avocate (“Nanna”), ou la partie méditative peuvent sembler loin de l’univers de la « prison ». Il donne voix à un auteur qui, dans des conditions extrêmes (la prison à vie), a transformé l’enfermement en écriture. Il permet de réfléchir sur la liberté comme état intérieur. C’est aussi le lieu des choix. Il ouvre à la fois sur une histoire personnelle très difficile, et également sur une histoire collective arabe et palestinienne.
Le roman Je suis ma liberté de Nasser Abu Srour est un livre qui va au-delà du simple témoignage de prison. Il nous parle des conditions de détention dans les geôles israéliennes comme archétypes d’autres prisons. Celles-ci sont celles aussi de Salah Hamouri et de tant d’autres… de Ibrahim Abdallah et de Marwan Bargouti. C’est un récit qui raconte autrement une même histoire têtue, vraie, qui se répète et se prolonge. Un peuple toujours dans les fers qui appellent non seulement à une liberté mais simplement à vivre au-delà des murs visibles et invisibles.
Auteur
Nasser Abu Srour
Titre
Je suis ma liberté
Éditeur
Gallimard
Pages
304
Prix
22,50€
Traducteur
Stéphanie Dujols
Parution
16/01/2025