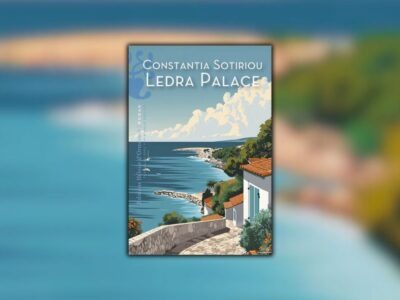Maïssa Bay, Entendez-vous dans les montagnes… : récit Précédé de Un long cri strident, Ed. de l’Aube, 25/08/2022, 10,90€.
Ce bref récit, dont le titre détourne un passage de La Marseillaise, revient sur un moment tragique de la vie de l’auteur, lorsque son père, instituteur en Algérie, est mort sous la torture en 1957, alors qu’elle n’avait que sept ans. Le texte est précédé d’un article publié dans Le Monde, le 18 mars 2022, “Pour moi, la guerre d’Algérie a commencé dans un long cri strident”, les quatre derniers mots servant de titre à cette sorte de prologue, publié en même temps que le roman, ou l’autofiction, dont le statut paraît difficile à définir, tant l’histoire recèle d’éléments autobiographiques. Une photographie sert de limite entre les deux, qui relèvent de deux pactes différents de lecture, et de deux genres littéraires. Il s’agit de l’unique photographie du père de Maïssa, debout sur une terrasse, avec la montagne pour fond, tenant dans les bras ces deux enfants. Le fait de sa rareté, et en même temps de sa banalité, une photo de famille heureuse, intensifie l’horreur du destin de ce père. Si le premier texte constitue un témoignage, douloureux et sincère, le second met en scène trois personnages, dont la confrontation dans le huis clos d’un train présente trois regards différents sur les événements du passé.
Trois personnages, réunis par le hasard romanesque
L’éditeur a choisi de présenter en miroir ces deux textes. Le premier, âpre et violent, s’ouvre sur l’image d’un visage, celui de la mère, « défiguré par la douleur », et l’écho de sons “des mots, des cris, mais aussi les bruits que font toutes les guerres et dont l’écho vrille la mémoire bien longtemps après qu’ils se sont éteints“. Mais celui qui émerge, tant par sa stridence que l’unicité de sa note, comme suspendue dans le temps, c’est cette phrase, aussi sobre que déchirante, que l’auteur croit encore entendre, plus d’un demi-siècle après : “Ils ont tué ton père !” Ce cri, ce traumatisme, sont à l’origine du livre, rencontre fantasmée entre un homme, une jeune fille et une femme d’un certain âge, dont l’identité se dévoilera peu à peu.
La première, la dame âgée, fait son apparition dans le wagon, et l’auteur, dont elle est l’alter ego, en livre une description dynamique. L’homme qui la rejoint se confond, dans son regard, avec une description de son père. Puis c’est le tour de la jeune fille. Les trois personnes, qui ne se connaissent pas, ont en commun le même désir de solitude et d’isolement. Rien d’autre, en apparence. Et pourtant, le livre révèle peu à peu le lien qui les unit, et dont elles prendront peu à peu conscience.
La plus âgée, qui semble invisible (ou du moins, c’est ce qu’elle ressent) se situe d’emblée comme une étrangère, comme le montrent ces divers étonnements, elle qui vient d’un pays où les mœurs sont différentes. Les autres ne manifestent rien, et c’est à peine si elles tentent de communiquer entre elles. Dans un autre passage, quelques pages plus loin, elle songe “C’est donc cela, la France…” avant de restituer, par le menu, une série d’images et d’impressions.
La prégnance du souvenir
La vision d’un paysage méditerranéen se dessine sous les paupières fermées de la narratrice, qui petit à petit accomplit un voyage intérieur. Un décor d’abord triste et stérile, presque postapocalyptique : “des étendues de terres rocailleuses, empoussiérées, balayées par les vents que rien n’arrête”.
Elle note aussi la présence des ronces, puis de cimetières sauvages :
Sur les terrains vagues aux abords des villes et des villages, semblables à des excroissances, des monticules entourés de pierres blanches ou grises entassées sans soin, pour délimiter les tombes qui remplissent les cimetières sans haies ni clôtures dans les campagnes de son pays.
L’image de la mort, amenée par l’absence de couleur, la dimension minérale du paysage et la présence de ces tombes, est relayée par la vision des “géraniums ensauvagés qui poussent et fleurissent sur les tumulus”, et dont “les éclaboussures rouges”, sans que ce soit dit dans le texte, évoquent inévitablement le souvenir du sang.
L’évocation devient une voix intérieure, celle du père, retranscrite en style direct, et matérialisée par la présence d’italiques, qui décrit une colonne de soldats. À nouveau, le sonore accompagne le visuel, avec les ordres martelés, et la retranscription des paroles de chants militaires comme Le chant des Africains, composé par le capitaine de l’armée française Félix Boyer, et destiné aux troupes coloniales, qui avait été repris pendant la guerre d’Algérie par les pieds-noirs et les partisans de l’Algérie française. Il est suivi de La Marseillaise, dont l’auteur choisit précisément le passage, qui revêt ici une signification particulièrement forte : “Entendez-vous… dans les campagnes, mu-u-u-u-gir ces féroces soldats…” et qu’elle revisite avec une ironie tragique.
Le partage d’un vécu, plus ou moins commun
C’est un incident (une femme criant au voleur et accusant des Arabes) qui permet enfin aux trois personnages d’entrer en contact. L’homme commence. Il se présente et parle de l’Algérie. Le désir de l’évoquer est aussi motivé par les années noires, qui pèsent sur la population et suscitent les interrogations des autres voyageurs. Pour lui, c’est le souvenir de sa vie là-bas, pas vraiment celle d’un touriste, enivré d’exotisme, comme elle l’imagine, mais les dix-huit mois qu’il a vécus en tant qu’appelé. Un autre point de vue, présenté lui aussi sous forme d’italiques, que l’on pourrait juxtaposer au précédent. Au fantasme de la scène d’exécution de son père par la narratrice, s’ajoutent les souvenirs de cet homme, et ceux du grand-père de Marie, la jeune fille.
Et voilà ! La boucle est bouclée ! Une petite fille de pieds-noirs, un ancien combattant, une fille de fellaga. C’est presque irréel. Qui donc aurait pu imaginer une scène pareille ?
Cette scène, où il ne manque qu’un harki, dit-elle, la narratrice se la représente comme une séquence de télé-réalité, attendant la révélation finale, et c’est précédemment ce qui va se produire.
Un livre bref et dense, à travers laquelle l’auteur revisite un traumatisme majeur, l’exécution de son père. Le récit, qui pourrait obéir à la règle classique des trois unités, temps, lieu, action, bien qu’il soit traversé de flash-back, revêt une intensité tragique. Le personnage de la narratrice, double de l’auteur, bouleverse par sa force, sa dignité et sa douleur. Un beau texte, qui parle de racisme, d’injustice, mais surtout des ravages de la guerre. Maïssa Bey décrit une Algérie blessée, sur laquelle la guerre d’indépendance et les années noires ont laissé des cicatrices. Un roman poignant.

Chroniqueuse : Marion Poirson -Dechonne
NOS PARTENAIRES
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.