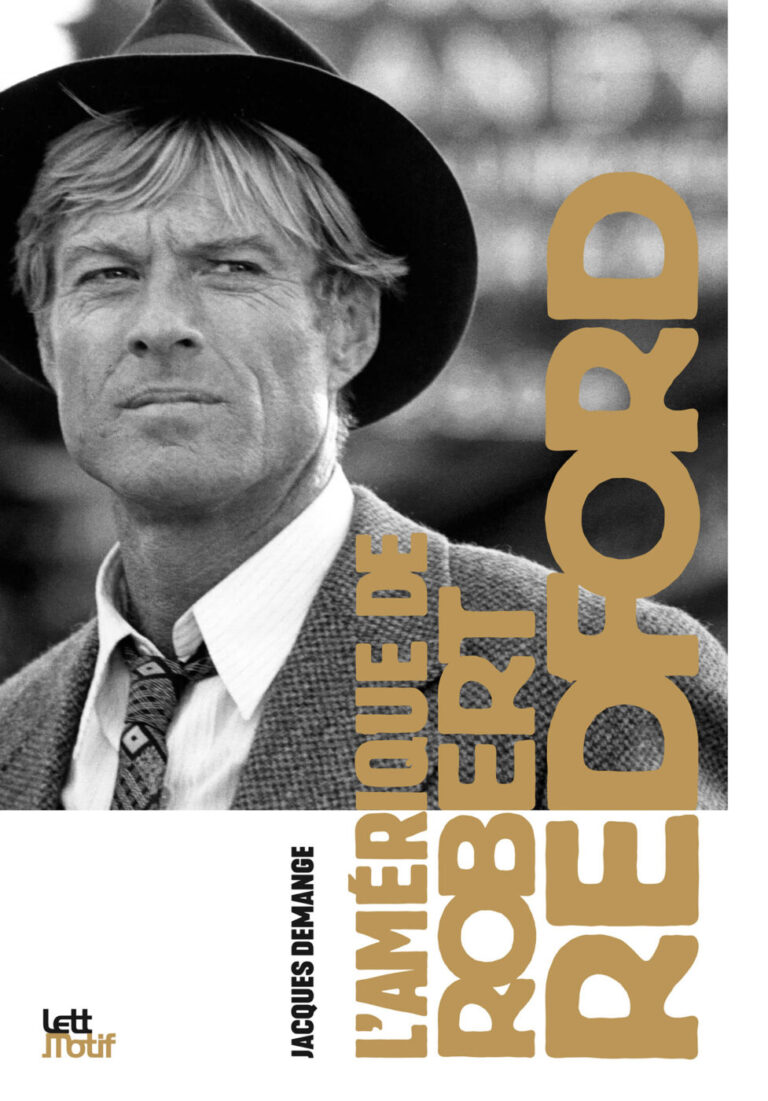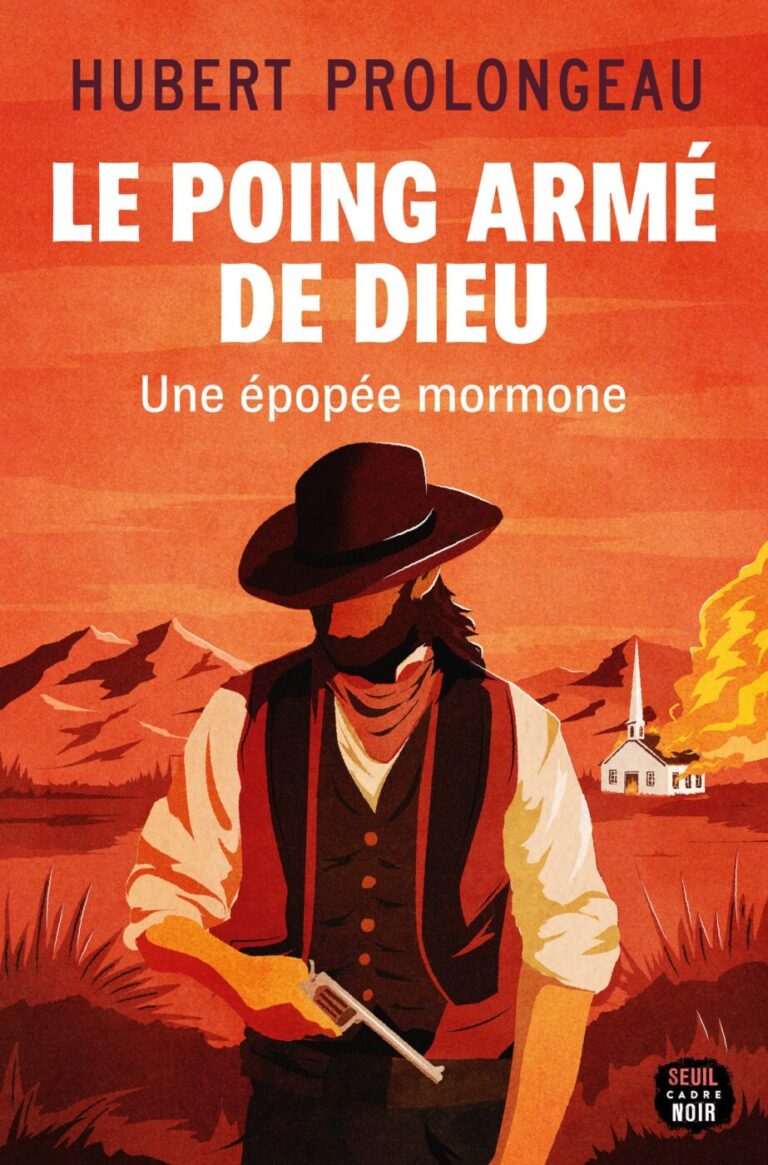Avec son “Histoire de la souffrance” (Gallimard), le romancier et philosophe Tristan Garcia a entrepris la rédaction d’une ambitieuse trilogie sur l’évolution de l’humanité, au travers de multiples récits constituant un voyage à travers les temps et par le vaisseau des âmes. Après la publication des deux premiers volumes – Âmes en 2019 et Vie contre vie en 2023 – l’auteur qui est à la mi-chemin de l’écriture du troisième tome nous a accordé un entretien exceptionnel.
L’occasion rare d’évoquer la place de la métempsycose dans son œuvre, de la cruauté et de l’altérité dans la littérature, et de son regard de philosophe sur l’époque actuelle.
Olivier Amiel : Le thème de la métempsycose, la réincarnation de l’âme, revient beaucoup dans votre œuvre. Dans 7 (Gallimard, 2015), mais aussi bien sûr avec le cycle des âmes colorées que vous avez lancé dans votre “Histoire de la souffrance”. Est-ce un intérêt philosophique voire religieux ou simplement un intérêt narratif ?
Tristan Garcia : C’est toujours étrange de voir grâce à un lecteur un motif obsessionnel alors que c’est un point aveugle du point de vue de l’écrivain… Je n’ai aucune croyance religieuse ni autour de la métempsycose ni une forme de réincarnation. Je n’y crois pas. Je n’ai pas un intérêt intellectuel très fort pour ça, même si j’ai lu un petit peu de pensée indienne par curiosité, c’est quelque chose que je connais un petit peu et qui m’a intéressé, mais je n’ai pas d’intérêt particulier pour des pensées ésotériques ou des traditions même grecques, orphiques par exemple autour de ça. Alors je vais essayer de répondre honnêtement, parce que c’est un point aveugle. J’y crois littérairement. J’y crois quand je raconte des histoires, pas autrement, parce que j’ai l’impression que c’est une des formes qui me permet d’échapper à quelque chose qui me fait me sentir un petit peu à l’étroit, disons dans une tradition du roman que j’aime, mais dont j’aimerais m’échapper, qui serait strictement française ou européenne. L’idée selon laquelle le roman serait centré sur la biographie individuelle et au mieux familiale. Quand on raconte une histoire, on raconte globalement ce qui se passe entre la naissance et la mort d’un individu. Parfois, c’est soi-même, c’est de l’autofiction, des mémoires. Et puis, quand on essaie d’aller vers une grande forme, on utilise la famille. Je pense à des grands romans européens comme Les Buddenbrook de Thomas Mann sur trois générations, ou évidemment chez Zola, régulièrement chez Balzac.
Je compare le fait d’écrire un roman à de la tapisserie : il faut tenir un fil. Il faut tenir un fil et à travers des motifs différents. Mais ce fil qu’on tient dans un roman, c’est une vie. Et je me sens à l’étroit dans une forme romanesque qui ne raconterait que ce qui se passe à l’intérieur d’une vie individuelle ou éventuellement d’une vie familiale. Et donc je pense que de manière un peu obsessionnelle, je retrouve des hypothèses de métempsycose parce qu’elles me permettent de passer, de faire passer mon fil de vie en vie, soit sur un même personnage, avec des variations de motifs comme dans 7, en faisant revivre un certain nombre de fois des événements à un même personnage, soit d’époque en époque, de période en période, de culture en culture, comme dans les volumes de “Histoire de la souffrance”. Mais même au fond, dans Faber, avec l’idée d’être habité par un démon.
Ce sont donc des choses auxquelles je ne crois pas du tout d’un point de vue religieux, ni même philosophique, mais qui me semblent donner de la puissance aux récits parce qu’elles permettent d’excéder une vie, de passer de vie en vie, de faire passer le fil du roman de vie en vie.
Par contre je crois qu’il y a un lien dans l’espèce humaine en tout cas entre le fait de raconter et les premières religions. À partir du moment où se sont développées des formes religieuses probablement très tôt au paléolithique, ça a été accompagné par des formes de récits. Je crois à des hypothèses historiques et anthropologiques qui disent que le religieux émerge en même temps que la capacité à raconter des récits chez l’espèce humaine, parce que pour juger une vie, pour savoir si une vie a été bonne ou mauvaise par exemple, il faut la raconter. Il faut mettre en récit, il faut résumer une vie, il faut arriver à la raconter, à la présenter, pour l’évaluer, pour la juger. C’est aussi une forme judiciaire qui apparaît avec la question du jugement, d’un dieu ou de plusieurs dieux. J’ai beaucoup d’intérêt pour toutes formes de croyance humaine, mais je crois à la fiction plus qu’à la religion. Écrire me fait retrouver des formes qui sont comme la métempsycose, des formes sociales partagées par beaucoup de cultures humaines. Pour tout vous dire, je n’y pense pas et c’est simplement au moment de raconter que cela prend ces formes-là sans que j’y réfléchisse.
Olivier Amiel : Très souvent, que cela soit dans les volumes d’”Histoire de la souffrance” ou dans le reste de votre œuvre, les personnages semblent tous accepter leur sort de bonne grâce, dans une sorte de fatalisme. Peut-on y voir un trait de votre propre caractère ?
Tristan Garcia : Ça aussi, ce n’est pas quelque chose qui est conscient pour moi. Dans ces récits historiques, ce qui m’intéresse, c’est toujours, de mon point de vue en tout cas, d’essayer de me plonger dans une époque, dans un moment de l’Histoire et de ne pas être surplombant, d’être avec les personnages, avec leurs croyances, avec leur manière d’être, leur manière de faire. C’est ça qui me plaît. C’est cet effet d’immersion, en tout cas dans l’écriture qui m’intéresse, sans jugement anachronique. J’ai l’impression comme écrivain, de me sentir à la fois dans une époque, dans une histoire donnée, comme dans une prison, ça revient souvent… Ils sont souvent enfermés, emprisonnés et tentent de trouver un trou de souris, une forme d’espérance, juste un tout petit quelque chose qui est de penser à la génération suivante ou à autre chose. Et hop, de passer dans une autre époque, qui garde un tout petit quelque chose des époques précédentes. Un souvenir, un objet, une trace. Pas grand-chose. Il y a peu de choses qui se transmettent en fait dans l’Histoire, mais c’est ce que ça fait de ces personnages des sortes de fatalistes, de stoïciens acceptant le destin. J’aime bien aussi les personnages de révoltés pour qui c’est perdu d’avance et qui se révoltent contre le monde, contre le destin, contre ce qu’ils ne peuvent pas changer. J’ai l’impression d’osciller entre ces deux positions. Un amour romanesque pour ces deux types de personnages de formes d’humanité différentes, en les aimant tous.
Je dissocie totalement en tout cas mon caractère de mon goût pour ces personnages. Et je ne crois pas être un être fataliste, plutôt volontariste.
J’ai toujours l’impression que le roman, est une forme particulière un peu mélancolique, un peu automnale, parce que quand on raconte une histoire, on voit le monde un petit peu à distance depuis la fin des choses. On raconte une histoire et quand on l’écrit on sait qu’il y aura une fin à cette histoire. Et pour moi en tout cas, ça fait que dans le roman, se cultive un peu plus ma fibre mélancolique qui n’est pas du tout mon être.
Le roman n’est pas l’expression du romancier. Le roman est comme un vaste milieu dans lequel on plonge les choses, on plonge les êtres et ça leur donne une teinte, une couleur peut-être. Comme un jardin ou un vaste bassin ou un ensemble de culture où j’essaie de faire pousser des choses et que je regarde. Ce n’est pas un miroir comme chez Stendhal, ce n’est pas moi.
Olivier Amiel : Il y a forcément beaucoup de descriptions de la cruauté humaine dans “Histoire de la souffrance”, quelle part d’altérité y voyez-vous ? Doit-on se mettre à la place de celui qui souffre comme celui qui fait souffrir ?
Tristan Garcia : Dans tous mes textes depuis Faber, mais même avant depuis La meilleure part des hommes, écrire la cruauté est pour moi en général une épreuve… Je n’ai jamais trouvé de joie sadique à torturer mes personnages. En général je souffre avec eux… Dans La meilleure part des hommes, le personnage de Willy a sans cesse mal aux dents et je me souviens d’avoir eu mal aux dents avec lui ! Dans la forme romanesque, il y a un moment où le fait de créer des vies produit une sorte d’hubris de créateur qu’il est très difficile d’éviter, on se représente comme une sorte de Dieu vis-à-vis des personnages dont on agite les destins, qu’on fait naître et qu’on fait mourir. C’est un vieux problème de responsabilité du romancier et je ne suis pas à l’aise avec cette démiurgie-là, et surtout quand il s’agit de cruauté et de faire souffrir. Et pourtant, c’est au cœur de beaucoup de livres que j’ai écrit…
Pour moi, c’est toujours de l’altérité. C’est-à-dire j’ai toujours un rapport aux personnages, ce sont des “autres”. Je ne m’y projette pas. Je les vois comme des êtres qui pourraient être des amis, des parents lointains. Je me pose toujours des questions morales dans l’écriture. Je n’ai pas l’esprit religieux. La science pour moi ne suffit pas. C’est une connaissance évidemment en psychologie évolutionniste, mais ça reste au-dehors, ça ne rentre pas dans les vies. Et la possibilité de la fiction c’est de faire semblant d’être avec des vies qui se sont développées, qui ont souffert, qui sont mortes, qui ont été oubliées. J’aimerais avec la fiction les accompagner dans un récit qui n’est ni scientifique ni religieux, qui est le seul moyen juste pour moi de rendre justice à la vie et à la part de la vie qui a toujours souffert et qui continue de souffrir.
J’ai une fascination pour ce couple étrange que forment la vie et la souffrance.
Olivier Amiel : Vivons-nous réellement la parabole des Hémisphères avec le cloisonnement des idées dans des bulles séparées comme dans un des récits de 7 ?
Tristan Garcia : Ça me semblait une allégorie un peu lointaine, mais qui se rapproche… C’est en train de se réaliser dans des espaces géographiques aussi. Ce n’est pas seulement des cloisonnements d’idées. Je me souviens quand j’étais lycéen, j’étais toujours étonné dans les livres d’histoire géographie, je regardais les pages sur la géographie urbaine américaine et je trouvais ça toujours très étonnant la division entre uptown, downtown… Une ville américaine avec le centre-ville qui est déserté, appauvri. C’est un espace qui est aussi très communautarisé. Un certain nombre de villes moyennes françaises se mettent à ressembler à ça avec un centre-ville qui se nécrose. Et puis il y a des espaces communautarisés qui sont très nets. On parlait déjà un peu de ghettos en France dans les années quatre-vingt, mais c’était moins net. D’ailleurs des ghettos qui ne sont pas seulement là où on les attend, je pense par exemple aux polémiques récentes sur l’enseignement privé aussi, ce sont des formes de ghettoïsation ou d’entre soi de classe sociale, qui concernent aussi bien la classe sociale que l’appartenance ethnique, religieuse… Et oui, ça ne va pas jusqu’à ce que ce que je me représentais dans la nouvelle hémisphère dans 7. C’était encore une fois la mélancolie, avec ce que pouvait devenir un personnage universaliste qui devient une sorte de fonctionnaire tout seul et qui est condamné à passer d’un hémisphère de croyance à un autre… Je crains que la destinée de ce type de croyance universaliste soit d’établir soi-même une sorte d’hémisphère qui devient l’hémisphère de l’universel et qui en devient un parmi d’autres, soit d’habiter un espace un peu déserté entre des croyances, chacune renfermées sur elle-même et sur ses propres principes.
C’est pour ça que, d’un point de vue philosophique, je me présente comme un universaliste contrarié. J’ai l’impression que le dilemme de l’universalisme, c’est soit d’habiter un espace déserté entre les croyances des uns et des autres, soit d’être dans une bulle de croyances comme les autres, tout en croyant englober toutes les autres, mais n’en étant qu’une parmi d’autres en fait…
Olivier Amiel : Vous avez une écriture très cinématographique et pourtant il n’y a jamais eu d’adaptation, est-ce un refus de principe de votre part ?
Tristan Garcia : Les droits de certains livres comme 7 ont été achetés, mais les projets n’ont pas aboutis ou sont en cours… rien n’est perdu. Il y avait un projet sur la nouvelle qui s’appelle L’existence des extraterrestres. J’y tenais beaucoup et puis au dernier moment dans le financement, ça ne s’est pas fait. Mais je trouvais que le réalisateur avait fait un travail d’adaptation qui me plaisait beaucoup.
Je refuse seulement de participer à l’adaptation. Parce que quand un texte est fini, j’ai l’impression d’être un forgeron face à un métal qui a trop refroidi et j’ai l’impression qu’il n’est plus suffisamment malléable. Et quand le livre est publié, il devient froid pour moi et j’aurais peur de le cabosser.
Olivier Amiel : Mais vous n’avez pas peur que les autres le cabossent ?
Tristan Garcia : Ah ça m’embête moins en fait ! Ça peut paraître étrange, mais je n’ai pas de possessivité. Une fois qu’un texte est publié, je l’oublie même en grande partie… Il y a une sorte d’effet d’amnésie. Je me souviens de ce que j’ai voulu faire mais pas de ce que j’ai fait. Et puis il y a un effet de deuil, le texte est mort pour moi, il appartient vraiment au lecteur. Je ne me sens aucun droit dessus.
C’est quelque chose avec ses qualités et ses défauts mais qui ne m’appartient plus et ça ne me gêne pas que quelqu’un s’en empare et en donne sa lecture, en fasse une adaptation. Mais moi je ne saurai pas y revenir en tout cas. Je le vois comme sur un lointain rivage.