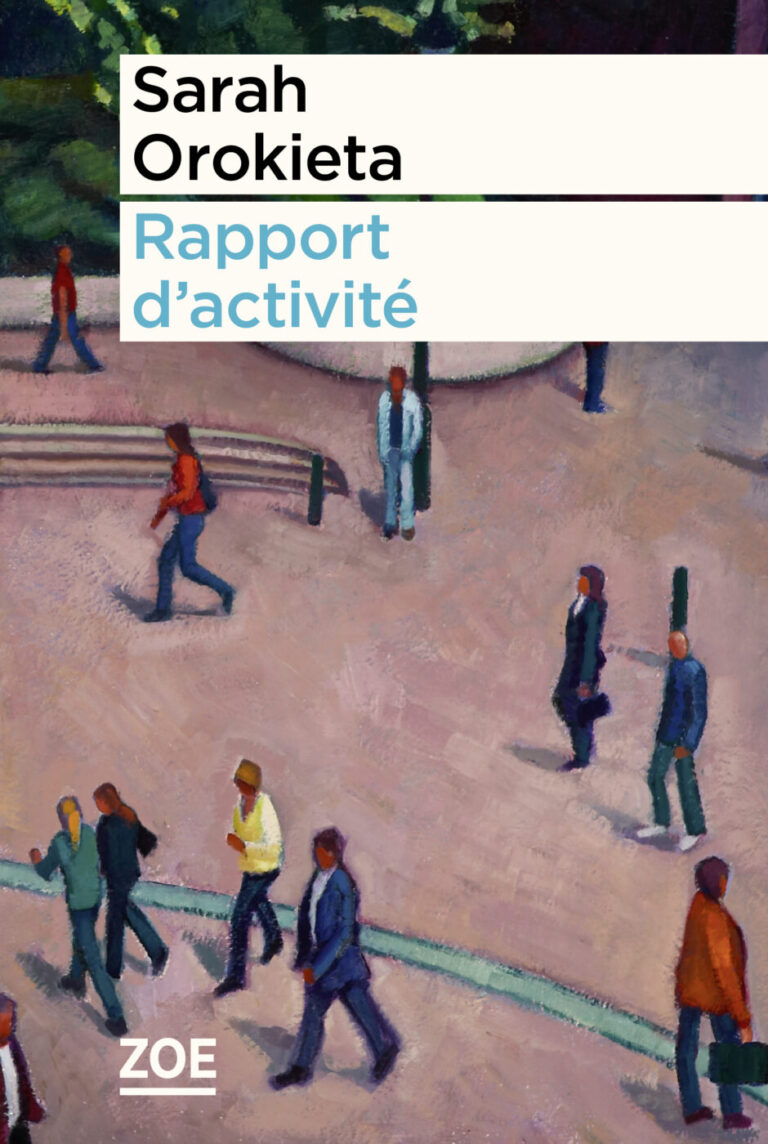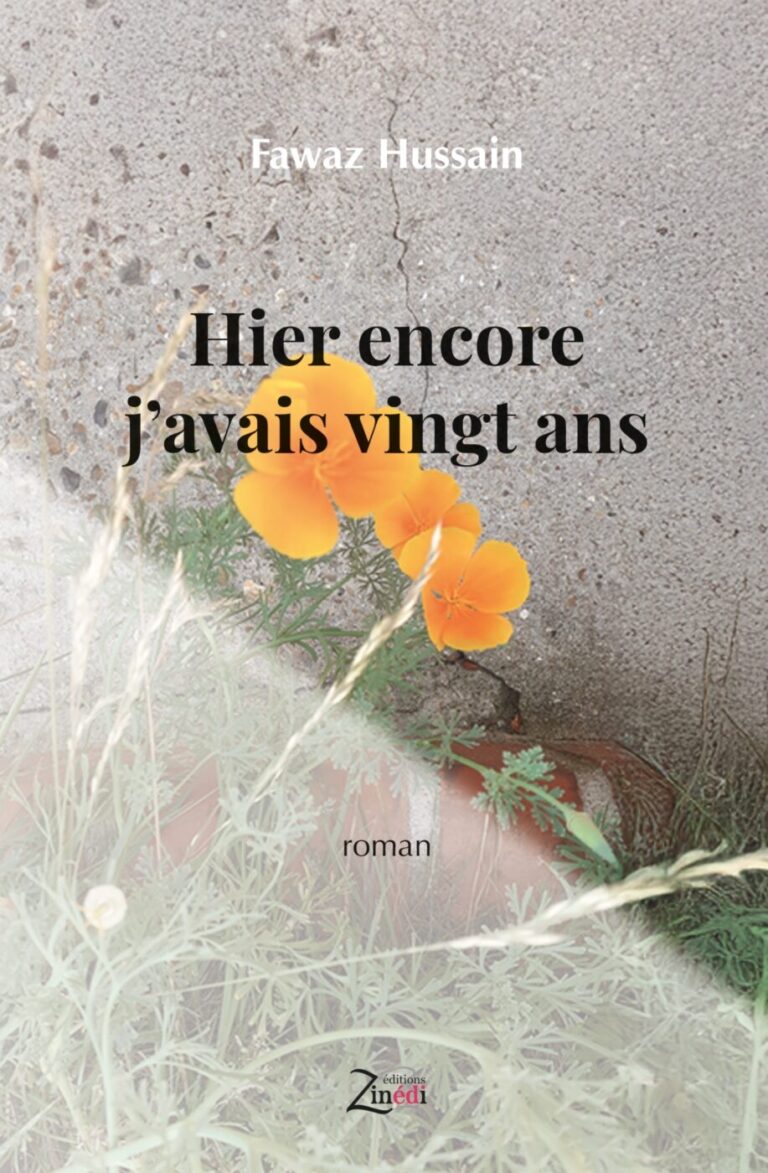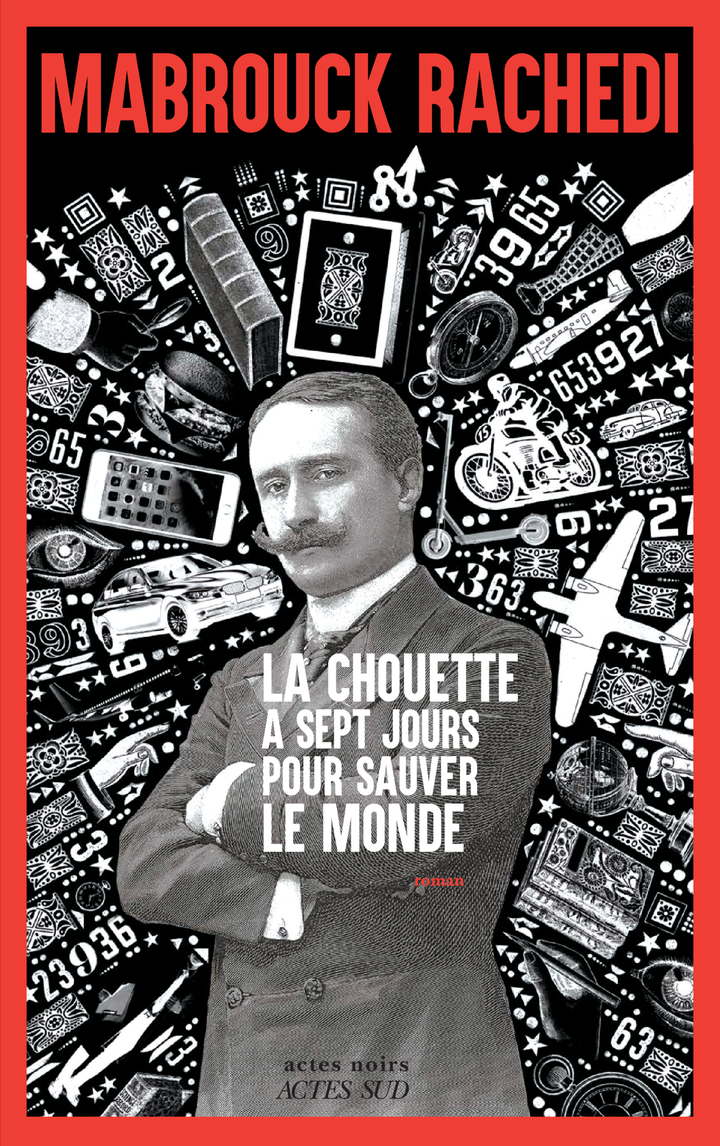Serge Camelo, La guerre des trachées, Les impliqués Éditeur, 04/09/2025, 236 pages, 22 €
Dans le métro parisien, ligne 5, un homme masqué hurle que « le COVID n’a jamais existé ». Nous sommes en 2025. Victor Malus, chercheur en immunologie, observe la scène avec une lassitude mêlée de rage. Ce trajet entre Gare d’Austerlitz et Église de Pantin structure tout le roman de Serge Camelo : vingt stations, autant de plongées dans les cinq années qui viennent de s’écouler, du premier cas détecté à Wuhan jusqu’à l’oubli collectif organisé. La guerre des trachées déploie un dispositif littéraire hybride : autofiction scientifique, chronique sociale, satire institutionnelle, et document d’archive brut. L’auteur écrit depuis une position rare : celle du chercheur de terrain, ni mandarin médiatique ni politique, porteur d’une découverte thérapeutique majeure systématiquement ignorée par les instances qui prétendaient coordonner la recherche française.
Une fiction vraie sur le COVID-19 ? Le roman qui révèle ce que les experts taisent
Ce livre paraît au moment où la mémoire de la pandémie bascule dans le flou. Les témoignages foisonnent — soignants épuisés, politiques en campagne de réhabilitation, essayistes analysant « l’ère COVID » —, mais rares sont ceux qui dévoilent les coulisses de la recherche biomédicale. Serge Camelo occupe cette brèche. Là où Karine Lacombe racontait l’hôpital en BD, où Yazdanpanah théorisait les maladies émergentes, le romancier montre l’envers du décor : les réunions Teams absurdes, les comités d’experts incompétents, les financements refusés pour cause de copinage institutionnel, et surtout, la découverte scientifique étouffée parce qu’elle dérangeait un consensus paresseux. Son œuvre rejoint ainsi une lignée plus subversive que testimoniale : celle des lanceurs d’alerte médicaux (Irène Frachon avec Mediator), des récits d’effondrement rationnel (Bruno Latour, Barbara Stiegler sur la gestion autoritaire de la crise), voire des contre-enquêtes cinématographiques comme Contagion de Soderbergh, qu’il cite d’ailleurs. Mais Serge Camelo va plus loin : il filme en direct l’implosion du discours scientifique dans l’espace public français.
Un roman dans le métro : la pandémie revisitée station par station
Le roman tient par son architecture narrative en boucle : chaque station de métro ouvre une séquence temporelle distincte. Gare d’Austerlitz, février 2020 : Malus rentre de vacances au ski, persuadé que la catastrophe arrive. Bastille, mars 2020 : le confinement s’abat, il tombe malade, seul chez lui, terrorisé. Stalingrad, été 2020 : retour à la vie, soirées au Mamakin, Sadio le barman qui rit toujours. Ourcq, automne 2020 : la découverte intellectuelle qui change tout — « la charge virale n’est pas liée à la mortalité ». Chaque étape construit une strate du récit : intime (la maladie, la solitude, le deuil), scientifique (les mécanismes virologiques expliqués avec une clarté pédagogique remarquable), politique (la mascarade des comités d’experts). Serge Camelo maîtrise l’art de la digression organisée : une anecdote sur sa thèse ratée à l’Institut Pasteur en 1996 nourrit la réflexion sur l’élitisme français ; un souvenir d’échec à l’école d’infirmières éclaire son rapport au soin et à la vulnérabilité. Le métro devient espace mental autant que géographique, ligne de vie autant que fil d’Ariane mémoriel.
Un roman à trois voix : biologie, critique sociale et deuil sous le même souffle
L’écriture oscille entre trois registres que l’auteur entrelace sans rupture. D’abord, la précision clinique : « L’angiotensine I est clivée en angiotensine II par l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE). Normalement, l’angiotensine II […] est à son tour clivée par l’ACE2 pour former l’angiotensine-1-7. » Ces passages fonctionnent comme des îlots de lucidité dans un océan de désinformation. Ensuite, la satire mordante : le portrait de Xavier de Lamballerie, expert du GEPC en « chemise à carreaux de bûcheron canadien », incarnation du chercheur arrogant incapable de comprendre ses propres critères d’évaluation, vaut toutes les charges contre l’imposture institutionnelle. Enfin, le lyrisme désenchanté : la scène où Malus, confiné, pleure seul sur son lit en mars 2020, ou celle où il apprend la mort de Sadio dans un TGV en Vendée, atteignent une intensité émotionnelle bouleversante. « Sadio, c’est l’anagramme d'”Adiós” », réalise-t-il soudain, assis sur une plage grise. Cette phrase résume tout : le deuil, le vertige des coïncidences, la solitude face à l’absurde.
Clientélisme, bureaucratie, désinformation : le livre qui accuse
Serge Camelo dresse un réquisitoire implacable contre les dysfonctionnements français durant la pandémie. Il nomme les coupables : Didier Raoult et son « hydroxychloroquine miracle » fondée sur des données trafiquées, les journalistes de CNews relayant sans filtre les théories complotistes, les experts de l’ANRS-MIE refusant de financer son essai clinique parce qu’il ne correspondait pas à leurs « critères de succès » chez le hamster. Mais au-delà des individus, l’auteur attaque les structures : la bureaucratisation étouffante, le clientélisme qui favorise les projets bien connectés plutôt que les bonnes idées, l’obsession du facteur d’impact au détriment de la pertinence scientifique, la concentration des moyens dans de grands instituts moribonds. « Il faut financer toutes les idées, tous les projets pour avoir une chance de miser sur la technique révolutionnaire qui changera le monde dans dix ou vingt ans », écrit-il. Cette critique déborde largement le cadre de la pandémie : elle interroge l’avenir même de la recherche française.
Quand le médecin joue au savant : récit d’une confusion fatale
Mais ce qui donne à La guerre des trachées sa profondeur philosophique, c’est la méditation sur la nature de la connaissance scientifique. Camelo cite longuement Einstein et Infeld : « Les concepts physiques sont des créations libres de l’esprit humain et non, contrairement à ce qu’il paraît, uniquement déterminés par les manifestations du monde extérieur. » Cette réflexion traverse tout le livre. Faire de la recherche, c’est accepter l’incertitude fondamentale, formuler des hypothèses provisoires, tendre vers une vérité toujours inaccessible. À l’inverse, le médecin doit être certain, affirmatif, rassurant. Serge Camelo montre comment cette confusion entre deux épistémologies antagonistes — celle du doute scientifique et celle de la certitude médicale — a conduit au désastre. Raoult incarnait cette confusion : médecin persuadé d’être scientifique, incapable de remettre en cause son hypothèse initiale malgré l’accumulation des preuves contraires.
Le narrateur lui-même bascule progressivement : d’abord observateur lucide, il devient acteur désespéré, puis témoin amer. Après la mort de Sadio, quelque chose se brise en lui. Sa relation avec Joséphine s’effondre. Son essai clinique, pourtant positif, est ignoré. Son article, refusé douze fois avant d’être accepté dans un journal mineur. « Je suis devenu un chercheur raté », admet-il. Pourtant, l’épilogue laisse entrevoir une issue : « Peut-être que ce que j’ai vécu vaut quand même la peine d’être raconté. » Ce basculement du scientifique vers l’écrivain, du témoin vers le chroniqueur, structure secrètement tout le roman. Serge Camelo construit ici une archive littéraire essentielle, mais aussi un objet troublant : et si la seule manière de sauver la vérité scientifique passait désormais par la fiction, par le témoignage subjectif, par l’écriture ?