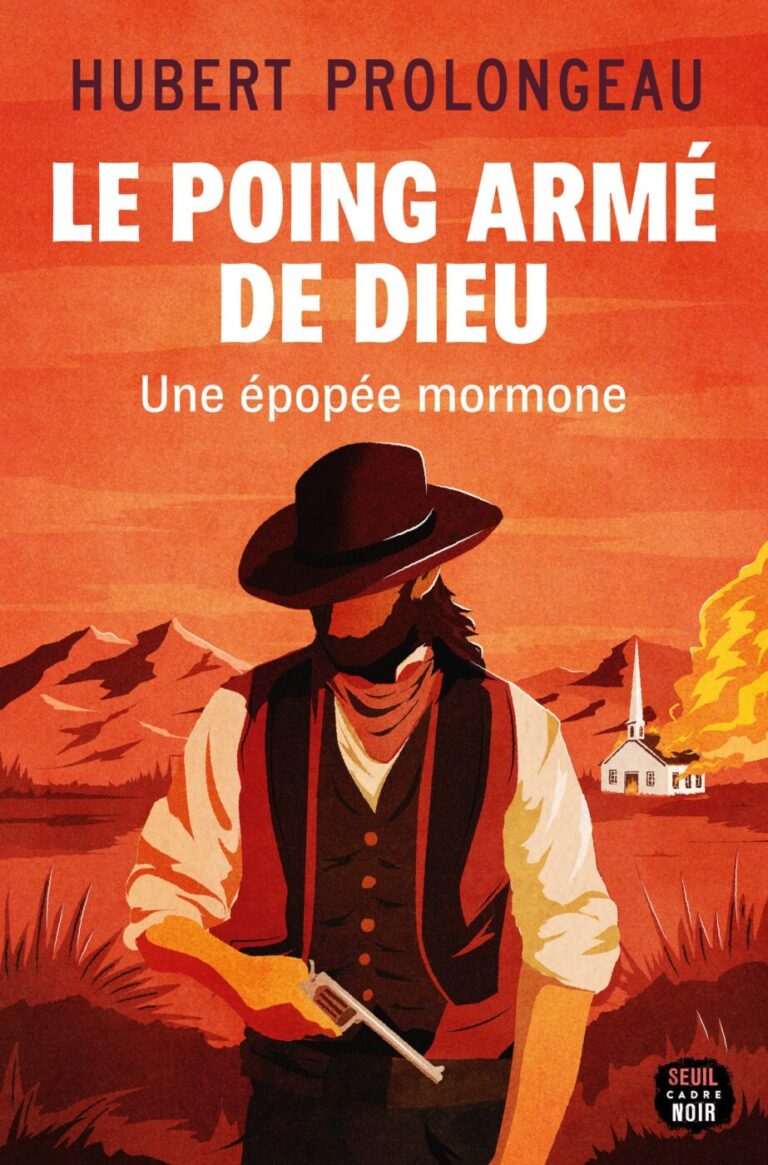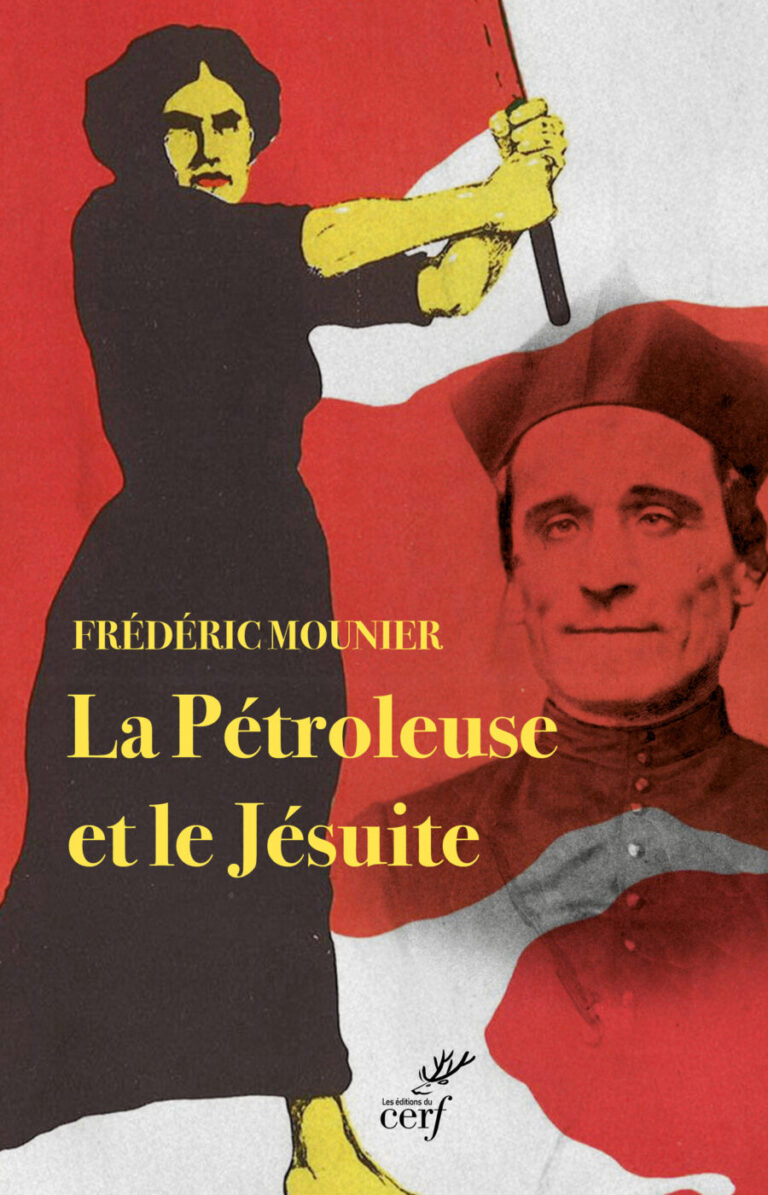Anne Giroux-Terrier, La nuit tu es noire, le jour tu es blanche, Gallimard, 01/02/2024, 1 vol. (228 p.), 22€
La nuit tu es noire, le jour tu es blanche aborde sans détour la violence du système colonial qui a sévi aux Antilles et qui, aujourd’hui encore, continue d’imprégner les relations entre “Noirs, Blancs, Indiens, métis, mulâtres, câpres, chabins…” Comme le souligne Anne Terrier, en ce début de 21e siècle, la hiérarchie des couleurs de peau persiste dans ces îles caribéennes, générant des discriminations toujours très opérantes autant subjectivement qu’objectivement.
En s’intéressant plus particulièrement à la destinée de Paula (98 ans en 2022), descendante d’une riche famille de Blancs créoles avec du sang indien dans les veines, l’autrice montre à quel point l’interdit du métissage, bien que transgressé par des ascendants et ascendantes, s’impose aux descendants et descendantes tel “une tâche indélébile” honteuse, les empêchant de “s’aventurer au-delà de la ligne de couleur“.
Pas de sang-mêlé chez les békés : la mécanique obsédante de l’interdit du métissage
Au début du 20e siècle à Marie-Galante, à la Guadeloupe, Gaétan Saint-Sulpice, le grand-père de Paula, a transgressé l’interdit du métissage porté avec force et conviction par les colons. Le destin a mis sur sa route “une petite lingère prénommée Augusta dont la mère, comme tant d’autres coolies, avait fait le voyage depuis l’Inde pour remplacer les esclaves” qui avaient été libérés en 1848.
Gaétan Saint-Sulpice a eu sept enfants avec Augusta Dhély. Mais, ne l’ayant pas épousée, il a pu se flatter de ne pas avoir commis l’irréparable et d’avoir ainsi échappé “à une mésalliance qui lui aurait valu d’être exclu de sa communauté” et qui aurait assurément compromis l’avenir de la florissante distillerie familiale. En patriarche inflexible, Il a voulu que ses descendantes et descendants fassent en sorte que le sang de la famille Saint-Sulpice ne soit pas souillé davantage qu’il ne l’a été par sa faute et que le patrimoine de celle-ci, augmenté de son travail, ne puisse pas revenir à de nouveaux sang-mêlé. Il exigea donc que ses enfants ne se marient pas.
L’interdit du métissage a d’abord été transmis à Paula et ses deux cadets (Violaine et Judde) sans être verbalisé. Il leur a été instillé implicitement, ne leur laissant que des sensations de doute et d’étrangeté qui les mettaient généralement mal à l’aise. C’est en apprenant que tous trois allaient être gardés par Augusta leur grand-mère maternelle dont, jusque-là, ils n’avaient jamais entendu parler, que l’interdit va leur sauter aux yeux.
Paula fut d’abord étonnée que cette grand-mère inconnue puisse habiter une maison, certes jolie et bien entretenue, mais qu’elle savait être une ancienne case d’esclave. Puis, quand elle aperçut Augusta, malgré tout ce qui en celle-ci évoquait une grand-mère – “son pas traînant, ses formes généreuses, ses cheveux blancs” –, Paula comprit que, en raison de sa peau sombre, Augusta était “une incongruité dans une famille de Béké“. Elle se demanda comment pouvait-elle être la mère de sa propre mère ? Dès lors, “un abîme de perplexité s’ouvrit devant elle : il est donc possible d’avoir la peau noire à la naissance sans être noir ? Alors, il est aussi possible d’avoir la peau blanche sans être blanc ?“
Paula ou le consentement à l’empêchement d’être soi
Césarine, la mère de Paula, a eu une influence décisive dans l’empêchement d’être soi que sa fille s’est très longtemps infligée. À sa majorité, Césarine avait osé transgresser l’interdiction de se marier édictée par Gaétan Saint-Sulpice (et, aux yeux de celui-ci, peu avait importé que le mari fût aussi blanc que lui !). Elle fut donc déshéritée et, à jamais, hors de la vue de son père. Mais, l’interdit du métissage inoculé en elle par l’intransigeante éducation paternelle n’en a pas moins cessé de la tenailler. Devenue mère, Césarine a eu la hantise que ses filles soient séduites par un homme de couleur et donnent naissance à des petits métis.
Alors que sa sœur Violaine ne s’en souciait pas (en cachette, elle fut amoureuse d’un jeune homme noir), Paula fit sienne cette hantise, se construisant à partir de l’image négative d’elle-même que sa mère lui renvoyait inlassablement : celle d’une personne sans qualités, méritant d’être constamment rabaissée. En dépit de son abnégation à réaliser tout ce que sa mère attendait d’elle et à supporter “la violence des propos de celle-ci à son encontre, Paula n’était jamais récompensée”.
La capacité à la soumission développée par Paula depuis l’enfance l’ont notamment conduite à ne pas prêter attention aux “signes annonciateurs de désastres futurs” que sa rencontre, au début des années 1950, avec William ne pouvait qu’entraîner. Qu’il décidât de tout dès l’organisation de leur mariage (la robe qu’elle devait porter, l’absence de sa famille…) a paru à Paula un désagrément sans grande importance puisque William était blanc et exerçait le métier très honorable d’ingénieur : en effet, ne correspondait-il pas en tout point au portrait du mari idéal que Césarine voulait pour ses filles ?
Alors que le couple résidait au Maroc, sous la redoutable férule de William, Paula accepta de ne plus exercer le métier d’infirmière qu’elle aimait tant, se privant du plaisir d’être très appréciée pour sa professionnalité. Elle ne dit rien quand elle-même et ses deux fils furent frappés et privés des moyens financiers pour pouvoir se nourrir.
C’est seulement quand elle apprit la double vie de son mari qu’elle eut l’audace de demander la séparation de corps. Mais après une longue et douloureuses procédure, en 1974, ce fut le divorce aux torts réciproques que le juge prononça. Paula devait continuer à habiter dans l’appartement de Sceaux (à proximité de Paris) acheté par William ; dans le cas contraire, il le récupérerait. Si Paula ne put s’empêcher d’interpréter cette clause comme une interdiction de se remarier, prolongeant l’interdiction du mariage imposée par Gaétan Saint-Sulpice à sa mère, ses oncles et tantes, le divorce lui donnait peut-être enfin, à presque 50 ans, “la possibilité de décider par elle-même de sa vie“.
De l’injonction à se sentir blanc ou noir à la liberté d’être blanc et noir
Les descendantes et descendants de Gaétan Saint-Sulpice ont grandi dans un univers où se prémunir du sang-mêlé était la règle cardinale. Aux yeux du monde, la peau blanche était la preuve tangible de la supériorité économique, sociale et politique mais également culturelle, intellectuelle et morale de la lignée familiale. La peau blanche était ce qui signait et légitimait sa domination sur celles et ceux dont la carnation de peau était noire où s’en rapprochait plus ou moins.
En contrevenant à l’exigence de préservation de la peau blanche on s’exposait à la relégation et au mépris de sa famille d’origine et de la communauté d’appartenance de celle-ci. Chez les Saint-Sulpice, comme dans les autres familles de békés, cette exigence était telle qu’elle devait nécessairement l’emporter sur l’attirance et le désir que pouvait susciter une personne à la peau noire ou tendant vers le noir.
Ainsi pendant des décennies, la longue conformité obligée de Paula aux attentes de son grand-père et de sa mère l’a enfermée dans une identité d’exclusivement blanche, à jamais fixée, l’empêchant d’être pleinement elle-même et notamment d’assumer son métissage et d’en apprécier les potentialités. Toutefois, après beaucoup de renoncements et de souffrances, Paula a finalement commencé à entrevoir qu’elle avait la possibilité d’être, à la fois, blanche et noire ; et, aussi, selon les événements du monde et de sa propre existence, celle de bénéficier du privilège de parfois se sentir plus noire que blanche et, d’autre fois, plus blanche que noire, ou encore, ni noire, ni blanche.
Mêlant la détermination du propos et la subtilité de l’évocation, La nuit tu es noire, le jour tu es blanche montre combien, aux Antilles notamment, l’interdit du métissage a été une implacable machine à broyer les existences individuelles et comment, jusqu’à aujourd’hui, bien que moins brutale, sa transmission d’une génération à l’autre continue à affecter les destinées quelle que soit la couleur de peau.
Le roman d’Anne Terrier contribue avec force à la réflexion en faveur de l’identité comme processus et non pas comme état à jamais donné à la naissance, Dans cette perspective, elle soutient que l’acceptation et la valorisation du métissage des couleurs de peaux, plutôt que le rejet de l’Autre parce qu’il est blanc ou noir – “a fortiori quand cet Autre se terre à l’intérieur de soi” – ne peut qu’ouvrir à une identification suffisamment sereine.
eliane.le-dantec@orange.fr