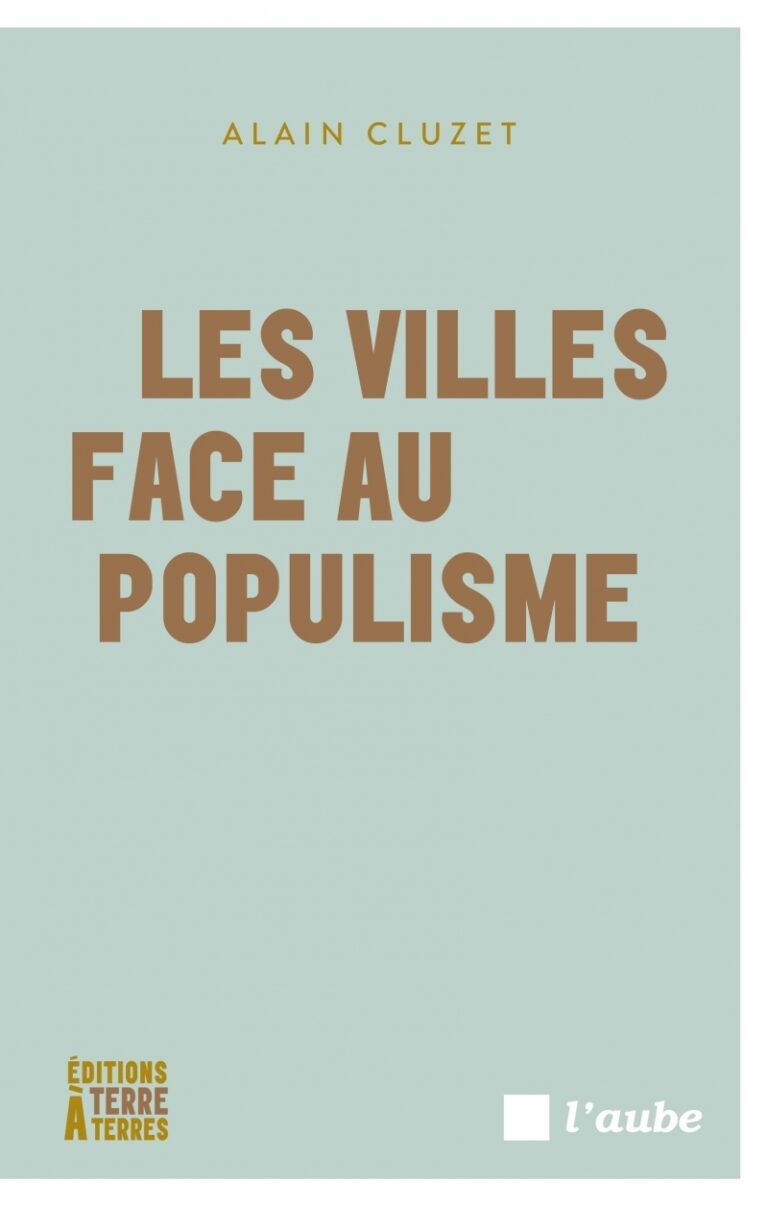Kamel Daoud, Il faut parfois trahir, Gallimard (collection Tracts), 08/05/2025, 64 pages, 3,90 €
Dans le panorama intellectuel contemporain, où les assignations identitaires et les récits officiels pèsent de tout leur poids, l’essai de Kamel Daoud, Il faut parfois trahir, paru chez Gallimard (collection Tracts), résonne avec une acuité particulière, celle d’une conscience qui refuse l’embrigadement. Au-delà d’un recueil de réflexions, nous sommes en présence d’une cartographie intime et politique de la dissidence, un autoportrait forgé dans le feu croisé des injonctions et des anathèmes. L’ouvrage, à la prose ciselée et à la pensée incandescente, se déploie alors que son auteur navigue lui-même dans les eaux tumultueuses d’une controverse judiciaire et étatique autour de son roman Houris, conférant à chaque mot une résonance prophétique ou, du moins, une justification poignante de son parcours. Kamel Daoud, écrivain algérien de langue française, intellectuel scrutant sans concession les fractures de son temps, y déploie une éthique de la trahison, non comme reniement, mais comme impératif de lucidité et acte suprême de fidélité à soi et à une vérité plus vaste que les dogmes.
Le traître, figure archétypale et voie d’émancipation
Au cœur de la réflexion de Kamel Daoud se dresse, paradoxale et revendiquée, la figure du traître. Loin d’être un stigmate subi, elle devient un étendard, une posture philosophique et existentielle. L’intellectuel qui, selon ses propres termes, « pense contre soi et contre les siens », se voit d’emblée affublé de cette étiquette infamante. L’auteur, plutôt que de la récuser, la dissèque, la retourne, et en fait le point de départ d’une quête de sens. Il revisite le mythe du colonel Bendaoud, cet officier algérien de l’armée française, « Lucifer congelé du nationalisme algérien », dont la légende, tissée de dépit et d’une impossible assimilation, sert de leçon éternelle contre toute velléité d’altérité. Pour Kamel Daoud, cette figure, comme celle de Malek Haddad – l’écrivain qui choisit le silence après l’indépendance, se sentant exilé de sa propre langue et incapable d’écrire dans un français perçu comme langue du colonisateur –, illustre le drame de l’identité assignée, de la fidélité qui étouffe. Malek Haddad, voulant « devenir un meilleur “Arabe” », se condamne à une forme de mort littéraire, un sacrifice que Kamel Daoud semble refuser avec véhémence. Pour lui, « tous les héros ont trahi l’immobilité. Tous les prophètes devaient trahir leur époque et un désert jaloux ». La trahison, ici, est synonyme de mouvement, de questionnement, d’un refus salutaire de l’immobilité mortifère des certitudes collectives. C’est oser l’espérer que d’être traître, car « devenir un ancêtre digne de la mémoire des autres, cela se mérite ».
La langue française : exil intérieur et espace de liberté conquise
L’acte de trahison se manifeste éminemment dans le choix de la langue. Pour un écrivain algérien, l’usage du français n’est jamais neutre. Il est perçu, par les gardiens du temple identitaire, comme une allégeance à l’ancien colonisateur, une blessure narcissique pour une nation qui peine à suturer les plaies de son histoire. Kamel Daoud, pleinement conscient de cet enjeu, assume ce choix comme une conquête : « Je me définis comme étant cette langue, là, le français dans cet écrit, car c’est une victoire. Le signe d’une blessure cicatrisée, la preuve que l’on peut gagner autrement que par la guerre ». Ses « trois langues » (l’arabe dialectal, l’arabe classique et le français) sont autant de « fenêtres », ouvrant sur des mondes, refusant l’emmurement dans une “arabité réactivée en inquisition” qui exclut la diversité. Le « je » de l’écrivain, affirmé dans cette langue « étrangère », devient alors subversif, car il s’oppose au « nous » unanime et monolithique que prônent les tenants d’une identité pure et essentialisée.
Cette appropriation linguistique est intrinsèquement liée à sa posture face à la mémoire collective, notamment celle de la « décennie noire ». Écrire en français, c’est aussi se donner les moyens de nommer l’indicible, de questionner les silences imposés par le récit national. Mais c’est un fil du rasoir, surtout lorsque cette parole, incarnée dans un roman comme Houris, est accusée de s’approprier le vécu d’une survivante sans son consentement explicite. L’affaire Saâda Arbane, où Kamel Daoud et son épouse sont visés par des plaintes en Algérie pour violation du secret médical, atteinte à la vie privée, et violation de la loi sur la réconciliation nationale, et par une plainte en France pour atteinte à la vie privée et abus de confiance, puis diffamation, projette une lumière crue sur les dilemmes éthiques de la fiction inspirée du réel. L’essai Il faut parfois trahir, bien que ne traitant pas directement de cette affaire judiciaire en cours, en fournit une clef de lecture philosophique : l’écrivain, en trahissant les silences, les non-dits, et parfois même les frontières intimes, ne cherche-t-il pas à atteindre une vérité plus essentielle, fût-ce au prix d’une transgression ? Les mandats d’arrêt internationaux émis par l’Algérie en mars et mai 2025, rarissimes contre un écrivain lauréat du Goncourt, transforment cette interrogation philosophique en une réalité judiciaire implacable, faisant de Kamel Daoud un symbole de la précarité de l’intellectuel critique face à la raison d’État.
Mémoire interdite, récit impossible et l’intellectuel en procès
La question de la mémoire, et de qui a le droit de la raconter, est centrale chez Kamel Daoud et se trouve exacerbée par sa situation actuelle. Son roman Houris, qui a ravivé les traumatismes de la guerre civile algérienne, a été immédiatement interdit en Algérie, avant même que n’éclate la controverse sur l’inspiration de son personnage principal. L’interdiction d’évoquer publiquement cette période, scellée par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale de 2005, fait de toute tentative littéraire une transgression. L’écrivain se heurte alors non seulement à la censure d’État, mais aussi aux sensibilités des victimes et à la complexité éthique de transformer la douleur individuelle en matériau romanesque. L’essai de Daoud, en prônant une “interrogation” perpétuelle et en critiquant ceux qui veulent que la mémoire soit une “maison” plutôt qu’un “chemin“, défend implicitement le droit de l’artiste à explorer ces zones d’ombre.
Cette posture, cependant, l’expose à un double procès. D’un côté, celui intenté par Saâda Arbane, qui soulève la question légitime des limites de l’inspiration et du respect de la vie privée. De l’autre, un procès moral et politique, mené par les instances qui voient en lui un « ennemi de l’intérieur », un agent déstabilisateur du récit national. En déterrant les « cadavres » de l’histoire, en questionnant le rôle de la religion et les fondements de l’identité, Kamel Daoud s’inscrit dans une lignée d’intellectuels dont la parole est jugée blasphématoire ou séditieuse. Le parallèle avec Salman Rushdie, bien que les contextes juridiques et religieux diffèrent, est celui d’un écrivain menacé pour avoir osé toucher aux symboles sacrés. En Algérie même, l’écho de la “fatwa” de 2014, suite à ses critiques sur le rapport des musulmans à leur religion, n’est jamais loin.
La leçon d’insoumission
Il faut parfois trahir n’est donc pas une apologie de la déloyauté, mais un vibrant plaidoyer pour l’autonomie de la pensée et la complexité du réel contre les simplifications idéologiques. C’est un réquisitoire contre l’immobilisme, le silence complice et les identités meurtrières. Sa portée dépasse largement le cas personnel de Kamel Daoud ou le contexte algérien ; il parle à toutes les sociétés confrontées à leurs tabous, à la tentation du repli et à la diabolisation de la critique.
La situation de Boualem Sansal, autre grande voix critique de l’Algérie, emprisonné depuis novembre 2024 sous des prétextes sécuritaires qui masquent mal une volonté de le réduire au silence, offre un contrepoint tragique. Si les deux écrivains partagent un courage intellectuel face à un régime autoritaire et une même acuité à disséquer les maux de leur société, leurs cas illustrent des facettes distinctes de la répression. Boualem Sansal incarne la figure de l’opposant que l’on tente de briser par l’incarcération directe. Kamel Daoud, lui, est la cible d’une offensive plus insidieuse, multiforme : les vestiges d’une fatwa, la censure d’État, l’instrumentalisation judiciaire d’une plainte privée, et finalement des mandats d’arrêt qui cherchent à le criminaliser au regard du droit commun. Il est crucial de ne pas amalgamer ces deux destins, car cela reviendrait à ignorer la diversité des stratégies de neutralisation des voix dissidentes. Lier leurs situations simplifierait abusivement la complexité des menaces pesant sur la liberté d’expression, qui ne se résume pas à l’affrontement binaire entre l’écrivain et l’État, mais s’insinue aussi dans les replis éthiques du processus créatif, dans les blessures mémorielles et les fractures sociales que les pouvoirs en place savent exploiter.
L’essai de Kamel Daoud, éclairé par sa propre odyssée judiciaire, se lit comme un manuel de survie intellectuelle et morale. Il nous rappelle que la liberté d’expression n’est jamais un acquis, mais une conquête permanente, et que la littérature, lorsqu’elle ose “trahir” les conforts et les conformismes, devient un acte de résistance fondamental. C’est là sa grandeur et, inévitablement, sa vulnérabilité.