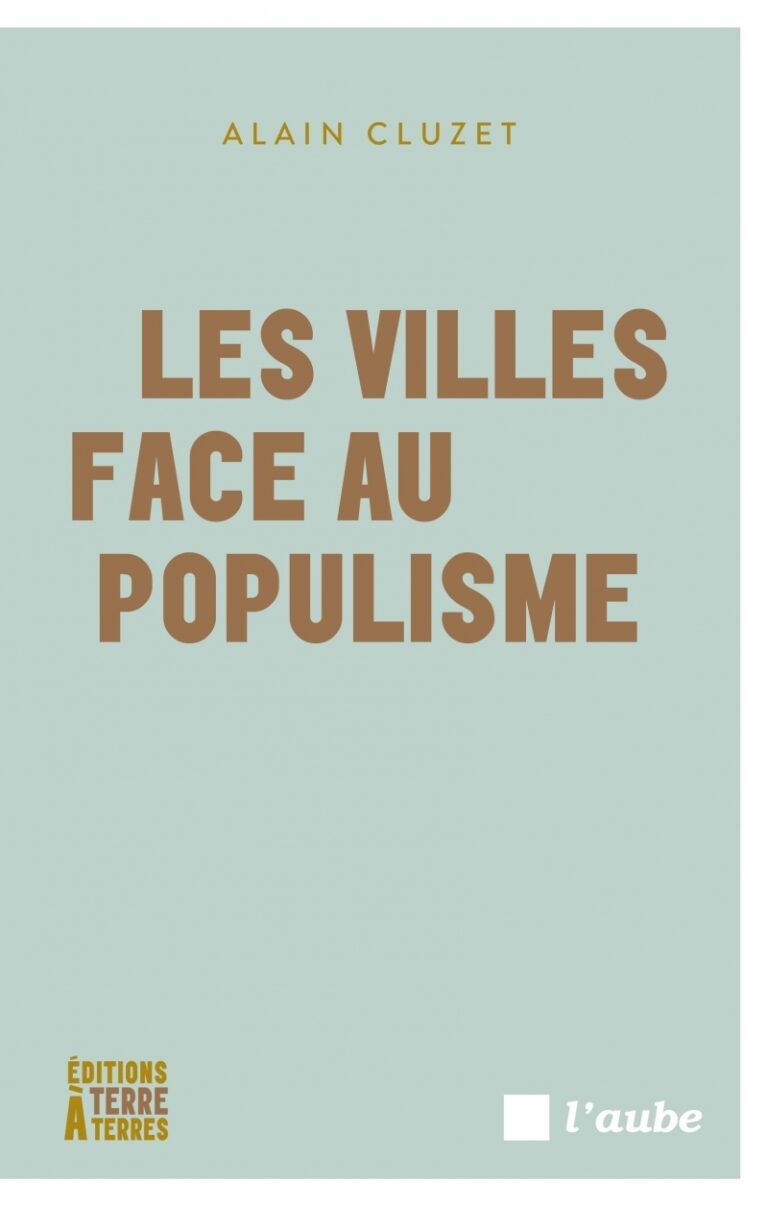Yves Santamaria. L’Algérie et la France. Une terre pour deux peuples (1830-1962). Éditions Odile Jacob. 29/01/2025. 384 pages, 25,90 €
Yves Santamaria, historien spécialiste des relations franco-algériennes, propose une synthèse rigoureuse de l’histoire de la France et de l’Algérie depuis la conquête de 1830 jusqu’à l’indépendance de 1962. Publiée en 2025 aux Éditions Odile Jacob, L’Algérie et la France. Une terre pour deux peuples (1830-1962), l’auteur étudie le long cheminement de coexistence de « deux peuples » sur un même territoire. Le titre, « Une terre pour deux peuples », résume la problématique centrale : comment, sur un même territoire, deux sociétés – l’une colonisatrice, l’autre colonisée – ont tenté, en vain, de coexister. Il s’agit d’évaluer et d’expliquer la cohabitation fondamentalement impossible entre ces deux peuples, dont les trajectoires politiques, sociales et identitaires divergent progressivement au fil du siècle colonial. Yves Santamaria explore les mécanismes de domination, les tentatives d’assimilation et les velléités d’autonomie, notamment au sein de la population européenne d’Algérie dans une approche à la fois historique, sociologique et politique.
L’histoire de l’Algérie coloniale ne se réduit ni à une domination unilatérale
On ne peut pas se limiter à une vision d’un simple face-à-face entre colonisateurs et colonisés. La complexité des interactions entre ces deux peuples et les divisions internes sont ici abordées. Son originalité tient surtout à l’étude du courant autonomiste européen, c’est-à-dire les colons d’Algérie (les « Français d’Algérie » ou les « pieds-noirs ») qui, au-delà de leur attachement à la France, rêvaient parfois d’une autonomie locale ou d’un État distinct. Ces aspirations, selon lui, révèlent la fragilité du projet colonial français et la difficulté à concilier deux sociétés aux statuts profondément inégaux. Il met en avant des projets politiques internes à la communauté européenne d’Algérie (autonomistes, fédéralistes, sécessionnistes) et à l’analyse des tensions internes à la « communauté française » elle-même. Un important chapitre est dédié aux penchants sécessionnistes des colons et à leurs projets d’autonomie.
Un regard centré sur la société européenne
Il est compliqué de relire une histoire (encore récente), et il est assez facile d’atteindre les limites dans l’analyse des faits. Aussi, non notera un certain déséquilibre entre les deux peuples étudiés. La majeure partie de l’étude est consacrée aux « Européens d’Algérie », tandis que la société musulmane, pourtant majoritaire, reste souvent envisagée à travers le prisme du pouvoir colonial ou du nationalisme. La place dominante accordée aux « Pieds-noirs » se fait au détriment des expériences sociales et culturelles des Algériens. En majorant cet aspect, le risque est de sous-évaluer les expériences et revendications du peuple algérien. L’asymétrie est manifeste. L’approche essentiellement politique et institutionnelle laisse peu de place à l’étude des pratiques sociales, culturelles ou religieuses des « autochtones », domaines pourtant essentiels pour comprendre les dynamiques de résistance.
Continuités et ruptures : l’Année 1962
L’historien articule des sources administratives, la presse locale, les débats parlementaires et les biographies pour tenter de dénouer les fils complexes d’une situation tout aussi complexe. L’essai reconstitue des épisodes moins commentés (tentatives autonomistes, projets de partition, débats législatifs, figures locales), ce qui enrichit le panorama traditionnel centré uniquement sur les grandes étapes politiques. On sent là le background universitaire. En couvrant plus d’un siècle, il parvient à relier continuités et ruptures (colonisation, société coloniale, montée du nationalisme algérien, Guerre d’indépendance). La mise en perspective permet de comprendre que l’événement de 1962 n’est pas une rupture isolée mais l’aboutissement de tensions anciennes. L’Année 1962 devient une borne chronologique qui développe à la marge une réflexion sur les héritages mémoriels et postcoloniaux des relations franco-algériennes. Ce silence sur l’après-guerre contraste avec l’importance du « travail de mémoire » dans l’historiographie contemporaine. L’étude s’inscrit dans le sillage des grands travaux de nombreuses personnalités dont Benjamin Stora. Il s’en distingue par la place donnée aux colons d’Algérie comme acteurs historiques à part entière.
Aspirations politiques des colons
L’auteur accorde une attention certaine aux colons européens d’Algérie et à leurs tentatives pour s’émanciper de la tutelle métropolitaine. Les projets d’autonomie, de fédération ou de partition témoignent d’une tension interne à la société coloniale. L’historiographie classique évolue. Elle avait été centrée jusqu’alors souvent sur la confrontation entre colonisateurs et colonisés. La complexité de la relation franco-algérienne se déploie sous un jour nouveau que viennent éclairer les analyses présentées dans cet ouvrage, en montrant que les colons n’étaient pas toujours de simples relais du pouvoir métropolitain, mais parfois des acteurs aux ambitions marquées.
Structure chronologique de l’essai d’Yves Santamaria
L’ouvrage se déploie selon une progression chronologique en trois grands ensembles.
La première partie (1830 – 1870) : la conquête et la mise en place du système colonial), revient sur la violence de la conquête et la mise en place d’un ordre inégalitaire fondé sur la spoliation foncière et le Code de l’indigénat, véritable instrument juridique de discrimination. Il insiste sur la naissance d’une « Algérie française ». Il montre comment la domination coloniale s’est accompagnée d’un discours de « mission civilisatrice » justifiant la dépossession des populations locales, et d’une ségrégation juridique systématique.
La seconde partie (1870 – 1945) : l’âge d’or et les contradictions du colonialisme) s’attache à décrire la société coloniale duale qui s’impose à partir de la IIIᵉ République. Les « Européens d’Algérie » développent une identité propre. Un sentiment d’appartenance « algérien » naît au sein de cette communauté, et devient peu à peu prélude à des aspirations autonomistes. La société européenne devient de plus en plus puissante laissant place à une marginalisation politique des Algériens musulmans. Cette tension devient une fracture prégnante qui entraînera les premiers mouvements de réforme et de revendication et la montée d’un sentiment identitaire.
Enfin, la dernière partie (1945 – 1962) : les déchirures finales et l’effondrement de l’ordre colonial avec la guerre d’indépendance), est consacrée à cette période. L’auteur y analyse la montée des tensions, la radicalisation du nationalisme algérien, les transformations sociales et politiques conduisant à la « Guerre d’indépendance » : répression de Sétif, émergence du FLN, fracture entre la métropole et les colons, et l’effondrement du système colonial. Tous ces faits amènent une rupture définitive entre les deux peuples. On assiste à une désagrégation progressive du lien colonial miné à la fois par
Ce que l’on peut en dire au terme de la lecture…
L’auteur parvient à restituer la complexité du rapport franco-algérien en soulignant la coexistence impossible de deux sociétés et de deux cultures qui s’affrontent dans deux sphères de pensées diamétralement opposées. Par certains égards cela nous rappelle aussi la difficulté de plus en grande entre Israël et la Palestine. Yves Santamaria met en lumière des tensions internes à la communauté européenne d’Algérie et dans la réévaluation de ses projets autonomistes, souvent négligés par l’historiographie. À regret, il s’attarde davantage sur les élites, les textes législatifs et les débats politiques que sur les vécus quotidiens. L’approche culminant en 1962 limite l’analyse des conséquences mémorielles contemporaines (pieds-noirs, harkis). L’historien n’aborde pas les prolongements mémoriels et postcoloniaux, pourtant essentiels à la compréhension de la relation franco-algérienne contemporaine. L’actualité politique et diplomatique entre les deux pays appellerait pourtant à cette ouverture. L’Algérie et la France. Une terre pour deux peuples (1830-1962) reste un ouvrage de référence pour comprendre pourquoi, entre 1830 et 1962, l’Algérie a été moins une colonie qu’un champ de tension permanent entre deux peuples condamnés à se séparer. Il revisite la compréhension que nous avons du passé colonial français, de ses ambiguïtés dans son projet colonialiste, et contribue aussi à une réflexion nuancée sur les causes profondes de la rupture entre la France et l’Algérie.
Ce livre est donc d’une grande actualité à l’heure où les deux pays n’arrivent pas à dépasser les faits historiques autour des dits « évènements » dans une optique d’apaisement des tensions. Dans ces conditions, il est encore difficile de pouvoir penser l’Indépendance de l’Algérie, la décolonisation, et d’atténuer les rancœurs. Le pays reste, malgré ses capacités pétrolières fragile économiquement. Les raisons sont multiples. C’est encore un pays non ouvert au tourisme de masse, et qui a du mal à donner à sa jeunesse un horizon politique ouvert et une économie leur permettant de pouvoir gagner décemment leur vie… avec la désespérance qui s’y rattache. Apprendre à se parler, à lire l’histoire de la colonisation et des conditions de l’indépendance de ce grand pays est une urgence. L’Algérie a aussi besoin de se nourrir d’une espérance, et son peuple est en attente de lendemains féconds…, qui ouvrent l’avenir.