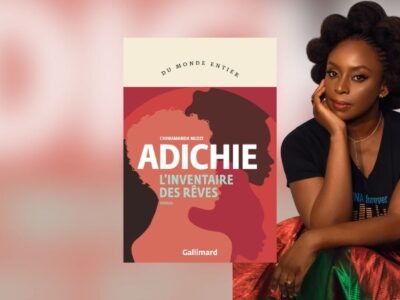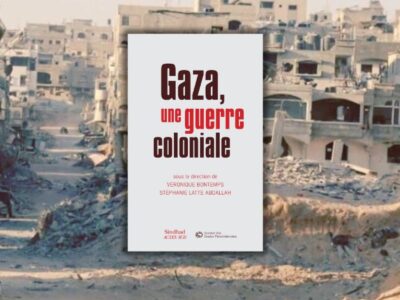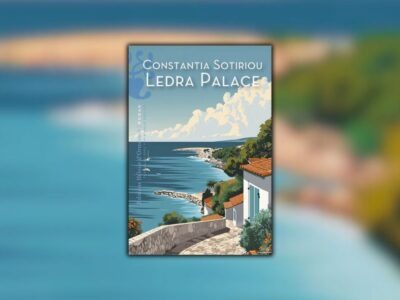Roman saisissant de l’écrivain grec Thomas Korovinis, “Le cycle de la mort” raconte l’histoire d’Aristidis Pagratidis, plus communément appelé Aristos, protagoniste d’un tragique fait divers qui se trouva sous les feux l’actualité de 1959 à 1963. Un tueur en série, surnommé par la presse le “monstre de Seikh Sou”, avait commis une série d’assassinats dans la forêt éponyme, à Thessalonique. Il ne fut pas arrêté et les médias finirent par se désintéresser de lui, jusqu’à l’assassinat par les fascistes, le 22 mai 1963, du député de gauche Grigoris Lambrakis, qui devait assister à Thessalonique à une conférence sur la paix, et dont la mort avait inspiré le roman de Vassilis Vassilikos, Z, adapté ensuite au cinéma par Costa Gavras. L’arrestation de Pagraditis, tentant de pénétrer dans un orphelinat de filles, permit au gouvernement grec de faire diversion en focalisant l’actualité sur le présumé “monstre de Seikh Sou”, dont les crimes furent imputés à Aristos, âgé de 23 ans, en dépit de ses proclamations d’innocence. Un procès vite expédié aboutit à sa condamnation à mort. Aristidis Pagratidis fut exécuté le 6 février 1968.
L’écriture de ce roman choral se caractérise par sa variété. Un poème, signé Stavros Zafiriou, intitulé “Les journaux”, qui fait le récit de l’exécution, en constitue l’ouverture. Puis un premier chapitre, “À propos du monstre de Seikh Sou”, compile une série de rapports et de témoignages, y compris celui de l’accusé, constituant une sorte de mise en abyme du roman dont il préfigure la structure. Enfin, à ces extraits courts succède une série de chapitres dont la plupart, favorables au jeune homme, s’efforcent de comprendre l’enchaînement des faits, réhabiliter l’accusé ou restaurer son humanité. Ces témoins, habitants du quartier, sont des amis du protagoniste ou de sa famille, pour bon nombre d’entre eux. Ils appartiennent au monde des opprimés, des révoltés, des invisibles. Le livre fait un récit détaillé de l’enfance d’Aristos, par la bouche d’un de ses amis, qui raconte les premiers émois sexuels, la fascination pour le cinéma, en particulier les films du néo-réalisme comme “Riz amer”, ou les équipées dans le bois du drame. Il le décrit comme un enfant ordinaire, mais que la privation de père (ce dernier a été assassiné, comme on l’apprend ensuite) a laissé livré à lui-même :
Mais nous n’étions pas comme Aristos qui faisait des choses insensées. Peut-être parce que lui, il n’avait aucune sécurité, il n’avait nulle part où se réfugier. Ce n’était pas un sale gosse, ce n’était pas le gamin qui allait t’embêter ou te voler ou faire du barouf, non, il était très poli avec les gens et très obéissant avec les adultes, il se tenait très bien. Seulement si on l’embêtait. Si on fourrait son nez dans ses affaires ou ses lubies. Ou quand il se sentait menacé. Alors, il se changeait en fauve. Mais c’était un enfant rabaissé, un enfant sans tendresse, qui n’avait pas senti, comme la plupart ders enfants du monde, l’affection et l’amour, il n’était pas rassasié de sa soif de jeu et de la douceur des cadeaux et avant tout, ce dont il n’était pas rassasié le pauvre, c’était bien cette saloperie de nourriture.
Aristos connaît la faim, vend son sang ou se prostitue pour quelques drachmes auprès de prédateurs sexuels. Il subit une forme d’animalisation, notamment à travers le surnom de “cochon”, dont on l’affuble, un processus de déshumanisation qui finira par le désigner comme monstre, et l’abattre. Certains, en revanche, font de lui une victime expiatoire, une figure christique. Le terme de martyre intervient à plusieurs reprises. Le livre pose la question de la fabrication du monstrueux, par les médias qui soutiennent le pouvoir politique. Contrairement aux autorités, les personnages du récit doutent, pour la plupart d’entre eux, qu’Aristos soit ce monstre.
Et quand, des années plus tard, il a fait la une des journaux et qu’on l’a présenté comme un fauve sanguinaire, une bête sadique, je n’y ai pas cru. Et personne d’entre nous n’y a cru. Cette ville, Thessalonique, ne nous sortait que des monstres et des fantômes. Nom de Dieu, elle était hantée, ou quoi ?
L’auteur analyse, par le biais des personnages, l’implacable mécanisme qui mène à la délinquance, puis à la mort, érigeant le protagoniste, soumis aux vicissitudes extérieures et à ses propres démons, en héros de tragédie. Il met en cause les aveux extorqués et les méthodes policières :
On l’a fait avouer. Dégueuler de force des choses qu’il n’avait pas faites. On a remué toute son enfance pour pouvoir coûte que coûte le décréter déviant. On l’a beaucoup torturé, pour qu’il leur dégueule tout sur un plateau. S’il est vrai que, durant la période des interrogatoires, il léchait la pisse pour étancher sa soif, qu’est-ce que je peux ajouter ? Ça aussi ça s’est dit. Il l’a lui-même dévoilé face à l’assemblée. Je buvais de l’eau dans le seau avec les eaux usagées et je léchais les tuyaux des toilettes, a-t-il déclaré. Et qu’on lui a imposé le martyre de rester debout sur une seule jambe, la pire des tortures.
D’autres, comme une femme de ménage, amie de la mère du protagoniste, décrivent en détail la misère sociale, les conditions de travail, l’exploitation.
Elle rabaissait les humbles, la sale société. Les bonniches et les petites bonniches, les esclaves et les petits esclaves, aurait-on dû les appeler. Mais on ne disait pas esclaves, qui aurait dit ça, une telle chose dit-elle ? – Quoi ? Nous n’étions quand même pas des noires d’Afrique ?
Elle décrit les sévices sexuels et la maltraitance dont sont victimes les domestiques, évoquant un autre fait divers, celui de la jeune Spyridoula, accusée de vol que ses patrons avaient brûlée au fer à repasser. “Combien d’autres Spyridoula, Spyridouleurs comme elle ?” Elle évoque aussi la famine pendant l’Occupation, qui a conduit ses parents à la placer comme domestique, ou son mariage arrangé et ses déboires conjugaux, lorsque son mari la trompe avec une Allemande “qui paraissait rincée au chlore” … “et ses yeux comme des œufs dégoulinants”. Elle aussi soupçonne la véritable cause de l’accusation :
Pendant des mois, à la radio, on parlait d’abord d’Aristidis et de ses passions et de ses exploits, et ensuite de l’actualité, du Vietnam et de Kennedy…C’était un coup monté. Pour rien ! Il est mort pour rien ! On lui a tout mis sur le dos exprès ! Ils ont eu les mains bien sales avec ce gamin !
Ces exclus délivrent une vérité bien différente de celle transmise par la presse ou les politiciens. Lolo (pour Lollobrigida), l’homosexuel, Sylva la chanteuse, le forain, l’indicateur, de la police, contraint aux dénonciations en échange d’un kiosque qu’il n’a pas réclamé et même le gendarme ont chacun leur opinion sur Aristos. Certains louent sa générosité, mettent l’accent sur son caractère enfantin (il aime les sucreries) ou son horreur du sang depuis l’assassinat de son père, loin de l’image monstrueuse véhiculée par la presse. Il est comparé à un funambule, soumis à l’insécurité et risquant à tout instant de se fracasser. Sylva, fille de réfugiés anatoliens d’origine russe, et vraie blonde, comme elle le souligne avec fierté, allume une bougie à chaque anniversaire de la mort d’Aristos, qu’elle a aimé. Lolo rêve de lui. Le notaire, pour sa part, qui se donne bonne conscience en s’adonnant à l’action caritative, est le patron de Marina la jeune bonne qu’il surprend, sur un banc, dans les bras d’Aristos. Il le fait arrêter, initiant ainsi le cycle de délinquance dont le jeune homme ne pourra s’échapper. Thessalonicien de souche, ou “bayatides”, il déplore l’hégémonie d’Athènes, qu’il rend responsable de la délinquance et des bas-fonds de sa ville natale.
Le monde dans lequel ils évoluent, gangrené par la corruption des classes sociales élevées, s’avère impitoyable pour les enfants, que la faim transforme en victimes de pervers sexuels. Mais les gens de gauche ne sont pas épargnés non plus. La guerre civile, de 46 à 49, a laissé des traces, et l’opinion divergente des neuf narrateurs permet au lecteur d’en saisir la complexité. Toute l’histoire grecque contemporaine, les relations avec la Turquie, le rôle joué par les communistes, avec les résistants de l’ELAS qui ont tué son père et plongé sa famille dans la précarité, permet d’appréhender les mécanismes sociaux qui ont contribué à la tragédie personnelle d’Aristos. La préface aide le lecteur à se situer et de mieux comprendre le contexte historique du récit, pas toujours familier. De même que le délateur du roman, le gendarme confesse ne l’être pas par choix (on les recrute surtout chez ceux qui votent à droite), et plusieurs personnages s’avèrent pris au piège. Le livre dénonce avec virulence l’État parallèle dont il révèle les mécanismes, les pratiques de racket dignes d’un système mafieux et le régime de terreur. Il s’attarde sur l’humiliation publique des délinquants. En même temps, des descriptions de carnaval et de fête foraine ancrent le récit dans un monde ponctué par les divertissements populaires. C’est en effet une attraction, “le cycle de la mort”, qui donne son titre au roman. Il s’agit d’une piste cylindrique sur laquelle des réfugiés exécutent des acrobaties à moto, au péril de leur vie. Aristos y travaille comme apprenti mais ne se produit pas sur scène. Ce sport violent pourrait métaphoriser l’existence de précarité, de danger et de peur à laquelle il se confronte. L’écriture de Thomas Korovinis restitue l’atmosphère colorée de la fête et la dimension épique du spectacle.
Le style, âpre et violent, fait penser, par sa crudité, aux romans de Pasolini décrivant la banlieue italienne, pendant les années 1950-1960, les petits voyous et les milieux homosexuels, sans concession. Comme l’écrivain et cinéaste, et son “pasticciaccio”, forme d’écriture poétique et polyphonique, l’auteur grec s’efforce de restituer les particularités linguistiques de ses héros, conférant à chacun une voix individuelle, celle de son milieu social, que Clara Nizzoli, la traductrice, commente dans sa préface. Au grec se mélangent parfois des mots turcs, “youzkades, kouyoumtzis”, etc. Les personnages se retrouvent plus dans les chansons populaires, comme celle sur la contrebande, que dans d’autres formes de musique plus policées et plus aseptisées. Ainsi, l’une d’elles, citée dans le livre, évoque les contrebandiers du port de Thessalonique. Lolo parle un sociolecte, le “kaliarda”, caractéristique de la communauté LGBT, dont un lexique est fourni à la fin.
La populace nous crachait dessus, ils tsitsitouillaient, les crétins. Nous avions aussi dans le quartier une loparde, une tantogaleuse imbâfrablez, Takis, ou Takou, Takou l’épicière, boutement toxique, et qui jactait du tsitsi.
Quant au notaire, il use du khatarevoussa, (de kataros, pur) la langue officielle (et artificielle), purgée de ses mots d’origine turque, qui domine à l’école et dans une certaine littérature, mais creuse l’écart avec le sous-prolétariat. On pourrait penser, dans cette tentative de réhabilitation d’un condamné à mort, au texte de Gilles Perrault, “Le pullover rouge”. Mais le livre de Thomas Korovinis s’avère très différent de celui du journaliste français, qui mène une contre-enquête, par son style et sa construction. “Le pullover rouge” reconstitue une enquête policière dont il s’efforce de montrer les lacunes. Plus fictionnel que “De sang-froid” de Truman Capote, “Le cycle de la mort” déconstruit un système socio-politique qui s’appuie sur la presse et redonne une voix aux invisibles.
Ce livre bouleversant, aux accents d’une crudité, voire d’une obscénité toute pasolinienne, tant par sa dimension humaine, son intelligence politique et son travail sur la langue que la traductrice s’efforce de mettre en évidence, ne peut laisser le lecteur indifférent, ni indemne. Il s’impose par sa force et son énergie, à travers la dénonciation d’un système qui opprime les individus et bafoue l’innocence. En donnant une voix aux figures de la marge, l’auteur, qui manie avec brio toutes les formes de l’oralité, s’est imposé en Grèce comme une figure majeure, et engagée, de la littérature contemporaine.
Korovinis, Thomas, “Le cycle de la mort”, traduit du grec par Clara Nizzoli, Belleville éditions, 21/01/2022, 1 vol. (250 p.), 20€
Thomas Korovinis est né en 1953 à Thessalonique. Professeur de lettres à Istanbul au début des années 1990, il est aujourd’hui traducteur du turc, compositeur, parolier, interprète et écrivain. Son œuvre se distingue par une oralité très prononcée, les mélanges linguistiques et une réelle dimension musicale. Il accorde une place prépondérante à la marginalité, qu’elle soit sociale, sexuelle ou ethnique, mettant en scène des personnages rejetés qui évoluent dans les cercles inférieurs de nos sociétés. Il vit aujourd’hui à Thessalonique où il représente une figure littéraire majeure.
Marion POIRSON-DECHONNE
articles@marenostrum.pm
Korovinis, Thomas, “Le cycle de la mort”, traduit du grec par Clara Nizzoli, Belleville éditions, 21/01/2022, 1 vol. (250 p.), 20€
Retrouvez cet ouvrage chez votre LIBRAIRE près de chez vous ou sur le site de L’ÉDITEUR
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.