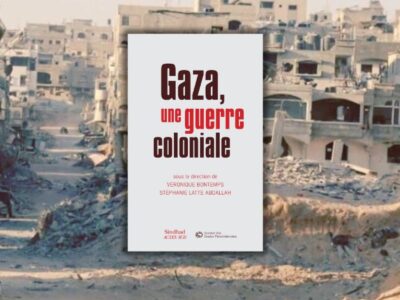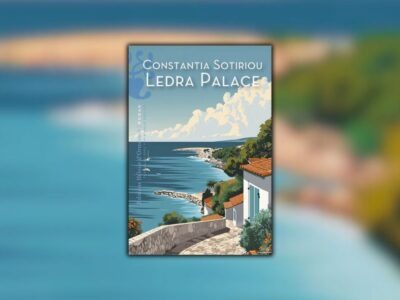C’est sur l’évocation des cigales, que l’on retrouve à la fin, et de la Sibylle de Cumes, qui avait demandé à Apollon l’immortalité, en omettant l’éternelle jeunesse, que s’ouvre le magnifique livre d’Arianna Cecconi, “Les oracles de Teresa”. Cette figure mythique emblématise le personnage éponyme, autour duquel gravite toute une série de personnages féminins, (équivalents mortels des sibylles et des sirènes, ou la Pachamama, cette déesse mère des Andes) dont chacun va, à sa manière, décliner le don divin. Le titre originel, “Teresa degli oracoli (Teresa des oracles) “, sorte d’épithète homérique qui définit l’héroïne, se trouve investi d’une puissance de signification archaïque dont est dépourvue sa traduction.
À Bonaventura, petit village de Lombardie, et plus précisément au sein de la maison du figuier, la demeure familiale, se côtoient trois générations de femmes, perçues comme des sorcières par les villageois, autour de Teresa, la grand-mère, dont la mort est proche. “Il n’y avait pas d’homme ici, et sans doute n’y en avait-il jamais eu. À part grand-père Antonio, mais si peu de temps”. L’aïeule est murée depuis dix ans dans le silence, si bien que les autres vont se substituer à elle, Nina, la narratrice, prenant en charge le récit. Elles le feront de manière encore plus marquée en pratiquant un rituel andin spécifique censé accompagner la mort. Rusi, la cousine de Teresa, qui écrit aux présidents, Irène, la mère de Nina, et sa sœur Flora, la laissée pour compte, Nina la narratrice, et enfin Pilar, la servante, immigrée péruvienne, l’entourent alors pour redire des fragments décousus de son existence, que la mort recoudra. Mais elles se rassemblent aussi autour de rituels plus profanes, comme celui de la télénovela qui les captive et qu’elles écoutent religieusement en dépit de sa niaiserie. Les non-dits et les silences peuplent leur quotidien. Nina, la métisse, conçue en Érythrée, rêve à son père inconnu et absent, et fantasme sur le flacon de terre d’Afrique enfoui dans un tiroir, tel “une poudre magique”, qui lui rappelle ses origines et dont elle espère hériter. Le motif du trou sert à exprimer les lacunes dont sont faites ces vies, mais peut-être aussi la spécificité du don : “Notre langue est trouée comme les céramiques péruviennes que Pilar a offertes à mamée”, constate Nina, qui entame une description aux airs de poème, dont les derniers mots sont :
…il y a un homme
Un homme au masque d’oiseau
Dans sa bouche il y a un trou
Entre eux, il y a un serpent,
Ses yeux sont troués
Les Incas le savaient,
Les trous sont des portes pour voir au-delà.
Mais le livre met aussi à jour d’autres significations. La peau trouée de Teresa rappelle les stigmates du Christ, suscitant tout un jeu de correspondance avec les trous de la mémoire de l’âge et la mémoire traumatique de Rusi. Son corps n’a pas de consistance : “Une grand-mère en papier de soie qui paraissait échapper à la force de gravité ; j’aurais pu la jeter sur mon épaule et courir jusque dans le jardin pour qu’elle puisse revoir les étoiles.” Une grand-mère devenue aussi petite que la Sibylle de Cumes, que l’on compare à “un grand nourrisson flottant sur l’eau”, et s’abreuve, tel un enfant, de biberons de lait, avant de retourner au néant.
Empreint de sensualité et de mystère, ce roman ressortit au réalisme magique très prégnant chez les auteurs d’Amérique du Sud dont il paraît s’inspirer. Sa tonalité baroque se reflète jusque dans la chambre de Teresa, un des lieux phares du récit, qui s’apparente, par son décor, à un cabinet de curiosités. Le livre fait aussi songer, dans une certaine mesure, bien que le contexte s’avère radicalement différent, au très beau roman de Carole Martinez, “Le cœur cousu.” La dimension onirique traverse sans cesse le texte. L’onirisme apparaît omniprésent dans ce livre, où toutes s’adonnent au rêve, sauf Miguli, pour qui : ” la nuit était un modeste banquet qui s’achevait à l’aube. Elle n’appelait pas cela de l’insomnie-qui a dit qu’on devait dormir, la nuit ? ” Premier oracle, passé inaperçu, de la famille, elle précède Teresa, qui, dans cet univers régi par la pensée poétique, apparaît proche de la nature et du cosmos, comme si elle avait pour double un animal totem : “Teresa dormait comme les dauphins, qui ont le cerveau divisé en deux : ils dorment tout en nageant, restent la moitié du temps au fond de la mer, puis remontent vers la surface. Grand-mère rêvait tout en nous écoutant, elle dormait tout en veillant sur nous. Ses paupières étaient closes, mais dessous, ses yeux étaient grands ouverts.”
Pour l’écrivain, rêve et prédiction occupent une place essentielle, installant le récit dans un espace-temps qui oscille entre présent, passé et futur, posant la question de la mémoire, du choix et de la transmission. Ainsi, les héroïnes du roman se transmettent des objets réels, comme les chemises de nuit, qu’elles s’échangent, ou immatériels. De la culpabilité. Des souvenirs, aussi. Rusi est marquée par ceux de la guerre en Europe et d’un bombardement meurtrier, auquel elle a réchappé, Pilar par les troubles du Sentier lumineux. “Ainsi avait commencé le tiempo di miedo, le temps de la peur, aussi long que la léthargie de Teresa”, rappelle la narratrice, unissant l’aïeule et la servante péruvienne dans une même phrase. Les pouvoirs magiques excèdent le cadre familial : ainsi la guérisseuse d’un village voisin effleure le linge d’une personne jamais rencontrée pour sentir ce qu’elle est.
La formation ethnographique de l’auteur l’a mise en contact avec des croyances et des rituels qu’elle restitue, en leur conférant une profonde dimension poétique. L’étrangeté, les secrets, les non-dits s’incarnent dans ces mystérieuses brassières noires dont la comptine hante l’esprit d’Irène, avant qu’elle ne les découvre dans un tiroir. À quoi renvoient-elles ? Que faisait Flora, nue au milieu d’un troupeau d’oies frémissantes ? Est-ce la raison de la rupture de ses fiançailles ? Pourquoi Nina collectionne-t-elle les ossements ? Que signifient ces cocons, semblables à des momies miniatures, suspendus à des cordelettes autour du lit de Teresa et dont l’auteur, peu à peu, nous révèle le sens caché ? D’où viennent les lettres apparues mystérieusement sur sa peau ? Leur relation avec les pages écrites du rêve de Pilar, qui n’en a retenu que deux mots, “sangre”, et “mariposa”. Et Irène, l’anti-Cendrillon, étrange créature née avec douze orteils, dont deux ont été amputés par son propre père, qui a fait le vœu de ne porter que des chaussures rouges, et trouve dans la photographie la dimension visionnaire qu’elle partage avec les femmes de son entourage ? Car, comme les rêves, cet art sert de révélateur. La guérisseuse, la photographe et la Sibylle présentent les facettes d’un même don des dieux. La médecine ancienne, avec la théorie des humeurs, rencontre ici les pouvoirs magiques d’un œuf posé sur le corps pour extirper la maladie.
Cette maison qui n’abrite aucun homme, sinon de façon provisoire, pourrait rappeler celle de Bernarda Alba, de Lorca, mais ici, la magie l’emporte sur la tragédie, et l’étouffement cède la place à l’ouverture au monde. Le flou de la brume qui occulte les contours se nomme la panse de l’âne, une image venue des Indiens. Dans cette ancienne ferme la sériciculture, dont subsistent encore des traces, permet de catégoriser l’humanité en deux grandes espèces, les papillons et les vers à soie. Nous sommes initiés à un univers de mues et de métamorphoses, emblématisées par le serpent et le bombyx. L’auteur tresse un jeu d’échos et de correspondances, qui émanent de sa vision poétique. La récurrence des constellations ponctue le récit. Nina et Gabriele, pendant la nuit de San Lorenzo, celle du film des frères Taviani, tentent de distinguer les étoiles des planètes. “Plus tard, dans la chambre, alors que nous dormions enlacés, l’une des étoiles en plastique phosphorescent qu’il avait collées au plafond pour dessiner la Grande Ourse nous était tombée dessus, nous réveillant en sursaut.” Comme dans le recueil de nouvelles d’Italo Calvino, “Cosmicomics”, le cosmique côtoie ici le comique. L’humour, en effet, n’est jamais loin.
Le texte se tisse de références multiculturelles, avec ce “quariwumi” dont le sexe change à la pleine lune, ou l’histoire d’Epiménide, et de fragments de langues étrangères, de la Méditerranée au Nouveau Monde, dialecte lombard mêlé à l’italien, espagnol, quechua…”Llaki, llaki mamay, paris paris palomitay”, dit la berceuse de Pilar qui résonne comme une incantation. Il joue aussi sur diverses formes, hésitant parfois entre recettes de cuisine et grimoire de sorcières, comptine et poème, qui insufflent au romanesque sa dimension poétique. Il revisite les mythes antiques, les inverse parfois, comme avec cette sirène attachée au mât d’un navire, ou les mêle aux mythologies andines.
“Nous sommes de l’étoffe dont on fait les songes, et notre petite vie est environnée de sommeil”, écrivait Shakespeare dans la tempête. Dans ce monde magico-onirique, l’auteur nous donne un fil d’Ariane pour nous guider sans nous perdre, pour notre plus grand bonheur.
Marion POIRSON-DECHONNE
articles@marenostrum.pm
Cecconi, Arianna, “Les oracles de Teresa”, traduit de l’italien par Marianne Faurobert, Marabout, “La belle étoile”, 25/08/2021, 1 vol. (283 p.), 19,90€
Retrouvez cet ouvrage chez votre LIBRAIRE près de chez vous ou sur le site de L’ÉDITEUR
Faire un don
Vos dons nous permettent de faire vivre les libraires indépendants ! Tous les livres financés par l’association seront offerts, en retour, à des associations ou aux médiathèques de nos villages. Les sommes récoltées permettent en plus de garantir l’indépendance de nos chroniques et un site sans publicité.